L’ennemi principal s’appelle modérantisme
[Note : cet article a été publié dans Catholica, n.98]
La culture du refus de l’ennemi. Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle ((. Bernard Dumont, Gilles Dumont et Christophe Réveillard (dir.), La culture du refus de l’ennemi. Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle, Presses universitaires de Limoges, Limoges, 2007, 150 p., 20 €.)) : cet ouvrage collectif inaugure une prometteuse collection, la « Bibliothèque européenne des idées », dont les premiers titres se proposent d’analyser, dans une perspective pluridisciplinaire et en faisant largement appel à des auteurs étrangers, trois attitudes produites par la situation minoritaire aujourd’hui propre aux membres des religions établies en Europe. Outre le modérantisme, sont visés le communautarisme, avec sa tentation de la contre-société, et le pluralisme religieux conjugué à l’esprit de concurrence.
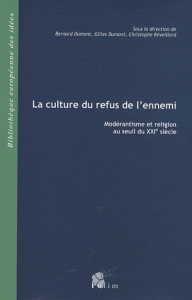
D’emblée, il faut féliciter les responsables de cet ouvrage d’avoir su dégager la problématique du modérantisme de la gangue de l’histoire de la démocratie chrétienne, française ou non, pour lui restituer toute sa profondeur sur le long terme. Ils manient aussi bien la loupe que la longue-vue, s’intéressant à la fois au proche et au lointain. L’intitulé des trois parties composant l’ouvrage (Histoire – Concepts – Perspectives) est à cet égard très parlant et pleinement justifié.
Au lieu de se limiter à la description ou à la dénonciation des traductions pratiques du modérantisme dans le champ politique ou religieux, il s’est agi d’abord de mettre en relief un état d’esprit, une attitude devant la vie, voire une philosophie implicite. En deçà des avatars politiques (Sillon, démocratie chrétienne, participation à la construction de l’Europe) ou religieux (théologie moderniste, instruments du compromis et de la » réconciliation »), c’est l’essence du modérantisme et de l’identité modérée — dont le caractère mouvant, difficile à saisir, n’altère en rien la capacité de nuisance — qui constitue l’objet de l’ouvrage. En effet, « depuis la politique moderne, la culture du refus de l’ennemi […] a pris forme avec une figure particulière, celle du modéré » (Jean-Paul Bled, « Présentation », p. 10). La culture en question est le produit de « l’esprit transactionnel qui prévaut dans l’immense majorité du monde catholique » (Gilles Dumont, « Problématiques du modérantisme », p. 17), esprit dont l’auteur souligne bien qu’il peut prendre au moins trois formes : la collaboration avec les « structures de péché », au nom de l’entrisme et des bonnes intentions visant à combattre et rectifier le mal de l’intérieur ; l’optimisme niais qui prétend savoir décrypter la réalité (l’ennemi est bien là, et même massivement, mais en fait c’est un ami qui s’ignore) ; enfin, option plus subtile et plus rare, le quiétisme, qui prend dans ce cas la forme du retrait du monde dans le jardin de l’intériorité, l’abandon à la Providence étant censé pallier tout le reste.
Mais avant toute enquête historique, c’est la réflexion philosophique qui doit démontrer en quoi le modérantisme est une déformation ou une caricature de la modération ou, mieux, de cette qualité éminente que le grec ou le latin nommait tempérance. Celle-ci est étroitement associée au sens de l’harmonie et de la mesure, non celui de M. Homais, mais en tant que la tempérance « c’est la conviction que le seul absolu c’est l’univers, conçu comme ce qui est tel que tout puisse y être contenu de manière harmonieuse sans qu’aucune des parties ne puisse paraître en constituer la fin propre et être cultivée comme telle sans intempérance » (Claude Polin, « Modération et tempérance : continuité ou antinomie ? », p. 25). Pour l’auteur, la tempérance n’a plus sa place dans le monde moderne, quand s’efface toujours plus la conscience de l’ordre du monde et du monde comme ordre, quand un prométhéisme encore très largement dominant malgré les aléas du « progrès » enseigne encore et toujours qu’il n’y pas d’autre ordre que celui constamment créé et recréé par l’homme. Mais Claude Polin est un philosophe qui sait aussi observer les manigances de la politique. Ainsi quand il taille aux politiciens modérés, en rappelant leurs deux règles de base, ce costume si bien ajusté qu’on le voit déjà sur le dos d’un certain président-vibrion : « La première est de présenter comme novatrices et révolutionnaires des idées qui ne fassent peur à personne, en tout cas pas au plus grand nombre, et la seconde de se tenir aussi près que possible de son concurrent et de ses discours (au point que la confusion devienne possible), tout en se présentant comme son irréductible adversaire » (p. 31).
Avec Péguy, ce sont surtout les clercs au sens propre du terme qui font les frais de la critique, parfois très incisive, à la limite même de l’invective quand l’écrivain catholique se moque de l’apparence physique des représentants du « parti dévot », ces théologiens modernistes dont il dit : « Parce qu’ils n’ont pas le courage d’être d’un des partis de l’homme, ils croient qu’ils sont de Dieu » (cité p. 35 par Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, « Péguy et les modérés »). Pour Péguy, le théologien moderniste est « l’homme qui tremble. C’est l’homme dont le regard demande pardon d’avance pour Dieu ; dans les salons » (ibid., cité p. 39). Bien qu’il faille se garder de généraliser sur la puissance plasmatrice des idées et des visions du monde, force est de constater que le modérantisme, et tout spécialement le modérantisme en matière religieuse, produit souvent des types humains immédiatement reconnaissables jusque sur le plan physique : mélange de mollesse et de suffisance, air compassé et plaintif, dignité et sérieux de commande sur le mode des huissiers annonçant, parmi les ors de la République, l’entrée du président de la Chambre dans la salle des séances. Que l’on songe par exemple à un Louis Schweitzer, ancien président-directeur général de Renault-Nissan, membre de la famille du célèbre médecin, musicologue et théologien protestant, à présent à la tête de la Halde (Haute autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l’égalité). Il suffit de regarder un instant un personnage comme celui-là, par ailleurs richissime, pour saisir ce que signifie la subversion installée, dans ses meubles, « faisant autorité », mais se donnant toujours pour équilibrée, impartiale, au-dessus des passions et des factions. Chez ce genre de modérés, il est évident que modération rime avec tartuferie.
Toujours dans le cadre des traductions historiques du modérantisme, l’enquête se poursuit par un article (de Christophe Réveillard) sur la participation des catholiques à la construction de l’Europe, un autre (de Paul-Ludwig Weinacht) sur le même thème en lien avec les chrétiens-démocrates allemands, et un troisième (de Miguel Ayuso) montrant combien, pour l’Espagne restée « différente » jusqu’à la fin du franquisme, l’européisation a été synonyme de sécularisation accélérée. Ce sont là, en effet, autant d’exemples d’hétérogenèse des fins : les rêves d’Europe « carolingienne » entretenus par les catholiques modérés ont débouché sur un espace-Europe ouvert à tous les vents, théâtre de tous les mélanges, simple prélude au marché mondial déterritorialisé.
La partie la plus proprement politologique et théorique de ce recueil apparaît, logiquement, comme imprégnée de la leçon de Carl Schmitt, parfois aussi de son « disciple » français, Julien Freund. Qu’il s’agisse du refus d’admettre la possibilité de l’ennemi (Jerónimo Molina Cano), du refus du conflit (Teodoro Klitsche de la Grange) ou encore de l’ami extérieur et de l’ennemi intérieur (G. Dumont), plusieurs des grands thèmes chers au maître de Plettenberg reviennent ici, avec une insistance sur l’ennemi intérieur et le climat de guerre civile larvée, tous deux consubstantiels à la démocratie moderne. Le dernier auteur cité souligne la gravité encore plus forte de la négation de l’ennemi en milieu chrétien, dans la mesure où le refus du conflit est aussi négation de la présence agissante du Mal. Il introduit ainsi aux deux contributions de nature théologique, l’une (de Claude Barthe) portant essentiellement sur le domaine moral, l’autre (d’Ansgar Santogrossi) sur certaines démarches œcuméniques comme exercices de modérantisme.
Apparemment sans lien avec le modérantisme et la culture du refus de l’ennemi, les contributions de la dernière partie entendent ouvrir des perspectives de reconstruction, comme s’il s’agissait de prendre acte de l’écroulement définitif des grandes structures socio-historiques (Etat, nation, peuple) et de voir à partir de quoi il est possible de rebâtir. En fait, c’est par leur contenu « radical » qu’elles gardent une relation paradoxale avec le thème dominant de l’ouvrage. Tel est notamment le cas de la longue et originale contribution de Bernard Wicht (« Rebelle, armée et bandit : le processus de restauration de la cité »), en quête de réponses chez des penseurs qui ont dû méditer sur des situations de crise profonde : Platon, Machiavel ou encore Ernst Jünger écrivant son Traité du Rebelle six ans seulement après la défaite de l’Allemagne nazie. Par ailleurs, un thème auquel Schmitt s’était intéressé, celui du katekhon, « ce qui retient » ou « retarde » la venue du « mystère d’iniquité », revient dans la dernière contribution (de Bernard Marchadier). Selon l’interprétation de l’auteur, il y a analogie entre la Sagesse, la Vierge et la Cité, le mal retenu étant l’anomie, « le dérèglement de toutes choses dans la cité humaine » (p. 130).
Quant à l’article conclusif de Bernard Dumont (« La politique contemporaine entre grands principes et lâchetés »), il se termine par une interrogation sur la capacité des démocraties occidentales à absorber indéfiniment des contradictions de plus en plus criantes, y compris par l’entretien délibéré d’un « désordre établi » permettant au Système de se poser en ultime recours et moindre mal.
Après cette présentation détaillée, il importe de faire une réserve de caractère formel et de suggérer une piste de recherche, peu explorée dans l’ouvrage, sur les origines du modérantisme, en France du moins. La réserve porte sur le nombre de contributions. L’ouvrage aurait gagné en cohérence et en clarté, évitant chevauchements et redites, avec moins de contributions, mais plus fournies. Il faut cependant rappeler qu’il transcrit les interventions et certains débats d’un colloque. Si l’impression générale qui se dégage est que le sujet a été abordé sous de nombreuses facettes, il resterait à considérer la sociologie des modérés, quelle que soit l’époque où l’on peut à bon droit parler d’eux (depuis la fin du XVIIIe siècle, période de leur apparition, jusqu’à la récente et actuelle politique d’ « ouverture » de la majorité présidentielle à de pseudo-opposants), de même que la question d’une délimitation confessionnelle précise du modérantisme. Par exemple, le modérantisme doit-il être considéré comme un phénomène interne au catholicisme européen ou à l’ensemble du christianisme du Vieux Continent, et seulement ainsi ? Le terme de modérantisme a‑t-il encore un sens lorsqu’il s’applique à des choix politiques qui n’ont plus qu’un lien très lâche avec l’héritage christiano-catholique de l’Europe ?
Toute la difficulté pour cerner le sujet nous paraît venir du fait que les modérés et le modérantisme évoluent toujours à la frontière de la sociologie et de la psychologie. Comme l’avait bien vu Abel Bonnard dans son livre de 1936, les modérés sont, en France du moins, les restes de l’ancienne société ; sociologiquement, ils se recrutent assez souvent, à date plus récente, parmi les anciennes élites (chez les descendants des notables de robe, par exemple). Mais le modérantisme, lui, est un état d’esprit, qui déborde de beaucoup les milieux des conservateurs honteux formellement catholiques. Cet état d’esprit n’en doit pas moins avoir une histoire, bien que celle-ci soit difficile à retracer. La piste de recherche que nous soumettons, dans le sillage de Bonnard, se limite à la France et consiste à suggérer que l’origine des modérés remonte à la vie de société au XVIIIe siècle, laquelle, en France, « s’est signalée par une spécieuse activité de l’esprit, et c’est par là qu’elle a pu être aussi funeste dans ses suites qu’elle était fascinante dans ses manifestations » ((. Abel Bonnard, Les Modérés. Le drame du présent [1936], Editions des Grands Classiques, 1993, p. 99.)) . La brillante formule de Bonnard — « La France est le pays où les défauts des salons sont descendus dans les rues » ((. Ibid., p. 101.)) — nous paraît pouvoir rendre compte de plusieurs traits propres au phénomène des modérés et du modérantisme : l’importance des intellectuels dans les rangs modérés ; la surestimation par ces milieux de l’intelligence discursive et ratiocinatrice, au détriment de l’intuition intellectuelle impersonnelle et de la force de caractère ; la vanité des modérés, qui, comme disait Bonnard, « complique » leur faiblesse et la rend « très nuisible » ; leur permanent complexe d’infériorité envers les opinions subversives, en ce que celles-ci leur paraissent toujours témoigner d’une plus grande énergie, cette énergie qui leur fait tant défaut ; leur inguérissable puérilité, eux qui se laissent guider, sous prétexte de briller, par « la croyance enfantine que ce qu’ils ébranlent durera toujours » ((. Ibid., p. 111.)) .
A tous ces titres et à quelques autres, modérés et modérantisme apparaissent donc, toujours en bornant la réflexion à la France, comme strictement indissociables de la prédominance dans notre pays de la mentalité bourgeoise et individualiste.
Au bout du compte, qu’ils soient formellement chrétiens ou non, catholiques ou non, ce dont souffrent avant tout les modérés français, c’est de ce que l’on pourrait appeler un « déficit d’incarnation ». En ce sens, le modérantisme, porteur de la culture du refus de l’ennemi, est bien l’ennemi principal de toute tentative authentique de restauration de la cité, puisque celle-ci passe nécessairement, comme l’a bien vu Bernard Wicht, par l’apparition, par la lente et silencieuse affirmation d’une nouvelle substance humaine, donc par une véritable révolution anthropologique.







