 Numéro 159 : Face à la sécularisation
Numéro 159 : Face à la sécularisation

Dans les sociétés occidentales réputées avancées, l’administration des choses a depuis longtemps succédé au gouvernement des hommes, ce que traduit communément le terme de « gouvernance », issu des sciences de gestion, pour désigner toute forme d’organisation pratique d’un groupe, notamment politique, disqualifiant toute interrogation sur sa finalité. Le gouvernement n’est ainsi considéré qu’en tant que technique permettant d’obtenir, de la part de destinataires, une exécution qu’on ne qualifie plus d’obéissance, à des mesures qui ne doivent plus être des actes d’autorité. L’évolution est aussi ancienne que le saint-simonisme, mais les outils mis à disposition de la gouvernance ne cessent de se perfectionner.
Popularisée surtout après que l’un de ses principaux concepteurs, Richard H. Thaler, a obtenu le prix Nobel en 1997, l’économie comportementale irrigue désormais fortement les organisations publiques, y compris (et peut-être désormais surtout) de ce côté-ci de l’Atlantique. 
![]() Accéder au sommaire | Parcourir des extraits |
Accéder au sommaire | Parcourir des extraits | ![]() Achat du numéro, s'abonner
Achat du numéro, s'abonner
Abbé Pierre Marie Berthe : 1700 ans après Nicée : quelques leçons du Concile
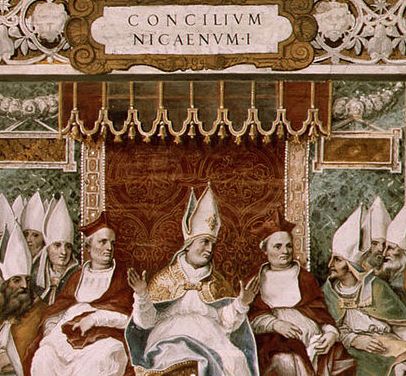 En 325, le concile de Nicée, convoqué par Constantin, ratifiait une profession de foi et vingt canons disciplinaires. Plusieurs aspects de ce Concile et de sa réception compliquée méritent réflexion au regard de la vie de l’Église aujourd’hui : la détermination de l’autorité à restaurer l’unité, la lutte contre l’hérésie, la priorité accordée à la doctrine, l’attention portée à la dignité du clergé et la structure hiérarchique de l’Église, le danger des ingérences extérieures et des compromis doctrinaux, le témoignage rendu à la vérité en période de crise. (suite…)
En 325, le concile de Nicée, convoqué par Constantin, ratifiait une profession de foi et vingt canons disciplinaires. Plusieurs aspects de ce Concile et de sa réception compliquée méritent réflexion au regard de la vie de l’Église aujourd’hui : la détermination de l’autorité à restaurer l’unité, la lutte contre l’hérésie, la priorité accordée à la doctrine, l’attention portée à la dignité du clergé et la structure hiérarchique de l’Église, le danger des ingérences extérieures et des compromis doctrinaux, le témoignage rendu à la vérité en période de crise. (suite…)
Bernard Dumont : La royauté du Christ, genèse d’un déclassement
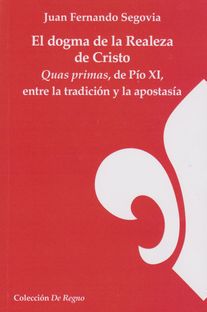 Sur le dernier ouvrage de Juan Fernando Segovia.
Sur le dernier ouvrage de Juan Fernando Segovia.
L’auteur, déjà connu de nos lecteurs, a malheureusement quitté ce monde au cours de ce mois de mai 2025. Le présent texte[1] est l’un de ses derniers travaux, offrant la synthèse d’une série de contributions à des publications collectives sur le dogme de la royauté du Christ, spirituelle et temporelle indissociablement. Il commence par une définition de la royauté sociale du Christ, centrée sur l’encyclique de Pie XI, Quas Primas, dont on célèbre le centenaire cette année. Puis il mène une analyse des principales négations de ce concept, logiques dans l’esprit du protestantisme et du libéralisme, moins logiques mais tout aussi intelligibles dans les tentatives successives d’accepter l’état de fait au sein de l’Église, moins logiques encore dans certains milieux où l’on ne l’attendrait pas, en l’occurrence les quelques groupes de catholiques adeptes du « spirituel d’abord » s’affairant à camper ensemble loin des affaires du monde, donnant ainsi forme à un « communautarisme catholique » – ou son pendant clérical, une « hiérocratie ». Vient enfin une analyse des effets de la crise liée à Vatican II, le principal étant de vider de sens le dogme de la royauté du Christ exalté il y a maintenant un siècle. (suite…)
Denis Mestre : Saint Thomas, Michel Villey, et… René Girard
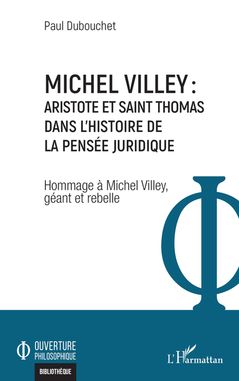 Docteur en philosophie et en droit, Paul Dubouchet a été maître de conférences en droit public à l’Université des Antilles et de la Guyane puis à l’Université de Corse. Ses écrits ont d’abord porté sur l’histoire des idées politiques, la théorie et la philosophie du droit avant d’aborder plus spécifiquement la pensée de René Girard. L’objet de son dernier ouvrage[1] n’apparaît pas clairement de prime abord : si le sous-titre laisse entendre qu’il s’agit d’un hommage à Michel Villey, le titre évoque une analyse de la pensée d’Aristote et de Saint Thomas dans l’histoire de la pensée juridique. L’introduction très brève (2 pages) ne clarifie pas tellement le propos. L’auteur y indique vouloir donner un aperçu de l’« œuvre immense » de Michel Villey à travers une relecture de son dernier ouvrage (Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique, Puf, 1987), complétée par quelques articles choisis. À ce stade de la lecture, on ne voit pas pourquoi l’auteur limite son propos à ces quelques textes au lieu de procéder à une analyse complète de la pensée de Michel Villey. Et l’on ne saisit pas le rapport direct avec la pensée d’Aristote et de saint Thomas à laquelle se réfère le titre de l’ouvrage. La suite de la lecture ne clarifie pas tellement le propos. On alterne entre les analyses d’histoire de la pensée juridique propres à l’auteur, la paraphrase des textes de Michel Villey, de saint Thomas ou d’Aristote et la mise en relation de ceux-ci avec une grande variété de philosophes. (suite…)
Docteur en philosophie et en droit, Paul Dubouchet a été maître de conférences en droit public à l’Université des Antilles et de la Guyane puis à l’Université de Corse. Ses écrits ont d’abord porté sur l’histoire des idées politiques, la théorie et la philosophie du droit avant d’aborder plus spécifiquement la pensée de René Girard. L’objet de son dernier ouvrage[1] n’apparaît pas clairement de prime abord : si le sous-titre laisse entendre qu’il s’agit d’un hommage à Michel Villey, le titre évoque une analyse de la pensée d’Aristote et de Saint Thomas dans l’histoire de la pensée juridique. L’introduction très brève (2 pages) ne clarifie pas tellement le propos. L’auteur y indique vouloir donner un aperçu de l’« œuvre immense » de Michel Villey à travers une relecture de son dernier ouvrage (Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique, Puf, 1987), complétée par quelques articles choisis. À ce stade de la lecture, on ne voit pas pourquoi l’auteur limite son propos à ces quelques textes au lieu de procéder à une analyse complète de la pensée de Michel Villey. Et l’on ne saisit pas le rapport direct avec la pensée d’Aristote et de saint Thomas à laquelle se réfère le titre de l’ouvrage. La suite de la lecture ne clarifie pas tellement le propos. On alterne entre les analyses d’histoire de la pensée juridique propres à l’auteur, la paraphrase des textes de Michel Villey, de saint Thomas ou d’Aristote et la mise en relation de ceux-ci avec une grande variété de philosophes. (suite…)
Dom Giulio Meiattini : Déconstruction de la famille. Un exemple de sophisme argumentatif
 Depuis quelque temps, le thème de la famille est au centre de discussions et d’études, de controverses politiques passionnées et d’informations dramatiques. Sur la vague de ces débats scientifiques et de ces études approfondies, de pressions culturelles, et souvent de manipulations médiatiques, l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de type de famille unique ou naturelle devient de plus en plus fréquente, dans la mesure où les modèles de l’institution familiale, les images mentales et les réalisations culturelles qui s’y rapportent sont multiples, à la fois diachroniques et géographiquement synchrones, et continuent de changer, à un rythme accéléré, dans diverses parties du monde.
Depuis quelque temps, le thème de la famille est au centre de discussions et d’études, de controverses politiques passionnées et d’informations dramatiques. Sur la vague de ces débats scientifiques et de ces études approfondies, de pressions culturelles, et souvent de manipulations médiatiques, l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de type de famille unique ou naturelle devient de plus en plus fréquente, dans la mesure où les modèles de l’institution familiale, les images mentales et les réalisations culturelles qui s’y rapportent sont multiples, à la fois diachroniques et géographiquement synchrones, et continuent de changer, à un rythme accéléré, dans diverses parties du monde.
À partir de prémisses empiriques (fournies par la sociologie, l’anthropologie culturelle, l’histoire), on conclut que les réalités désignées chaque fois par le terme « famille » seraient tellement hétérogènes que l’usage du singulier pour les désigner serait inapproprié. Seules des « familles », au pluriel, existeraient, ou encore ce que l’on appelle « famille », si l’on veut, se présenterait sous des formes si nombreuses et si variées qu’il serait impossible de la réduire à une idée unique et de validité universelle. (suite…)