Par des sentiers resserrés
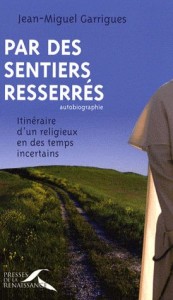
L’évocation autobiographique du père dominicain Jean-Miguel Garrigues est révélatrice à plus d’un titre. L’ouvrage débute sur un léger retour sur une enfance tiraillée entre culture espagnole, française et italienne, une enfance d’immédiat après-guerre avec les problèmes liés au déracinement d’une famille de diplomates, à l’isolement international de l’Espagne franquiste, et à l’anti-américanisme des Français humiliés par l’éloignement de leur grandeur passée. Le P. Garrigues, interrogé par deux jeunes amis, décrit ensuite les grandes étapes de sa vie, particulièrement sa vocation dominicaine, son noviciat à Lille, le séminaire au Saulchoir où il vécut notamment mai 68, sa formation à Rome, une année américaine ((. L’analyse de Jean-Miguel Garrigues évoque la « monotone uniformité » et le « vide métaphysique de la vie américaine », sa « griserie mondaine » des incessantes « parties » où percent « sous la façade communautariste, l’uniformité standardisée et le conformisme conventionnel ». Mentionnons aussi ses réflexions géopolitiques tout à fait fondées des pages 66–67.)) ‚puis une série d’engagements très divers. Le lecteur suit donc avec intérêt ce parcours dans la deuxième partie du siècle, particulièrement mouvementé en expériences humaines et spirituelles. Ce qui frappe le plus, la lecture achevée, c’est ce goût du contraste, cette volonté paradoxale d’analyser très lucidement les maux du siècle, tant philosophiquement que moralement, et de ne pas en tirer les conclusions qui sembleraient s’imposer. Si on se limite à la vie de l’Eglise, la critique de certaines pesanteurs et habitudes préconciliaires ne provoquerait pas la gêne chez le lecteur si elle n’était pas récurrente, appuyée et présentée — volontairement ou non — comme s’agrégeant à une remise en cause d’ensemble, laquelle devrait par ailleurs relever de l’évidence. Ainsi, les appréciations sur la « cuisine cléricale » ou le côté « fonctionnaire du culte » (p. 40), sûrement justes en soi, deviennent dangereusement systémiques quand la question suivante est consécutivement ainsi posée : « Ces messes préconciliaires n’ont cependant pas empêché votre croissance spirituelle. Comment l’expliquez-vous ? » (ibid). L’on retrouvera ce genre de généralisation lorsque l’auteur évoque « les messes dont on ne comprenait goutte et auxquelles les fidèles assistaient en marmonnant le chapelet pendant que loin d’eux les enfants de chœur semblaient faire la course avec le prêtre en débitant à toute allure les prières en latin… » (p. 54) ; peut-on vraiment réduire la description de l’ensemble des messes de l’époque préconciliaire à cela, tout autant qu’à la « pression sociale et [au] conformisme conventionnel » l’affluence des fidèles en Espagne, même s’il y a beaucoup de vrai dans ces observations ? De même, évoquant la période de sa vocation : « J’ai découvert une Eglise qui venait d’entrer en concile œcuménique, une liturgie qui sortait de la pompe creuse et sentimentale du XIXe siècle pour se renouveler par un retour aux sources, j’ai découvert le frère Roger de Taizé, qui passait nous parler d’œcuménisme, le bon pape Jean XXIII […] et le cardinal Montini, archevêque de Milan, qui, espérait-on, lui succéderait, car on le jugeait seul capable de mener à bien le concile » (pp. 81–82) ; tout le contraire, selon lui, de « l’impression de sclérose que donnait l’Eglise avant le concile » (p. 54) dont la dernière partie du pontificat de Pie XII était « marquée par un autoritarisme qui allait jusqu’à exercer une certaine « police de la pensée » », etc. Le dominicain se hasarde même à relier une amusante et révélatrice anecdote de quelques années suivant mai 68, à la situation du pontificat de Benoît XVI. Les PP. de Lubac et Bouyer, recrutés par le père Daniélou pour faire une démarche auprès du cardinal François Marty, déplorent auprès de celui-ci que « l’interprétation abusive du concile [fasse] table rase par rapport à la tradition antérieure » — ce qui exonérait en réalité à bon compte les causes intrinsèques dues à la rédaction des textes eux-mêmes. Ils entendent le cardinal de Paris leur répondre : « « Après le concile, nous avons pensé que l’avenir était au progressisme. Vous nous dites maintenant que le progressisme ne marche pas. Eh bien nous reviendrons à l’intégrisme ». Le père de Lubac faillit s’étrangler de colère et se récria, scandalisé : « Monseigneur, il ne s’agit ni de progressisme, ni d’intégrisme mais de la vérité. » — « La vérité, voilà bien un grand mot, un mot de théologien, mon père !» » Aujourd’hui, le P. Garrigues commente : « N’a‑t-on pas l’impression, quarante ans après, que dans l’Eglise de France, par un retour du balancier et au nom du même opportunisme, la prophétie du cardinal Marty n’est pas loin de s’accomplir ? Le plus désolant c’est que personne ne fasse remarquer que c’est la formation traditionaliste d’avant le concile qui a produit les prêtres contestataires de 1968 et que les même causes produiront de nouveau les mêmes effets » (p. 132).
Cette tendance de son autobiographie n’aurait rien qui étonne le lecteur si, dans le même ouvrage, le P. Jean-Miguel Garrigues ne développait des analyses très précises et sans complaisance sur les effets intrinsèques du concile et la transformation de ses contemporains. Sans aller jusqu’à citer Bossuet — « Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles continuent à chérir les causes » —, comment le lecteur doit-il interpréter une phrase comme celle-ci : « On commençait à parler beaucoup à cette occasion [du concile] et de manière bien floue du dialogue entre l’Eglise et le monde […]. Mais je percevais déjà, ici ou là, des signes qui montraient avec quelle facilité on risquait de passer d’un vrai dialogue, qui ne peut exister qu’au sein d’une commune recherche de la vérité, à un alignement mimétique des catholiques sur leurs divers interlocuteurs : chrétiens séparés, membres d’autres religions, communistes… » (p. 94) ?
La vie d’étude au Saulchoir apparaît, dans ce récit, particulièrement instructive sur la période précédant mai 1968, puis sur celle des événements mêmes. Ainsi, l’auteur nous fait-il comprendre la très grande difficulté des séminaristes, ne serait-ce que pour appréhender en première année l’introduction à la philosophie. A telle enseigne que le père entrera en philosophie par Heidegger, Husserl, Gadamer et Merleau-Ponty. Le P. Claude Geffré, régent des études, « sentant les limites du néothomisme du XXe siècle [essayait] d’opérer des ouvertures dans la pensée de saint Thomas à l’aide de la phénoménologie heideggérienne ». A l’inverse de ceux enseignant « correctement le thomisme » mais de façon mécanique, deux jeunes professeurs passionnants étaient cependant « acquis l’un à Kant, l’autre à Hegel […] l’un d’eux était déjà en cure psychanalytique et les deux devaient quitter les ordres […] ». J.-M. Garrigues avoue n’avoir compris la substitution de la phénoménologie à la métaphysique que bien plus tard. Avec le « défaut de renouvellement de la synthèse thomiste dans le domaine proprement théologique » et le souvenir de la mise à l’écart du P. Chenu ((. « Le danger que comportait la pensée théologique du père Chenu s’était manifesté dans une phrase malheureuse mais significative de son livre Le Saulchoir une école de théologie […] où il disait que le dogme est la cristallisation de la spiritualité d’une époque. Cet historicisme ne distinguait pas le rôle simplement dispositif du contexte historique dans le développement dog-matique par rapport au rôle proprement déterminant des vérités contenues dans la Révélation et que les dogmes ne font qu’expliciter. Le Saint-Office y vit le signe d’une dérive moderniste… » (p. 118). )) puis de deux de ses disciples les pères Congar et Féret, le malaise dans l’enseignement et la vie au séminaire basculèrent, en mai 1968, dans l’ébranlement de la foi et la révolution. Les nouveaux maîtres du moment sont Marx, Nietzsche et Freud, les structuralistes Foucault, Lacan, Althusser, le professeur de théologie morale est « converti à la psychanalyse », etc. J.-M. Garrigues confirme qu’il n’a pour cette raison « étudié la partie morale de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin que bien après et par [ses] propres moyens, alors [qu’il] était devenu entre-temps… docteur en théologie » (p. 120). Le père maître, Albert-Marie Besnard, une haute figure spirituelle, suivra lui-même une évolution particulière puisque, ébranlé par le rejet de la spiritualité par ses jeunes frères, il tentera « de couler l’oraison chrétienne dans la méditation zen ».
L’auteur se révèle excellent observateur du processus visible de la décadence mais dont l’origine est bien plus profonde. L’élite montre le mauvais exemple — le poisson pourrit par la tête — puis vient la « perte des repères de la morale commune [qui coïncide] avec la généralisation de la télévision en France dans les débuts des années 60 », la complaisance-démission des générations précédentes face à l’activisme révolutionnaire de jeunes gens agissant comme les « possédés » de Dostoïevski, la primauté donnée au contexte dans l’enseignement théologique, la faveur pour la spiritualité orientale, sans oublier « l’opportunisme pastoral » des évêques. L’autorité au sein même du Saulchoir était alors sapée par l’assemblée générale quotidienne sans but ni ordre du jour autre que la prise de la parole. Après une telle déferlante, la fermeture rapide du Saulchoir s’imposera, ce que le P. Garrigues, honteux de l’attitude intellectuelle de sa génération en mai 68 et contre laquelle il tenta de résister, décrit comme « la mort qui avait frappé, le plus souvent jusqu’à l’anéantissement tous les centres intellectuels de la formation du clergé français : Dominicains, Jésuites, Sulpiciens, Oratoriens, Carmes, Franciscains et même certains monastères de haut niveau culturel, comme En-Calcat ou la Pierre-qui-Vire » (p. 135). Il est vraiment étonnant dans ce cadre général qu’au couvent du Saulchoir, « même en plein milieu de Mai 1968, le rythme des offices [se soit] maintenu imperturbablement ». Ce paradoxe intéressant éclaire toute situation d’ordre révolutionnaire dont les premiers soubresauts perceptibles ne marquent finalement que la fin de l’activité souterraine et invisible : pour le processus révolutionnaire l’institution est utilement encore debout mais elle est déjà gangrenée.
Le P. Garrigues cherchera à combattre, notamment à Paris, la dérive gnostique de l’enseignement théologique. Cela ne l’empêchera pas de tâter du pentecôtisme (ultérieurement renommé Renouveau charismatique), alors qu’il percevait pourtant « le risque de glissement du Renouveau catholique vers une « protestantisation » évangélique de type fondamentaliste, adogmatique et « émotionnaliste » ». A partir du début des années 1970, transparaît chez lui l’impression d’une bouillonnante instabilité (paroisses semi-monastiques Saint-Jean-de-Malte d’Aix-en-Provence, puis Saint-Nizier à Lyon, contacts avec les « blessés de la vie », travaux théologiques lors du synode des évêques de 1971, contribution à la rédaction du Catéchisme de l’Eglise catholique, amitiés intellectuelles avec Jacques Maritain, Christoph Schönborn, Alain Besançon, conférences de carême à Notre-Dame au terme desquelles il refuse l’offre du cardinal Lustiger d’une mission ecclésiale de grande importance (évoluant sans doute vers l’épiscopat) pour conserver son état religieux redevenu monastique, errances sur « l’antijudaïsme historique de la Chrétienté » et rapports avec des Juifs messianiques.
« La providence a voulu faire de moi un homme qui doit marcher sans trop de bagages par des chemins resserrés. Ce côté précaire et parfois même nomade de ma vie, n’était pas pour dérouter quelqu’un qui, comme moi avait été appelé par Dieu à travers la figure du père de Foucault » (p. 329). Reste que l’épilogue de son passionnant propos révèle un noir désenchantement tant en ce qui concerne la société (« Décadence des élites, ensauvagement des masses, terrorisme en expansion, esprit capitulard d’un âge qui se déclare post-héroïque, tous ces signes pourraient bien indiquer qu’un monde touche à sa fin ») que l’Eglise, pour laquelle son propos se fait encore plus maussade. « Contrairement à ces pasteurs qui nous annoncent périodiquement qu’elle connaît un « printemps », je la vois plutôt entrée en agonie. […] le plus expressif de cette entrée en agonie de l’Eglise est que la masse des chrétiens […] ne sait plus à quoi elle croit, ni pourquoi elle croit ». « [La] nouvelle évangélisation est de fait souvent mise en œuvre sous la forme d’une agitation utilisant toutes les recettes pastorales, jusqu’aux gadgets les plus suspects : goût pour le sensationnel et le spectaculaire, pour les figures spirituelles médiatiques drainant des foules à l’enthousiasme creux, recherche des moyens du monde pour conditionner les fidèles […]. Utilitarisme à court terme qui ne peut pas être porteur d’une vraie et durable fécondité ». Mais ce constat sans fard serait-il aussi désabusé s’il n’était le secret aveu d’une illusion perdue ?







