Un théologien sorti de l’ombre. Johann-Sebastian Drey
[note : cet article a été publié dans catholica, n. 98, pp. 133–135]
Certains auteurs sont des références, leurs œuvres occupent de la place dans les rayons des bibliothèques. Par fois, on tombe sur un auteur moins ou pas du tout connu, dont un livre relativement bref compte autant ou plus que les nombreux volumes des autres. Johann-Sebastian Drey était célèbre en son temps. Co-fondateur de la faculté théologique de Tübingen, en 1817, ainsi que de sa revue, la plus ancienne des revues de théologie paraissant de nos jours, il mérita l’estime des universitaires tant catholiques que protestants, ainsi que celle des autorités, et passa très près de l’épiscopat. 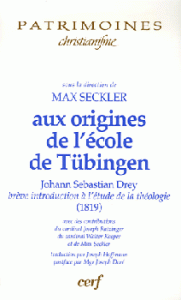
Puis son nom fut oublié au profit principalement de Johann-Adam Möhler, lequel fit école, comme on sait, auprès de nombre de théologiens dont certains influencèrent, sinon toujours les conclusions, du moins les débats des Pères du dernier concile. Or, la source profonde de ce courant si fécond, sans retirer à Möhler son mérite propre, apparaît de plus en plus comme étant Drey lui-même, dont on publie en traduction la remarquable Brève Introduction à l’étude de la théologie, que des noms comme Walter Kasper ou Joseph Ratzinger viennent honorer de leurs commentaires élogieux ((. Max Seckler (dir.), Aux origines de l’école catholique de Tübingen. Johann Sebastian Drey. Brève introduction à l’étude de la théologie (1819). Présentée et introduite par Max Seckler. Avec des contributions du cardinal Joseph Ratzinger, du cardinal Walter Kasper et de Max Seckler [ainsi que des textes de P. Chaillet, M.-D. Chenu, Y. Congar et P. Godet]. Traduction par Joseph Hoffmann. Postface par Mgr Joseph Doré, Coll. Patrimoines christianisme, Cerf, mars 2007, 398 p., 39 €.)) .
Comme le titre l’indique, le propos de Drey est d’introduire, mais au sens précis du mot, mais en pensant que c’est à toute la théologie qu’il introduit, à son objet, à sa méthode, comme aux conditions de la compétence du théologien. D’autre part, autant il est vrai que la théologie est présentée ici comme une science qui demande de grandes qualités ainsi qu’une peu commune consécration de toute la personne, autant il demeure qu’elle a un but éminemment pratique. Aussi trouvons-nous un programme d’études catéchétiques, liturgiques, homilétiques, pastorales et toute l’arborescence des matières requises pour s’acquitter de la tâche de fonctionnaire, ministre, pasteur de l’Eglise. Sous ces termes peu poétiques en eux-mêmes se cache un sens aigu de la vocation sacerdotale et un amour ardent de l’Eglise catholique, présentée comme celle en qui se trouve aujourd’hui l’essence de l’Eglise primitive, d’autant plus convaincant qu’à aucun moment quoi que ce soit dévalorise les autres confessions. On comprendra aisément comment une telle œuvre a pu, directement ou plus probablement indirectement, retentir jusqu’à l’aula conciliaire. Les partisans ardents de Vatican II y trouveront certainement leur compte, mais beaucoup devront glisser sur des passages qui remettent sereinement en cause telle ou telle de leurs options. Par exemple, au sujet de la liturgie, qui doit s’adapter à son temps, mais selon des changements qui ne peuvent jamais se faire qu’insensiblement.
On rejoindrait ainsi la position qui fut celle du cardinal Ratzinger, selon laquelle la liturgie n’est pas susceptible d’être réformée. L’idée de réforme est d’ailleurs typiquement protestante. La contribution de W. Kasper présente de façon suggestive, à propos de Möhler, la différence entre la notion catholique d’une Eglise où « subsiste » la vérité entière et celle, protestante, d’une Ecclesia semper reformanda. Il y a matière à un débat qui fasse droit aux légitimes requêtes de la bonne foi éclairée des uns et des autres sans abdiquer la recherche d’une unité dans la vérité.
Dans la Brève Introduction se trouve certainement une base fiable pour un travail œcuménique qui ne soit pas une partie de dupes. L’impression qu’elle produit est celle d’un grand élan intellectuel et spirituel. La théologie recommence à frais nouveaux, et ce en pleine époque de désaffection, en partant dans une indéniable mesure, de l’esprit du temps, c’est-à-dire du courant romantique allemand (qu’il ne faut pas confondre avec le romantisme français, surtout littéraire, alors que celui-là est théologico-philosophique et cherche une structuration au-delà du kantisme), mais pour lui répondre sur son propre terrain. N’est-ce pas ce qu’avait fait saint Thomas avec Averroès et l’aristotélisme ?
Drey entreprend de répondre à Schleiermacher, de donner un équivalent catholique à l’entreprise protestante de fonder la théologie, ou de la refonder, en particulier sur le plan épistémologique. Comme le montre à l’envi Max Seckler dans son commentaire, il n’y a pas trace dans la Brève Introduction d’influence de la pensée de Schleiermacher, contrairement à une légende tenace. A l’époque où il rédige la Brève Introduction, Drey s’est affranchi de toute influence de cet ordre. Le même M. Seckler souligne l’équilibre de sa position entre rationalisme et traditionalisme.
Drey a pu exercer une durable influence qui marquera, mais en arrière-fond, une évolution intellectuelle qui, bon an mal an, nourrira certains thèmes de Vatican II. Mais il n’y a pas chez lui de dilemme entre la rationalité et la positivité théologique, dilemme qui donnera lieu aux malentendus autour du modernisme en philosophie. Pour lui, la raison humaine est naturellement disposée à la révélation, ce qui n’entraîne aucune diminution de l’aspect historique de la religion chrétienne, aspect qui fait de l’Eglise catholique la continuatrice de l’Eglise apostolique. Le nom de Drey s’était effacé au profit de celui de Möhler, en grande partie peut-être, mais en partie seulement, son héritier. La contribution de Walter Kasper explicite le rôle de ce dernier dans la question œcuménique. C’est Möhler qui a lancé la notion d’unité différenciée, de l’enrichissement de la catholicité non par un simple « retour » confessionnel en arrière, mais par la réconciliation en avant des tensions qui provoquèrent la dispersion confessionnelle. Ainsi, la catholicité ne doit plus être envisagée d’un seul point de vue, beaucoup trop restrictif, de confession. Distinction essentielle, qui n’est pas absolument nouvelle, mais, dans cette perspective, faut-il alors comprendre l’Eglise catholique comme une « confession » qui doit, en s’unissant aux autres, devenir la véritable Eglise catholique — qu’elle ne serait encore, par conséquent, qu’inchoativement — ou, au contraire, qu’elle est bien, fondamentalement et en acte, l’unique Eglise du Christ, douée de la véritable catholicité, laquelle peut en contrepartie être préjugée inchoativement présente dans les autres confessions en tant que leurs membres aspirent à la catholicité, qu’ils y tendent, dans cette tension même que leur attachement confessionnel semble éloigner d’elle ? Telle semble en effet, au-delà de toute polémique, la manière dont se présente la question. A coup sûr, c’est la deuxième réponse que Drey accepterait, ou une réponse approchante.
Il peut sembler édulcorant d’affirmer sans plus, avec W. Kasper, que les réformateurs ne voulurent pas créer de nouvelle Eglise. Certes, ils prétendirent réformer une Eglise existante, mais ce fut en la déclarant antéchristique. Le résultat, tant d’un point de vue logique que d’un point de vue historique, ne fut-il pas la création d’Eglises qui n’existaient pas au prix de la réduction à zéro, du moins dans leur esprit, d’une Eglise existante ?
Pour terminer, il ne faut pas passer sous silence que, à une époque de crise entre le monde politique et le monde religieux, Drey se situe complètement en dehors du courant appelé « restaurationniste ». Ce courant semble avoir fini par perdre la partie, en particulier avec le décret conciliaire dit sur la liberté religieuse. L’honnêteté interdirait toutefois de considérer le débat de fond comme définitivement clos. A ce propos justement, il n’est pas certain que la manière, du reste extrêmement posée et sage, dont Drey envisage la vie de l’Eglise séparée de l’Etat et réciproquement, tout en semblant régler de manière pacifique un conflit toujours menaçant, réponde à une question fondamentale, aussi bien théologiquement qu’historiquement, ni même la soulève vraiment, ce que fait de son côté un Soloviev lorsqu’il donne au terme de théocratie sa véritable portée, non point idéologique ou sociologique, mais théologale. Il n’y a aucune résolution fiable à attendre de la crise sociale toujours prête à entrer en éruption tant que l’autorité civile, qui ne peut avoir de véritable légitimité que scellée par Dieu, ne soumet pas ses principes d’exercice à l’autorité spirituelle, c’est-à-dire, que cela enchante ou non, à l’Eglise. Si cela n’est pas, on finit par assister à des tentatives de subversion de la part de théocraties d’exportation, à force, de la part d’un Etat laïciste, de vouloir se présenter en fait comme le substitut légitime d’une Eglise considérée comme périmée et l’exploiter en lui imposant la morale qu’il veut.







