Un christianisme sans Christ
[note : cet article a été publié dans catholica, n. 83, pp. 130–133]
On saura gré à l’abbé Jean-Marc Aveline ((. Jean-Marc Aveline, L’Enjeu christologique en théologie des religions. Le débat Tillich-Troeltsch, coll. Cogitatio Fidei 227, Cerf, 2003, 40 €.)) d’offrir à un public averti un exposé clair du débat au sein du protestantisme à propos de l’absoluité du Christ. Cette grande querelle a commencé au début du XXe siècle lorsque le protestantisme libéral, ayant fait siennes la philosophie des Lumières et l’Aufklärung, chercha à rendre compte de l’originalité du christianisme parmi les autres religions. Pour le théologien Ernst Troeltsch, les nouvelles méthodes (pour son époque) de l’histoire des religions ruinent définitivement toute prétention du christianisme qui ne peut être soustrait aux lois communes de la science historique (cf. p. 75). Même les éléments fondateurs les plus spécifiques aux yeux des croyants « sont cependant susceptibles de résulter d’adaptations de croyances antérieures ou étrangères » (p. 77). Ainsi, tout dans l’évolution du christianisme s’explique par une adaptation au contexte intellectuel du moment. L’irruption de ces nouvelles méthodes provoque donc un ébranlement profond. Le caractère surnaturel, ou absolu, de la révélation chrétienne (c’est Dieu qui prend l’initiative de s’adresser à l’homme en le sauvant) ne peut donc être établi par l’historien. Que Jésus soit la seule révélation de Dieu et qu’il ait opéré le salut du monde, voilà deux affirmations dogmatiques qui, à leur tour, devront être passées au crible de la critique historique pour être éventuellement abandonnées (cf. p. 167). 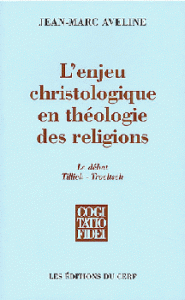
Dès lors, il faut chercher ailleurs le fondement rationnel de la croyance religieuse. Troeltsch croit pouvoir l’établir dans la psychologie humaine. Or il y a dans le cœur de l’homme une croyance véritable par laquelle il domine la nature : « Je crois que dans ce chaos apparent, c’est la profondeur divine de l’esprit humain qui se révèle sous plusieurs aspects », écrit ou plutôt professe-t-il. Au sein de ce chaos, les valeurs que l’on peut dégager du christianisme par une analyse historique rigoureuse témoignent d’une percée vers l’absolu (cf. p. 156). Le christianisme représente donc une étape dans l’histoire universelle de l’esprit.
On sait que le protestantisme libéral provoquera la réaction confessante et radicale de Karl Barth. C’est à lui, tout autant qu’à Troeltsch, que Paul Tillich répond, cherchant entre ces deux extrêmes à dégager une voie médiane. Seulement, et ce travail le montre, la symétrie n’est pas parfaite. En effet, Tillich se range plutôt du côté du protestantisme libéral et n’adoptera jamais les positions principales de la théologie barthienne.
Tillich commence sa réflexion à l’occasion d’un cours donné à l’Université de Marbourg dans les années 20. Mais c’est un sujet sur lequel il reviendra tout au long de sa carrière, y compris à partir de novembre 1933 où il s’exile aux Etats-Unis. Comptera aussi beaucoup pour lui un voyage au Japon en 1960. Sa relecture de Troeltsch veut tenir compte du nouveau contexte historique issu de la Grande Guerre (naissance du socialisme protestant dont Tillich est partie prenante). Le christianisme se trouve dans une situation de crise qui est aussi un moment favorable, un kairos. La théologie ne peut plus être seulement réactive mais elle doit passer à l’offensive. Tillich reconnaît l’apport de Barth en affirmant que la théologie doit rendre compte de l’irruption de l’inconditionné (c’està-dire Dieu dans la formulation tillichienne) et que cette irruption ne peut être saisie que de façon paradoxale et dialectique. Cependant il veut aussi prendre en compte (à la différence du théologien bâlois) la création et la culture. En 1925, il élabore un projet de dogmatique en trois volets (il ne donnera effectivement que les deux premiers) : création, rédemption, accomplissement (cf. p. 303). A la différence de Troeltsch, il cherche donc à réfléchir à l’intérieur de la foi. Pour cela, il faut chercher l’essence de la Révélation (ou révélation parfaite) et étudier quel rapport chaque religion établit avec cette essence. Or chaque religion (ou plutôt chaque révélation) est soumise à un double mouvement : elle peut céder à une profanisation (elle devient alors réductible à la culture) ou encore à la démonisation (elle s’auto-absolutise) : « La voie de salut est certes celle qui mène à l’inconditionné, et elle parle de l’inconditionné ; mais en tant que voie, elle parle aussi d’elle-même » (p. 376, la formule est de Tillich lui-même).
C’est ici que la figure du Christ intervient, ou plutôt la relation paradoxale qu’entretiennent au sein du christianisme Jésus et le Christ. En Jésus, purus homo, l’union entre un homme et l’inconditionné est apparue dans l’histoire. Entre lui et nous, il y a une différence existentielle, mais non ontologique (cf. p. 466) : « La caractéristique foncière de cette personne est d’être totalement soumise à la création de créature tout en étant entièrement unie à l’inconditionné » (p. 467). Mais, par le oui à la Croix, Jésus renonce au démonique, c’est-à-dire à l’absoluité de la révélation qu’il porte. Voilà pourquoi la théologie protestante place la Croix (ou la kénose) au centre de sa réflexion : « Puisque la croix du Christ marque la victoire contre le démonique, à savoir l’irruption de la révélation, elle affirme et nie toutes les voies de salut, y compris la sienne propre. La Croix, au sens où elle exprime la protestation contre toute prétention à l’inconditionné de la part des formes conditionnées, c’està-dire la protestation contre l’idolâtrie, est le critère décisif non seulement de la christicité de Jésus mais aussi de la signification universelle de la proclamation chrétienne » (pp. 501–502).
Le dialogue entre différentes traditions religieuses devient créatif pour chacune de ces traditions elles-mêmes, y compris pour le christianisme. En effet, par ce dialogue, chaque religion reconnaît ce qu’il y a en elle de percée vers l’infini, d’irruption de l’inconditionné, mais aussi de démonisation et de profanisation. Les grands concepts chrétiens rendent compte de ce phénomène complexe, mais rien ne dit que l’on ne puisse trouver chez d’autres cette même réalité.
On notera pour finir que Tillich, plus sans doute que son interlocuteur Troeltsch, est sensible non seulement au dialogue avec les autres traditions religieuses mais aussi avec une société culturellement sécularisée au sein de laquelle il cherche la présence de la religion, élaborant une théorie générale de la corrélation entre l’une et l’autre.
Jean-Marc Aveline termine son travail par quelques considérations critiques. Et notre recension ne rend évidemment pas compte de la grande richesse de cette recherche. On comprend bien l’intérêt de la théologie de Tillich pour la réflexion chrétienne sur le pluralisme des religions. Lui-même écrivait dans sa période américaine : « Une théologie chrétienne incapable d’entrer dans un dialogue créatif avec la pensée théologique des autres religions manque une occasion historique et reste provinciale » (p. 513). Cependant on aura compris que cette belle cohérence s’appuie sur des présupposés théologiques absolument pas critiqués (ce n’est d’ailleurs pas le but de l’ouvrage) mais qui restent difficilement acceptables, voire assimilables, dans une perspective catholique. La rupture établie par le protestantisme libéral entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi oblige le théologien à reconstituer une christologie cohérente en faisant fi du donné révélé transmis par le témoignage scripturaire et évangélique, lui-même soumis à une critique radicale de type rationaliste et idéaliste. On comprend dès lors qu’une théologie réformée confessante, fidèle aux principes luthériens ou calvinistes, frémisse en découvrant une pensée à ce point alignée sur le modèle culturel issu des Lumières. Les grands événements du Salut deviennent les symboles de la lente émancipation de l’esprit humain qui s’épuise à chercher les conditions a priori de son propre fonctionnement. La critique de Karl Barth, pour cinglante qu’elle soit, vise juste : « Pour nous, le Christ est l’histoire du Salut, l’histoire du Salut elle-même… Pour Tillich, il est la représentation, dans une puissance symbolique parfaite, d’une histoire du Salut se réalisant plus ou moins toujours et partout » (cité p. 307).
De même les réserves que l’on fera sur une christologie kénotique de type hégélien (le Christ renonce à son être sur la Croix, anéantissant du même coup toute tentation de démonisation, c’est-à-dire d’absolutisation de la religion) ne permettent pas d’accepter les conclusions que Tillich tire de celle-ci pour ce qui est du dialogue interreligieux. Encore une fois, il est demandé au chrétien de renoncer à ce qui fait le centre du christianisme (un homme qui se prétend Dieu et dont la résurrection atteste la vérité de son message et de sa mission) pour pouvoir entrer en contact avec les autres religions. Et comment dialoguer avec la modernité si de prime abord on lui concède tout ?
Tillich souhaite que la théologie chrétienne reprenne l’initiative en passant à l’attaque (cf. p. 231). Une offensive qui commence par une capitulation en rase campagne…







