Rome et la Révolution française
[note : cet article a été publié dans catholica, n. 88, pp. 150–152].
Gérard Pelletier, prêtre du diocèse de Paris et professeur à l’Ecole cathédrale, publie, dans la belle collection de l’Ecole française de Rome, sa thèse de doctorat soutenue en 2002 à Paris IV et à l’I.C.P. sur les réactions romaines à la Révolution française ((. Gérard Pelletier, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789–1799), Rome, Ecole française de Rome, 2004, 769 p., 66 €.)) .
Une partie introductive présente Pie VI, la Curie et les congrégations particulières pour les affaires de France créées à partir de 1790, afin de bien marquer les nombreux antécédents historiques et doctrinaux de la crise, en France, Allemagne et Italie. La deuxième partie, de 1789 à 1791, considère la Constitution « civile » du Clergé, la question du recours au Pape, le travail desdites congrégations romaines, en septembre et décembre 90, puis la rupture, autour des brefs Quod 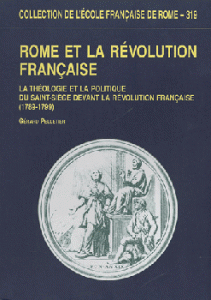 aliquantum et Caritas et de la perte d’Avignon. Après une longue analyse plus théologique, une quatrième partie décrit les suites de cette rupture, entre l’été 91 et l’été 93, en particulier les rapports à l’épiscopat légitime, à l’Eglise constitutionnelle, aux serments, au danger d’occupation française et au régicide du 21 janvier. La dernière, de 93 à 99, achève la chronologie avec la diplomatie pontificale face aux Puissances, les relations avec le Clergé, les tribulations de Pie VI jusqu’à la mort à Valence. Un aperçu des premières relectures théologiques, dès 99, toutes centrées sur une providentielle exaltation de la primauté contre les conceptions gallicanes (moralement corroborée par le « martyre » du Pape) vient clore le tout, avant que la conclusion générale n’insiste sur la période comme tournant décisif de la théologie romaine. Car G. Pelletier ne cherche pas seulement à ressusciter l’intéressante figure de Pie VI, dans la ligne des commémorations de 1999, ni à faire mieux connaître de grands fonds d’archives trop ignorés (synthèse des sources, pp. 7–28), il veut encore montrer la complexité des problèmes théologiques posés au Pape et à son entourage par le cours des événements, en vue de renouveler la compréhension « des étapes qui conduisirent la théologie catholique aux définitions de Vatican I en 1870 » (p. 1).
aliquantum et Caritas et de la perte d’Avignon. Après une longue analyse plus théologique, une quatrième partie décrit les suites de cette rupture, entre l’été 91 et l’été 93, en particulier les rapports à l’épiscopat légitime, à l’Eglise constitutionnelle, aux serments, au danger d’occupation française et au régicide du 21 janvier. La dernière, de 93 à 99, achève la chronologie avec la diplomatie pontificale face aux Puissances, les relations avec le Clergé, les tribulations de Pie VI jusqu’à la mort à Valence. Un aperçu des premières relectures théologiques, dès 99, toutes centrées sur une providentielle exaltation de la primauté contre les conceptions gallicanes (moralement corroborée par le « martyre » du Pape) vient clore le tout, avant que la conclusion générale n’insiste sur la période comme tournant décisif de la théologie romaine. Car G. Pelletier ne cherche pas seulement à ressusciter l’intéressante figure de Pie VI, dans la ligne des commémorations de 1999, ni à faire mieux connaître de grands fonds d’archives trop ignorés (synthèse des sources, pp. 7–28), il veut encore montrer la complexité des problèmes théologiques posés au Pape et à son entourage par le cours des événements, en vue de renouveler la compréhension « des étapes qui conduisirent la théologie catholique aux définitions de Vatican I en 1870 » (p. 1).
L’analyse doctrinale (pp. 191–318), en effet, est au centre de l’étude, complétée par les considérations actualisantes sur le « tournant » (pp. 515–536). La rupture, dit G.Pelletier, trouve une explication majeure dans l’opposition de la théologie romaine et des courants réformistes caractéristiques de la période 1786–1794 : gallicans, richéristes, jansénistes, fébronianistes, juridictionnalistes, joséphistes, nébuleuse difficile à combattre mais dont Rome se servira pour avancer, spécialement par le bref contre Eybel (1786), la Responsio sur les nonciatures d’Allemagne (1789) et la bulle contre le synode de Pistoie (1794). Reprenant ou complétant les travaux de Neveu et d’Alberigo, un excellent chapitre présente l’école romaine d’ecclésiologie de cette époque, marquée par la production éditoriale intense de théologiens et historiens de bon niveau (Christianopoulo, Mamachi, Zaccaria, Bolgeni, Spedalieri, Gerbert). Ceux-ci préféreront l’analogie trinitaire à l’analogie politique pour penser l’Eglise et la primauté (Christianopoulo, Bolgeni) ; reconnaîtront un statut fort à l’épiscopat (Christianopoulo), en termes de communion ou de « Corps mystique » (Gerbert, Gerdil) ; insisteront sur la monarchie pontificale (Bolgeni) ; admettront le contrat social de Rousseau et le tyrannicide en politique, l’Eglise restant alors médiatrice entre les peuples et les princes (Spedalieri, quelque peu soutenu par Pie VI…), tout en excluant son application en ecclésiologie (Gerdil) ; refuseront de concevoir l’Eglise comme une monarchie (Gerbert)… Forts de cet acquis théologique assez diversifié comme on le voit mais toujours favorable au pontife romain (primauté, distinction du pouvoir d’ordre et du pouvoir de juridiction, primat de la puissance spirituelle surla temporelle, justification théologique des cas réservés au Saint-Siège…), le Pape et la Curie seront à même de porter un jugement négatif autorisé sur l’Eglise constitutionnelle et le schisme, non sans l’appui, réputé providentiel, d’une part non négligeable de l’épiscopat gallican, opposé à la Constitution civile.
Quelques remarques. Le discours se ressent de l’« à peu près » caractéristique de la forme orale ; des coquilles nombreuses (et parfois de vraies fautes) tant en français qu’en latin, des traductions un peu rapides de l’italien le déparent sensiblement. Vu la qualité du contenu et le prestige de la collection, c’est un peu dommage. Il reste que ce travail d’envergure, assorti d’annexes considérables (textes, prosopographie des cardinaux, sources), où histoire documentée et doctrine s’articulent et s’approfondissent mutuellement, permet de remettre plus que jamais en cause le jugement sur Pie VI d’un Mathiez trop peu théologien (on peut ajouter celui de P. et P. Girault de Coursac, repris trop passionnellement au célèbre historien, dans leur intéressant Louis XVI et la question religieuse pendant la Révolution, Paris, O.E.I.L., 1993). En effet, comparés aux enjeux religieux, le souci compréhensible de récupérer Avignon et l’option contre-révolutionnaire même (qu’on la tienne ou non pour légitime) semblent assez seconds dans les intentions pontificales. Sur ce point comme sur d’autres, les démonstrations de l’auteur sont convaincantes.
On reste un peu déçu touchant les relations des principaux prélats à Louis XVI. L’auteur est presque évasif (pp. 113 et 115) sur la correspondance de Boisgelin entre le 12 et le 14 juillet 90, où l’archevêque demandait au souverain de ratifier la Constitution civile du Clergé, mais après la fête de la Fédération, pour permettre aux évêques d’y prêter serment sans les restrictions sur le spirituel et leur éviter ainsi le bannissement ou autres représailles. Bon moyen sans doute, en cas d’échec, de laisser charger le Roi pour avoir signé ou, en cas de réussite, de jouir du prestige de le lui avoir ordonné (ordre auquel ce dernier semble faire allusion dans son testament). Juste ou non, cette accusation (brandie par les Girault de Coursac mais peu et mal critiquée dans la réédition de la Constitution civile du Clergé et des Brefs par J. Chaunu, Pie VI et les évêques français. Droits de l’Eglise et Droits de l’Homme. Le Bref Quod aliquantum et autres textes, Critérion, 1989, note 28, p. 21), eût mérité sous la plume de G. Pelletier au moins une page d’examen rigoureux.
Montrant bien que Rome, dans sa visée surtout anti-janséniste, n’expliqua guère l’actualité par un complot franc-maçon, l’ouvrage incite à mieux mesurer la diversité interne du discours contre révolutionnaire, voire à réétudier Barruel ou Proyart en croisant utilement leurs conceptions avec les points de vue romains.
Sur le fond, l’auteur dénonce (mais avec mesure et non sans critiquer sérieusement par ailleurs les tendances réformistes de l’époque) l’opposition de Rome à la liberté de conscience et la pauvreté conceptuelle de son ecclésiologie. Le principe interprétatif mis en œuvre est évidemment Vatican II, tant pour le rapport de l’Eglise à la Modernité que pour une juste conception d’elle-même. La chose est en soi défendable, l’histoire de l’Eglise ayant nécessairement une continuité providentielle, même et surtout dans ses tâtonnements et contradictions ; elle reste périlleuse par les projections qu’elle peut faire opérer sur le passé. On ne saurait, bien sûr, nier les limites des conceptions promues alors, souvent dans la polémique, par Pie VI et ses collaborateurs, cinquante ans ou plus avant les profondes et durables — et beaucoup plus sereines — réflexions de Möhler ou Newman sur l’Eglise, la Tradition, le dogme. Mais en gardant la vision providentialiste (ou « croyante », si l’on préfère) avouée par l’auteur en introduction, on peut penser que Pie VI n’avait pas d’abord à retrouver l’ecclésiologie de communion mais à défendre la dimension hiérarchique de Eglise contre le dogme de la souveraineté populaire et le modèle du contrat social (ce que l’auteur concède plus ou moins çà et là, par exemple pp. 316–317). Quand le Pape « penche pour le peuple » dans la question de la souveraineté (p. 261), ce n’est point, on le sait, parti pris pour la démocratie mais utilisation de la thèse thomasienne ou bellarminienne du peuple canal de cette souveraineté venue de Dieu, en vue de négocier avec les pouvoirs révolutionnaires tout en s’opposant au gallicanisme politique (au droit divin des rois), sur fond de monarchie maintenue comme « le meilleur des régimes » (comme l’affirme la consistoriale de juin 93).
D’ailleurs, certaines tendances actuelles fortes, favorables à l’encadrement et au contrôle strict du primat et de l’infaillibilité, au détriment possible de la liberté de parole nécessaire au pape devant les préjugés de la Modernité, et au nom même d’une ecclésiologie approfondie, montrent que les dangers combattus par Rome à l’époque n’avaient, sur le long terme, rien de chimérique.







