Le piège de la surenchère écologiste
[note : cet article est paru dans catholica, n. 103, pp. 140–142]
La Faculté de théologie d’Angers a organisé le 17 mai 2008 un colloque intitulé « Ecologie et création, enjeux et perspectives pour le christianisme d’aujourd’hui ». L’objectif affiché de ce colloque — dont les actes ont été publiés sous la direction de Mgr Stenger, évêque de Troyes ((. Mgr Marc Stenger (dir.), Ecologie et création, Université catholique de l’Ouest, Parole et Silence, octobre 2008, 18 €.)) — était de « montrer l’attrait du christianisme pour les problèmes écologiques, ses prises de positions actuelles, et les solutions qu’il entend apporter au débat public, au pot commun » (p. 10). Mais en réalité, il semble que l’objectif d’un certain nombre d’interventions était plutôt de disculper l’Eglise d’avoir ignoré, ou pire encouragé la destruction de la nature, en démontrant qu’au contraire, les catholiques ont été les pionniers de l’écologie, de « la protection de l’environnement » et du « développement durable ». L’approche à la fois « défensive » et « contre-offensive » de la problématique écologique peut ainsi 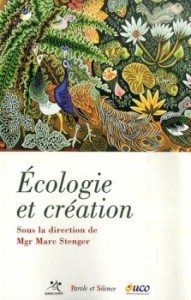 donner l’impression au lecteur que l’Eglise cherche à rattraper son retard et se lance maladroitement dans la surenchère écologique. A la pointe de l’épiscopat français sur les questions écologiques (notamment en tant que président de Pax Christi France), Mgr Stenger inaugure ce colloque en apportant une double réfutation : le christianisme ne reconnaît pas la tyrannie de l’homme sur la création et le Saint-Siège n’est pas coupable d’avoir gardé le silence sur la crise écologique contemporaine. Portée en 1967 par le professeur américain d’histoire médiévale Lynn Townsend White, la première accusation repose sur une interprétation malhonnête de la Genèse : en enseignant que Dieu a demandé à l’homme de « dominer » la Terre, le judéo-christianisme aurait justifié l’exploitation immodérée de la nature. Cette thèse a depuis été largement remise en cause ((. Voir par exemple Françoise Champion, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des Sciences sociales des religions, n. 90, avril-juin 1995, pp. 39–56. )) et l’on peut s’étonner que Mgr Stenger y consacre la moitié de son intervention. L’autre réfutation apportée par l’évêque de Troyes porte sur le prétendu silence du Saint-Siège en matière d’environnement. Pour disculper le Vatican, Mgr Stenger démontre que depuis le message adressé par Paul VI à la conférence de Stockholm en 1972, les papes n’ont jamais cessé de dénoncer la destruction de la nature et le gaspillage de ses ressources.
donner l’impression au lecteur que l’Eglise cherche à rattraper son retard et se lance maladroitement dans la surenchère écologique. A la pointe de l’épiscopat français sur les questions écologiques (notamment en tant que président de Pax Christi France), Mgr Stenger inaugure ce colloque en apportant une double réfutation : le christianisme ne reconnaît pas la tyrannie de l’homme sur la création et le Saint-Siège n’est pas coupable d’avoir gardé le silence sur la crise écologique contemporaine. Portée en 1967 par le professeur américain d’histoire médiévale Lynn Townsend White, la première accusation repose sur une interprétation malhonnête de la Genèse : en enseignant que Dieu a demandé à l’homme de « dominer » la Terre, le judéo-christianisme aurait justifié l’exploitation immodérée de la nature. Cette thèse a depuis été largement remise en cause ((. Voir par exemple Françoise Champion, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des Sciences sociales des religions, n. 90, avril-juin 1995, pp. 39–56. )) et l’on peut s’étonner que Mgr Stenger y consacre la moitié de son intervention. L’autre réfutation apportée par l’évêque de Troyes porte sur le prétendu silence du Saint-Siège en matière d’environnement. Pour disculper le Vatican, Mgr Stenger démontre que depuis le message adressé par Paul VI à la conférence de Stockholm en 1972, les papes n’ont jamais cessé de dénoncer la destruction de la nature et le gaspillage de ses ressources.
On termine ainsi la lecture de cette intervention avec l’impression que, comme tout le monde, l’Eglise a découvert les problèmes écologiques dans les années 1970, et qu’elle est désormais entrée dans la ronde écologiste. C’est d’ailleurs ce que semble accréditer la troisième partie du colloque consacrée à la création de la nature à travers l’art : les œuvres étudiées dans deux des trois interventions (tapisseries de Lurçat et de Dom Robert, ainsi que l’opéra Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen) datent de la seconde moitié du XXe siècle comme si les deux millénaires d’art chrétien qui ont précédé cette période n’existaient pas. Pourtant, la philosophie chrétienne n’a‑t-elle pas toujours promu un rapport harmonieux de l’homme avec la nature ? N’a‑t-elle pas toujours subordonné l’usage des biens naturels au respect de l’ordre naturel ? Rien de cela ne transparaît dans les interventions suivantes où les fioretti de saint François et la poésie de certains grands mystiques médiévaux sont présentés comme étant les seuls aspects écologiques de la tradition chrétienne.
Si l’on en croit Jean Bastaire, écrivain catholique estampillé, l’Eglise serait ainsi coupable de n’avoir pas laissé se développer la « théologie » avant-gardiste de saint François d’Assise : alors que le Poverello proclamait la fraternité de l’homme avec toutes les créatures de l’Unique Père commun de tous les êtres, saint Bonaventure aurait réduit cette paternité à un « principe premier » séparant l’homme de son environnement. La pensée franciscaine se serait ainsi privée d’une théologie bien plus respectueuse de la nature grâce à laquelle l’Eglise aurait pu être à l’avant-garde de l’écologie : « Qu’on imagine ce qu’un Nicolas Hulot pourrait faire aujourd’hui à la lumière de l’Evangile ! Mais aucun disciple de François n’a été invité au Grenelle de l’environnement » (p. 35).
Cette supposée théologie du Cantique de Frère Soleil est également reprise dans l’intervention suivante par Jean Gaillard, président de l’Association catholique pour le respect de la création animale. Ce dernier appelle de ses vœux un aggiornamento théologique de l’Eglise afin de tenir compte d’un prétendu changement des mentalités en ce qui concerne les animaux. Il faudrait que les théologiens s’interrogent sur « la nature des animaux : pourquoi n’auraient-ils pas des droits, différents de ceux des hommes mais réels ? Pourquoi le principe qui les anime, leur âme, serait-il anéanti à la mort ? » (p. 43). Il faudrait ainsi faire entrer dans le catéchisme « le devoir de respecter les êtres vivants […] et aussi de prier de temps en temps pour eux » (p. 42). Et cet aggiornamento serait d’autant plus urgent qu’un grand nombre de catholiques se sont paraît-il détournés de leur religion étant choqués par le silence voire l’hostilité de l’Eglise à la condition animale. Il faudrait donc que l’Eglise remette en cause sa théologie traditionnelle et notamment cette de saint Thomas d’Aquin, selon qui « seul l’Homme a une valeur réelle, étant créé à l’image de Dieu ; tout a été créé pour lui et il use de tous les éléments de l’univers, même des êtres vivants, librement en fonction de ses besoins et de ses intérêts » (p. 41).
Ces suggestions de Jean Gaillard reposent sur une méconnaissance manifeste de la théologie de saint Thomas d’Aquin : le Docteur Angélique n’a jamais soutenu que les animaux n’ont aucune valeur et que l’homme peut en faire n’importe quoi. Cette accusation convient beaucoup mieux à Descartes et à son mécanicisme selon lequel les animaux sont des « machines de terre » que l’homme peut démonter sans états d’âme. Pour saint Thomas, au contraire, il n’est permis de tuer les animaux que lorsque cela est nécessaire à un usage légitime (IIa, IIae, Q. 64, art. 1). Mais cela n’implique aucunement que l’homme doive mépriser les animaux : « Nous pouvons aimer de charité les êtres dépourvus de raison, comme des biens, que nous désirons pour les autres, en tant que, par la charité, nous voulons la conservation de ces êtres pour la gloire de Dieu et l’utilité des hommes. Et de cette façon Dieu les aime aussi de charité » (IIa, IIae, Q. 25, art. 3).
La principale carence de ce colloque porte ainsi sur un exposé clair et précis de la philosophie chrétienne de la création. Synthétisée (notamment par saint Thomas d’Aquin) avec la philosophie classique héritée de l’Antiquité, la philosophie chrétienne n’a pas à se justifier d’avoir été en retard ou en avance sur le mouvement écologiste. Fondée sur l’ordre naturel à partir duquel la raison peut reconnaître la loi naturelle, la philosophie chrétienne est intrinsèquement « écologique » (si l’on entend par écologie la science des mutuelles relations de tous les organismes vivants). Encadré par la loi naturelle et le droit naturel, l’usage des créatures par l’homme est strictement proportionné à l’ordre naturel des choses, ce qui exclut toute forme de gaspillage, de pollution irréversible ou de destruction gratuite. Une seule intervention aborde ce point en soulignant, mais de manière trop « timide », la dimension écologique de la philosophie antique (Pascal Mueller Jourdan, pp. 99–110).
Cela étant rappelé, en dehors d’une perspective historique, il est peu utile de chercher à démontrer, comme Olivier Landron, que certains catholiques ont été les pionniers de l’agriculture biologique (pp. 57–71), ou, comme Jean Pierre Ribaut, de se rassurer en récapitulant les actions des différentes Eglises d’Europe en matière d’écologie (pp. 47–56). Chercher à tout prix à montrer l’activisme écologique des catholiques et de l’Eglise risque en effet de conduire à la surenchère, c’est-àdire à l’écologie radicale dont les relents malthusiens voire terroristes sont pourtant bien décrits par Laurent Larcher (pp. 75–81). Les évolutions théologiques souhaitées en faveur de l’âme des animaux et de leurs droits confirment les dangers de ce mimétisme.







