Numéro 110 : La démocratie déclassée
Il est malaisé de dresser l’acte de décès d’un régime lorsque celui-ci n’est pas brutalement abattu par une révolution. La situation actuelle de ce qu’il est convenu d’appeler la démocratie libérale, avec son peuple souverain, électeur de ses représentants, laisse cependant très largement à penser que son temps s’achève. Le symptôme le plus évident de ce dépérissement est la perte du récit mythologique qui prétendait fonder définitivement ce régime politique : le thème de la « fin de l’histoire », qui, dans la suite de la chute du mur de Berlin, a voulu faire accroire que la démocratie libérale était désormais la seule forme d’organisation politique définitivement ouverte à l’humanité. 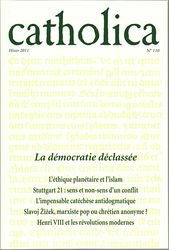
Les interventions politiques et militaires de la puissance américaine et de ses subalternes ne se rangent plus sous la bannière d’une expansion universelle de la démocratie, comme il y a moins de vingt ans dans l’ancienne Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan ; plus encore, les « démocraties illibérales », comme on appelle désormais avec crainte respectueuse les régimes autrefois qualifiés de dictatures – le régime chinois notamment – ne sont certes pas décrites comme un état de choses idéal, mais comme des institutions éventuellement adaptées aux mœurs des contrées qu’elles régissent, et dont, à tout le moins, le maintien peut être un mal nécessaire au fonctionnement paisible d’un système mercantile qui, lui, est bien devenu universel. Voilà qui entre apparemment en contradiction avec la persistance du caractère para-religieux de la démocratie. Si elle n’est plus un produit d’exportation, celle-ci supporte mal les critiques qui peuvent être formulées à son encontre. Pierre Manent résume bien la survivance de cette injonction : « Qui aujourd’hui entend prolonger les questions de la philosophie politique, qui cherche les critères du bon régime, c’est donc qu’il n’éprouve pas l’évidence de la bonté de la démocratie avec suffi samment d’intensité. Qui pose des questions, c’est lui qui va être interrogé par la démocratie, par la vigilance démocratique que cette religion suscite. Au lieu que la démocratie, comme toute autre chose, comparaisse devant le tribunal de la raison, c’est la raison, en particulier la raison qui questionne, c’est-à-dire la philosophie politique, qui comparaît devant le tribunal de la religion de l’humanité » (P. Manent, Le regard politique, entretiens avec Bénédicte Delorme-Montini, Flammarion, 2010, p. 210).
Ce n’est toutefois plus de la démocratie en tant que mode d’organisation politique qu’il s’agit, mais d’un système de « valeurs » dont la première, la tolérance universelle, est dotée de contours pour le moins flous, fort éloignés de l’idée d’institutions politiques, à moins de considérer la transmutation d’un système juridique en structure psychique.
Ce qui est entré en décomposition est donc bien le régime politique libéral, avec ses rites électoraux et ses partis, tel qu’il a été construit dans le contexte de la modernité politique ; mais la diffusion des principes qui ont concouru à son élaboration n’est pas pour autant remise en cause. Il n’est, à cet égard, que de voir l’extension indéfinie de la thématique démocratique : si la démocratie représentative est en déshérence, sont désormais parallèlement promues les démocraties sociale, économique, administrative, sanitaire, environnementale, délibérative, durable même, sans que ces quelques occurrences soient limitatives. Ce phénomène mérite qu’on s’y arrête quelques instants, dans les deux formes qu’il peut revêtir.
La première forme des nouveaux contours de la démocratie est constituée de la « participation ». La démocratie administrative prétend, par exemple, donner aux administrés non seulement un droit de regard – d’information – sur le fonctionnement d’une administration décidant hors d’eux, mais aussi leur conférer, par l’intermédiaire de procédures consultatives, de débats publics, de leur présence dans des commissions, de leur participation à des référendums consultatifs voire décisionnels, un pouvoir de décision exercé simultanément à celui dont dispose traditionnellement l’administration du fait de sa subordination aux instances représentatives « démocratiquement » élues. La démocratie environnementale (ou écologique) procède de la même démarche, à ceci près qu’elle sélectionne ses interlocuteurs, comme l’avait fait avant elle la démocratie sociale : ce sont les associations de protection de l’environnement, reconnues et agréées comme telles, qui sont amenées à participer au processus décisionnel. Cette forme, relativement classique, est toutefois plus récemment dépassée par le développement d’une démocratie dite « plurielle ». Ainsi, dans le cas de la France, le « Grenelle de l’environnement », processus installé depuis 2007 pour développer un droit et des pratiques se voulant protectrices de l’environnement (forcément durable), vise à construire une « démocratie écologique » qui se manifeste par la procédure d’élaboration de ses propres normes. Il s’agit d’une « gouvernance à cinq » : représentants des collectivités territoriales, des entreprises, des organisations syndicales de salariés, des associations de protection de l’environnement, et de l’Etat. Ce périmètre, dans lequel les instances représentatives classiques sont diluées au sein des première et cinquième catégories qui viennent d’être mentionnées, est amené à préparer les projets de loi, dont le Parlement ne saurait s’écarter sans se voir reprocher de remettre en cause « l’esprit » de l’entité semi-collective qui en a élaboré le texte, dont l’appellation officielle complète est d’ailleurs « Grenelle Environnement. Entrons dans le monde d’après ». Après la démocratie représentative vient le temps de la confrontation d’une pluralité d’acteurs dotés de compétences et de moyens inégaux, mais théoriquement placés sur un pied d’égalité, sans aucun rapport direct avec l’élection, sinon peut-être au sein d’instances militantes auto-instituées. Sans être encore totalement mort, le processus électif est désormais considéré comme insignifiant, complété (pour éviter de dire remplacé) par un système de gentleman’s agreement entre oligarques et groupes de pression, à la géométrie très variable, voire aléatoire.
Le second volet, complémentaire, est constitué de la valorisation de la contestation, considérée désormais comme une forme d’expression démocratique équivalente de celle du suffrage. Si le droit d’exprimer une opinion différente, par la pétition ou la manifestation par exemple, a toujours existé dans les démocraties libérales, la place de cette contestation a évolué. Il ne s’agit plus de la considérer soit comme une concession à ceux qui, après une élection, ont du mal à accepter que les élus de leur choix mènent une politique contraire à leurs promesses, soit comme une préparation du vote suivant. La nouveauté est que la prise en compte de cette « démocratie récusatoire » est désormais déconnectée du processus électoral, sans doute d’ailleurs par crainte que, limitée à un tel cadre, elle ne soit plus totalement contrôlable. Disséminée, donc aussi neutralisée dans ses effets, elle est reconnue dans la quasi-totalité des processus décisionnels, les individus étant autorisés, voire incités, à manifester leur désapprobation et mécontentement lors de leur participation aux différentes instances consultées dans le déroulement de ces derniers – le domaine de l’environnement comme du quotidien en général constituant le champ d’application naturel de ces postures protestataires. Loin d’être considérée comme marginale, cette modalité d’expression est désormais tenue pour centrale dans l’exercice de la participation démocratique (cf. P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, 2006).
Elle trouve à s’exprimer tout spécialement par la voie électronique, l’outil informatique permettant tout à la fois, au moins en apparence, une information plus large sur certains éléments du processus décisionnel, et une participation, sélective, partielle et nettement moins transparente, à ces mêmes processus, par la voie de la proposition mais aussi, et plus souvent, par celle de la contestation. Ces nouvelles formes de démocratie d’opinion, quel que soit leur intérêt, ont en commun d’être frontalement opposées à la rationalité qui était réputée fonder la légitimité démocratique des institutions représentatives. Si, dans un premier temps, cette confrontation n’était pas véritablement assumée, en dehors peut-être des cercles qui en assuraient la promotion tout en en pointant les limites (par ex. Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Seuil, 2008), elle est désormais revendiquée.
Dans un bref ouvrage au ton certes militant, Dominique Bourg et Kerry Whiteside estiment ainsi que « le gouvernement représentatif a été conçu pour faciliter l’accumulation générale de richesses matérielles, pour maximiser leur production et leur consommation », et qu’il importe donc d’instaurer une démocratie écologique qui rompe avec les formes institutionnelles anciennes, fondées sur la promotion de l’autonomie et la satisfaction immédiate des intérêts des citoyens (Vers une démocratie écologique, Seuil, 2010).
Il faut se garder de prendre trop à la légère un tel mouvement, de plus en plus généralisé. Certes, la promotion de la démocratie participative, sous ses diverses dénominations adjectivées, relève pour une part d’une politique du divertissement, voulue et parfois assumée comme telle : elle vise à redonner de la « légitimité » aux institutions représentatives, ou en tout cas à affaiblir la contestation radicale à leur égard, au profit de son expression domestiquée. Mais ces mêmes formes de représentation visent explicitement à dépasser la démocratie représentative qu’on juge incapable d’assumer autre chose qu’une représentation d’intérêts catégoriels. Sans doute ce dépassement est-il lui-même l’enjeu de la mise en valeur d’autres intérêts du même type – la « démocratie environnementale » en étant l’illustration parfaite. La lutte entre groupes d’intérêts que manifeste cette remise en cause du principe électif présente cependant le grand avantage de dénuder un peu plus l’édifice représentatif : non seulement la faillite de la forme traditionnelle de démocratie est désormais constatée – quand bien même il s’agit parfois de tenter de la réanimer – mais surtout le caractère oligarchique de ces institutions est constaté sans que cela soulève quelque diffi culté. Plus encore, la liaison intrinsèque entre le modèle électif, tout théorique, du gouvernement représentatif et son caractère oligarchique est très nettement identifiée.
Dans un tel contexte, on ne peut qu’être étonné de ce que la propension à défendre un système politique visiblement à bout de souffle vienne de ceux qui en furent jadis les plus ardents critiques. Les partis politiques qui veillent à respecter le plus scrupuleusement possible les procédures de la démocratie représentative sont aussi ceux dont le discours se rattache à une filiation qui le réprouvait le plus auparavant ; les représentants institutionnels de l’Eglise sont aussi ceux qui, aujourd’hui encore, incitent à participer pleinement et activement à des institutions dont ils demeurent sans doute les derniers à vouloir croire (ou même qui croient) qu’elles ont quelque rapport avec le bien commun.
Il serait temps de mettre un terme à cette forme particulière d’acharnement thérapeutique, et de prendre acte de la réalité des nouvelles institutions contemporaines. Paradoxalement peut-être, la situation de dénuement idéologique des structures représentatives constitue un moment historique qu’il n’est pas possible d’observer en simple spectateur. Toute la modernité politique a été fondée sur l’affirmation que les représentants, et les processus amenant à leur désignation, constituaient le moyen d’asseoir à la fois la souveraineté illimitée du corps politique, et la définition et la mise en œuvre de « l’intérêt général » – cette version réduite et utilitariste du bien commun. Les institutions représentatives ne sont plus, aujourd’hui, aptes à prétendre assumer réellement ces deux fonctions. Cette nouvelle situation ne change à vrai dire rien sur le fond : la période que nous traversons ne constitue qu’une révélation de la nature propre de ces institutions. Parler de crise de la démocratie représentative serait ainsi une erreur de perspective : cela supposerait que, dans un état de choses idéal, cette modalité de l’organisation politique moderne ait pu correspondre avec ce qu’elle prétendait être. Or c’est précisément l’avantage principal de la période que nous traversons de montrer que ce lien entre institutions politiques représentatives d’une part, représentation du peuple tout entier et poursuite de l’intérêt général d’autre part, n’a jamais été et ne peut être qu’une fiction à fin de légitimation par tacite acceptation.
Une telle situation est donc une occasion de revenir à la question fondamentale de toute organisation politique, qui est celle de sa finalité, et, par le fait même, celle du « bon régime ». Puisque la mythologie de la démocratie représentative est désormais inopérante, quelle forme d’institutions politiques inventer pour la remplacer ? Les tâtonnements auxquels donnent lieu les diverses propositions sur la « démocratie du public » (celle des forums interactifs évoqués par Bernard Manin) et le développement de modalités participatives pour le moins bancales, ne sont sans doute pas autre chose qu’un moyen envisagé pour pallier la défection à l’égard des institutions représentatives, ou pour divertir de leur état de déliquescence. Mais elles peuvent relever également d’une sorte de jeu de l’apprenti-sorcier. Leur promotion constitue un aveu, parfois explicitement formulé – c’est en particulier le cas dans le cadre de la mise en route de la démocratie environnementale – de l’échec évident du système qui dominait jusqu’alors. Il est possible que parmi ceux qui participent à ces processus de substitution, quelques-uns puissent se demander s’ils ne sont pas encore conviés à un rôle de figuration, au profit cette fois de quelque nouvelle Nomenklatura aux contours encore plus insaisissables que le système des partis. Tout cela suggère de réfléchir sur l’après-démocratie, d’autant plus sérieusement que nous nous trouvons dans un climat de crise générale de société gros de menaces, et face à un vide conceptuel très étendu. Quiconque a conservé le souci du bien commun ne peut rester indifférent à ce constat.







