Numéro 128 — Mariage indissoluble : l’obstacle
La culture dominante de l’Occident contemporain puise son origine dans l’époque des Lumières. Elle conçoit la liberté comme une libération de toute espèce de subordination à une « loi » supérieure ou extérieure au sujet, pour autant que cela est matériellement possible. « Tous les hommes tiennent de la nature même le pouvoir de faire ce que bon leur semble, et de disposer à leur gré de leurs actions et de leurs biens, pourvu qu’ils n’agissent pas contre les lois du gouvernement auquel ils se sont soumis. » (Encyclopédie, article « Liberté naturelle ») « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)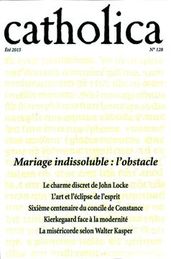
Si, dans la perspective philosophique non moderne, et dans la vision chrétienne qui la renforce, la liberté est l’aptitude que l’homme a de se mouvoir volontairement vers le Bien, il n’en va pas de même dans la modernité, qui pose en principe qu’il n’y a de bien que celui que chacun détermine à son gré être tel. Liberté et volonté pure coïncident, la seule limite acceptée étant l’existence des autres et l’autolimitation qui en découle, par respect du principe de réalité. Cette existence des autres, la pluralité sociale, est considérée comme un mal — cela est explicite chez Rousseau -, mais aussi comme un fait irréversible, qu’il s’agit donc de domestiquer pour l’utilité réciproque, supposant « reconnaissance » mutuelle et égalité sur des bases dûment délimitées et toujours modifiables, au moins dans le principe.
La mise en pratique de cette conception se heurte à deux séries d’obstacles opposés. D’un côté le principe d’égalité stricte entre les individus est contrebalancé par l’inégalité de fait entre les plus cohérents des « amis de la liberté » et ceux qui leur résistent ou ne montrent pas de zèle à les suivre. L’impossible « neutralité » laïque, qui permettrait une équidistance de droits entre les différentes parties sociales, est là pour en témoigner.
On observera que la « parfaite égalité » entre le vrai et le faux n’a aucun sens par elle-même. Bien qu’elle soit constamment invoquée (sous la forme : chacun peut penser et faire ce qu’il veut) elle est loin d’être respectée. En effet, les membres des minorités actives qui vont dans le sens de la plus grande affirmation de la « liberté » ont, dans le cadre juridico-politique qui leur en offre le pouvoir, nécessairement plus de poids que les autres, jugés plus attardés, suspects, réactionnaires, et en tout état de cause exclus de la discussion et objets de mépris.
Toutefois une telle exclusion ne suffit pas. Il reste à créer à la racine les conditions les plus favorables à l’émancipation désirée par l’avant- garde sociale, dont les desseins se heurtent constamment à la résistance des autres, avec leurs éléments symboliques, leur retard à se libérer des atavismes qui leur sont prêtés : laissés pour compte à certains égards, ils n’en représentent pas moins un frein pour la légitimation des désirs des plus affranchis.
Ainsi persistent des îlots de mœurs chrétiennes, des habitudes de vie traditionnelles, une lenteur à accepter les « nouvelles valeurs » du jour, à abandonner les répugnances naturelles, etc. Pour surmonter ces freins, l’éducation — scolaire, médiatique, punitive — a donc toujours été la grande préoccupation des forces motrices de la nouvelle société éclairée, avec le double objet de détruire les « préjugés » et les structures qui les produisent et les pérennisent, la religion et la famille en particulier, et d’imposer de nouvelles conceptions et conduites.
C’est à ce point qu’intervient la question du divorce, mis à l’ordre du jour avec empressement dès le début du processus révolutionnaire français. Le programme est tracé d’avance. Diderot, dans l’Encyclopédie — entrée « Indissolubilité » — écrit que « l’homme sage frémit à l’idée seule d’un engagement indissoluble ». Une de ses confidentes, l’une aussi des premières féministes, Marie-Madeleine Jodin, publiera en 1790 des Vues législatives pour les femmes, pour demander, au nom de la liberté de disposer de soi, l’abrogation de cette « indissolubilité qui blesse les droits de l’homme ». Ce que transcrira en loi l’Assemblée législative, le 20 septembre 1792, jour de la victoire de Valmy et veille de l’abolition de la royauté : « L’Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte ; considérant que déjà plusieurs époux n’ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle, suivant laquelle le mariage n’est qu’un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce, décrète ce qui suit : Article Ier — Le mariage se dissout par le divorce. » (On remarque au passage le recours à un argument qui fera florès, la consécration par la législation d’une pratique illégale minoritaire.) Le rapporteur du texte, Léonard Robin, avait annoncé peu avant : « Le Comité a cru devoir conserver ou accorder la plus grande latitude à la faculté du divorce à cause de la nature du mariage qui a pour base principale le consentement des époux et parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée de manière indissoluble par aucune convention. » (Cité in Irène Théry, Le démariage, Odile Jacob, 1993, p. 49) .
Ce type d’argument sera sans cesse repris lorsque des circonstances politiques particulières favoriseront le retour en puissance du « parti du mouvement », en particulier dans les années 1880, qui verront aboutir les campagnes du député Naquet, avec le vote de la loi qui porte son nom (27 juillet 1884) ; loi encore cependant imparfaite du point de vue de la logique contractualiste, puisqu’elle écartait encore — par crainte de désordres — le divorce par consentement mutuel, lequel n’arrivera en France qu’en 1975. En vérité, le déploiement logique de l’idée moderne ne peut pas connaître de limites internes. A l’époque même de la révolution française, un obscur député du Tiers, Bouchotte, dans des Observations sur l’accord de la Raison et de la Religion pour le rétablissement du divorce, publiées en 1790, avait déjà insisté sur le fait qu’aucune « liberté civile » ne saurait tenir si la « liberté domestique » ne régissait pas le contrat de mariage, ruinant ainsi d’avance les fausses espérances du conservatisme. Il serait effectivement illogique et inconséquent de vouloir maintenir le statut naturel de la famille pour n’appliquer le principe contractualiste qu’à la société politique.
Le concept moderne de liberté — aujourd’hui plus que jamais avec sa version libertaire postmoderne — est incompatible avec ce qui constitue la première garantie de liberté d’être de la famille, et l’assurance de sa durée, l’indissolubilité du mariage. Il n’existe pas de moyen terme. Deux visions hétérogènes s’opposent donc : d’un côté, celle, naturelle et spontanée, du bien objectif et universel, qui implique responsabilité et durée, de l’autre, celle de la libération conquérante du désir individuel dégagé de tout lien avec la raison.
Car c’est la raison même qui impose l’indissolubilité d’une union qui, pour être fondée sur un échange initial de consentement, a un objet qui implique la perpétuité du lien. Ce contrat fonde une institution, le foyer familial, qui est d’abord le lieu d’éclosion de vies nouvelles, et pour cela demande à être scellée par la fidélité. Ces vies nouvelles sont celles d’êtres humains, dont la nature ne se résume pas à celle des corps (qui demandent déjà bien plus de soins chez l’homme que dans le règne animal) mais se spécifie par les facultés de l’âme que sont la raison et la liberté. L’une et l’autre requièrent cette autre forme de la mise au monde qu’est l’éducation. Autant d’évidences naturelles dont on ne peut séparer la donnée du temps, puisque la constitution d’une famille se projette par essence dans l’avenir, non pas indistinctement mais dans la réalité identitaire d’une filiation, raison pour laquelle la petite société familiale et la grande société se trouvent en lien immédiat. Sur le seul plan naturel, l’indissolubilité du mariage constitue un instrument fondamental de la continuité de la communauté politique, ce qui fonde évidemment l’obligation, de stricte justice pour tout pouvoir politique, d’aider les familles à se former, remplir leur rôle et durer. On notera au passage que si la famille est une institution, elle n’est pas la seule à requérir la pérennité.
Toute entreprise humaine menée en commun dans la durée répugne à voir ses membres entrer et sortir à leur gré quand bon leur semble, la plus importante et exigeante d’entre elles sous ce rapport étant la communauté politique historiquement formée, avec son patrimoine et ses caractères propres. Ajoutons que du point de vue moral, le témoignage de la fidélité conjugale, renforcé par la reconnaissance publique et juridique de l’indissolubilité, a valeur exemplaire pour le respect de tout autre pacte fondé sur la parole donnée et le don de soi jusqu’à l’abnégation, jusqu’au sacrifice même de la famille pour le bien de la patrie quand il arrive que cela soit requis. Dans Iota unum (1985), Romano Amerio écrit que l’intransigeance absolue de l’indissolubilité est une « célébration de la puissance ordinaire de la liberté », ordinaire parce que mettant à la portée la possibilité de s’élever en dignité.
Il en va de même de la responsabilité. Le mariage indissoluble favorise naturellement le sens de la responsabilité des époux entre eux, et de ceux-ci envers les enfants à l’égard desquels ils ont une obligation dont ils ne peuvent se dispenser, et qui est la raison d’être de l’institution qu’ils ont fondée. Le divorce est source d’injustices multiples. Le moins que l’on puisse dire est que la libération du désir favorise l’irresponsabilité : le droit des enfants, qui est objectivement premier, cède devant le droit individuel reconnu à l’individu-parent qui veut divorcer — les deux parfois dans le cas du consentement mutuel -, sinon de manière subalterne, au titre d’une question pratique à régler devant le juge, en même temps que les affaires patrimoniales. Il faut se souvenir ici du fait que la révolution avait aboli la séparation de corps, situation d’exception prévue en cas de mésentente grave entre époux, temporaire en l’attente d’une restauration de l’ordre familial, et cela au moment même où, au nom du droit à disposer de soi, le divorce était introduit, y compris par consentement mutuel (le Code civil napoléonien rétablira la première possibilité et se contentera de mettre certains freins à la seconde). Le prétendu droit à disposer de son corps a plus récemment justifié, de manière analogue, la légalisation de l’avortement volontaire, en attendant son inscription au catalogue des supposés droits humains.
C’est précisément sur un tel terrain que l’Eglise s’est présentée comme un rempart de la réalité naturelle du mariage et du droit premier des enfants, au nom de la droite raison et plus encore de la Révélation. Celle-ci a conféré à l’indéfectibilité de la fidélité conjugale une signification prophétique de l’union du Christ et de l’Eglise, et a considéré l’accueil des enfants dans la lumière du sacrement, comme l’engendrement corporel et spirituel de nouveaux membres du Corps du Christ.
En vérité, comme le proclame le texte de la bénédiction nuptiale, c’est dès le commencement du monde, après la création d’Adam puis d’Eve tirée de son côté qu’il a été établi que ne doit jamais être séparé ce que Dieu a uni, union à laquelle a été accordée « la seule bénédiction dont nous n’avons été dépouillés ni par la punition du péché originel, ni par la sentence du déluge ». Au xvie siècle, le Catéchisme du concile de Trente (27, 1) enseignait, à propos de l’indissolubilité, que « l’essence même du mariage est dans ce lien ». Face à l’irruption du libéralisme philosophique, les papes de la période contemporaine ont amplement commenté cette proposition. Ils ont pris soin de relever que dans la culture antique le mariage, en raison de son lien immédiat avec le mystère de la vie, revêtait déjà un caractère sacré.
Le sacrement institué par le Christ renforce et ennoblit considérablement ce caractère, tout autant que la liberté humaine de l’engagement sans retour.
Deux esprits s’affrontent — d’un côté celui du don de soi, de l’abnégation, de l’honneur à respecter sa parole, de l’autre celui de la recherche de soi érigée en absolu — excluant toute idée de possible conciliation. L’indissolubilité du mariage constitue une pierre d’achoppement radicale pour la réalisation du vieux rêve bercé dans ce sens par le catholicisme libéral. On ne voit pas tellement quel nouvel arbre de la liberté pourrait être érigé en faveur d’un mariage en même temps indissoluble et dissoluble ! Ne sommes-nous pas tenus par la logique du aut aut tant décriée, qui est si clairement énoncée dans la IIe épître aux Corinthiens (6, 15–16) : « Quel rapport entre la justice et l’iniquité ? Quel rapport entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Bélial ? Quelle association entre le temple de Dieu et les idoles ? »
Il n’empêche, toutes sortes de faux-fuyants jaillissent ces derniers temps pour tenter de passer outre. Le premier est tout simplement le silence, l’oubli opportun des passages gênants de l’Ecriture et de la Tradition. Ainsi va l’insistance exclusive sur la miséricorde divine et l’omission simultanée de la justice du Christ qui viendra juger les vivants et les morts, associée au dénigrement de la loi et de ses docteurs. Par ailleurs se multiplient les raisonnements sophistiques dans lesquels Pascal trouverait avec bonheur de quoi mettre à jour ses Provinciales.
Un premier argument consiste à faire valoir que si l’Eglise ne consent pas à nuancer ses exigences disciplinaires (en l’espèce, les paroles mêmes du Christ !) elle va devenir définitivement incompréhensible aux hommes de notre temps : il conviendrait donc de se mettre à leur portée, de se montrer miséricordieux et accueillant. Cela rappelle cette fois Bossuet, dont il faudrait relire intégralement aujourd’hui un sermon sur « la soumission due à la parole de Jésus-Christ », adressé aux Minimes le 22 février 1660. Commentant Matthieu 17, 5 — « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je me suis plu, écoutez-le » -, il s’en prend, en s’inspirant du prophète Isaïe, à tous « ceux qui consultent pour être trompés, qui ne trouvent de bons conseils que ceux qui les flattent, qui cherchent à se damner en conscience. […] De tels hommes disent aux voyants : “Ne voyez pas, aveuglez-vous pour nous plaire […] Dites-nous des choses qui nous plaisent, débitez-nous des erreurs agréables” ». Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, mais dans les circonstances présentes le procédé risque d’avoir des effets plus lourds de conséquences. D’autres argumentations, fondées sur une approche générale de type personnaliste, ne considèrent que le couple et son amour, lequel peut à leurs yeux justifier bien des choses, surtout lorsqu’il s’étiole. L’imagination fertile aidant, l’idée surgit d’un sacrement à durée limitée, susceptible de s’effacer si l’amour entre époux disparaît. D’autres préfèrent emprunter une « loi de gradualité », disons de normalisation progressive, dans laquelle ils voient le moyen de justifier de servir deux maîtres en attendant de bénéficier d’une sorte de légitimation a posteriori par voie de prescription. Aucune de ces belles argumentations ne s’intéresse aux enfants, les seuls oubliés de ces débordements ruisselants de charité feinte. Il existe bien des combinaisons possibles entre toutes ces tentatives de mitigation, elles pullulent en un moment où nous allons vers le point culminant de l’offensive contre la loi du Christ, mais aucune, et pour cause, ne peut échapper à la nécessité de trancher en fonction d’elle.







