Une solution de continuité doctrinale. Peine de mort et enseignement de l’Église
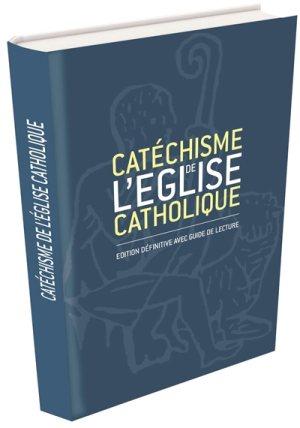 « Si l’Évangile interdit aux États d’appliquer jamais la peine de mort, saint Paul lui-même alors a trahi l’Évangile » Cardinal Journet[1]
« Si l’Évangile interdit aux États d’appliquer jamais la peine de mort, saint Paul lui-même alors a trahi l’Évangile » Cardinal Journet[1]
Le 11 mai 2018, lors d’une audience concédée au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le pape a approuvé une nouvelle version du § 2267 du Catéchisme de l’Église catholique (CEC) indiquant notamment : « L’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que la peine de mort est inadmissible. » Cette modification doctrinale est actée par un simple rescrit, réponse écrite d’ordre administratif, donné lors d’une audience ordinaire, ex Audentia Sanctissimi.
Daté du 1er août 2018, il indique seulement que le nouveau texte sera promulgué « par impression dans L’Osservatore Romano, entrant en vigueur le même jour, et ensuite sera publié dans les Acta Apostolicæ Sedis ». Il s’agit d’un texte juridique de faible envergure, employé ordinairement pour des questions règlementaires, et non doctrinales. De surcroît, l’approbation pontificale de ce nouveau paragraphe n’a pas été faite en « forme spécifique », qui abrogerait toute disposition antérieure traitant du même sujet. Le texte latin porte que le pape en a simplement « approuvé la formulation ». Il s’agit d’une approbation en « forme générique », permettant de soutenir que les dispositions antérieures contraires peuvent être tenues pour toujours valables. Enfin, ce texte de forme juridique mineure cache mal un mépris des formes et des institutions, en établissant que son entrée en vigueur dépend d’une publication dans la presse officieuse du Saint-Siège (dérogeant au principe établi par le can. 8, §1), laissant dédaigneusement au journal officiel du Vatican le soin d’en assurer une copie.
En cela, cette modification du CEC s’éloigne grandement du formalisme respecté tant pour l’adoption du texte originel, par la constitution apostolique Fidei depositum, le 11 octobre 1992, que pour sa révision en 1997, par la lettre apostolique Laetamur magnopere, aboutissant à l’édition typique en latin, texte faisant foi et non modifié depuis. Le changement opéré n’obéit aucunement à une procédure semblable, et ne respecte aucun parallélisme des formes. Il provient initialement non d’un concile œcuménique, soutenu par un synode des évêques épaulé par une commission de spécialistes, mais d’une idée particulière au pontife régnant, exprimée dès le début de son pontificat dans des textes dépourvus de forte autorité magistérielle. Il s’agit d’une Lettre aux participants au XIXe Congrès de l’Association internationale de droit pénal et du IIIe Congrès de l’Association latino-américaine de droit pénal et de criminologie, le 30 mai 2014, d’un Discours à une délégation de l’Association Internationale de Droit Pénal, le 23 octobre 2014, ou encore d’une Lettre au président de la Commission internationale contre la peine de mort, le 20 mars 2015.
La formulation nouvelle du paragraphe en question s’en ressent, puisque l’unique autorité doctrinale citée à l’appui du propos est un autre texte du même pontife, un Discours aux participants à la rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, daté du 11 octobre 2017.
Cette approche externe ne doit pas occulter le point le plus délicat, et le plus douloureux de cette expression de la volonté pontificale, à savoir la solution de continuité doctrinale. Quelle que soit la manière d’aborder la question, le catholique est placé devant un mystère, sinon d’iniquité, du moins de l’entendement. Jusqu’au pape actuel, le catéchisme exposait que « l’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort » (CEC, § 2267) ; désormais, le pape affirme que ce recours est inadmissible, « à la lumière de l’Évangile ». Les positions semblent inconciliables, et nous laissons le dénouement de ce problème aux théologiens et aux pasteurs. Contentons-nous d’évoquer d’abord l’enseignement pérenne de l’Église sur la question de la peine de mort, et ensuite d’évaluer les raisons apportées à un tel revirement.
I. L’enseignement pérenne de l’Église
1. Les Écritures
L’Écriture est le premier lieu théologique à sonder sur ce sujet. L’interdit posé par le Décalogue sous la forme concise non occides (Ex 20, 13) est concomitant d’exceptions, ou plutôt de précisions doublées d’exceptions sur le sens qu’il doit revêtir. Cet interdit ne concerne, de manière absolue, que l’innocent. Dès la Genèse, le principe de la mise à mort du meurtrier est proclamé : « Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car Dieu a fait l’homme à son image. » (Gn 9, 6) Ce principe est rappelé un bon nombre de fois dans le Pentateuque : « Qui frappe un homme à mort sera mis à mort » (Ex 21, 12) ; « Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu’il soit, il sera mis à mort » (Lv 24, 17) ; « Tu n’auras pas un regard de pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » (Dt 19, 21) Le livre des Nombres pose, à ce sujet, une règle procédurale fort importante : « Quiconque frappe à mort une personne, c’est sur la déposition de plusieurs témoins qu’il sera tué. Mais la déposition d’un seul témoin ne pourra faire condamner quelqu’un à mort. » (Nb 35, 30) Il s’agit ici du principe du talion, principe pénal de haute dimension mettant fin à la vengeance illimitée[2]. Il se trouve explicité en premier lieu par le Lévitique : « Si un homme provoque une infirmité chez un de ses compatriotes, on lui fera comme il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Telle l’infirmité provoquée, telle l’infirmité subie […] celui qui frappe à mort un homme mourra. » (Lv 24, 19–21)
Au-delà du seul cas du talion, c’est-à-dire de la punition par la mort d’un meurtrier, les Écritures montrent encore un grand nombre de cas légitimant la mise à mort des coupables, bien que leurs crimes ne fussent pas des crimes de sang. Il y a le cas des mages : « Tu ne laisseras pas vivre les magiciens » (Ex 22, 18 Vg) ; celui des idolâtres : « Tu lapideras l’homme ou la femme jusqu’à ce que mort s’ensuive » (Dt 17, 5) ; ou encore celui de divers méfaits punis par Moïse : « Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Celui qui commet un rapt – qu’il ait vendu l’homme ou qu’on le trouve entre ses mains – sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » (Ex 21, 15–17)
Le Deutéronome pousse plus loin la punition, puisque « le prophète ou le faiseur de songes » qui attire vers les faux dieux sera mis à mort (Dt 13, 6), de même que le frère, le fils, la fille, la femme ou l’ami qui tente de séduire l’âme en secret (Dt 13, 7), « tu le lapideras jusqu’à ce que mort s’ensuive, parce qu’il a cherché à t’égarer loin du Seigneur ton Dieu. » (Dt 13, 11) Même punition collective pour la cité qui s’est détournée du vrai Dieu (Dt 13, 16).
Sont également punis de mort les auteurs d’actes adultères (Dt 22, 22), homosexuels (Lv 20, 13), incestueux (Lv 20, 11–12) ou de bestialité (Ex 22, 19 ; Lv 20, 15–16). David, dans le psaume centième, chante « justice et bonté », allant « par le chemin le plus parfait » et conclut : « Chaque matin, je tuerai tous les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. » (Ps 100, 8)
Le Nouveau Testament présente un aspect bien différent relativement à la peine capitale, bien qu’il n’emporte pas moins la légitimation du principe. Comme l’affirme le cardinal Journet, « le Nouveau Testament n’a pas aboli le droit de glaive […] “En disant que celui qui frapperait par le glaive périrait par le glaive, le Christ ne condamne pas le glaive ; il énonce une loi universelle de l’action”, temporelle et transitive, loi qui d’ailleurs avait jadis été proclamée dans la Genèse : “Quiconque aura versé le sang de l’homme, son sang sera versé par l’homme” (ix, 6) et qui sera reprise dans l’Apocalypse, xiii, 10 : “Si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée”[3] ».
L’Évangile fait voir la peine de mort mise en pratique par les autorités politiques, bien qu’elle puisse l’être sur réquisition des autorités religieuses, comme le démontre la Passion : « Selon notre loi il doit mourir, parce qu’Il s’est fait Fils de Dieu. » (Jn 19, 7) La peine capitale endosse un rôle majeur, en étant le moyen juridique de la Rédemption. Cela établit, au moins, une raison de convenance à ce qu’elle ne soit pas déclarée inadmissible. Aussi l’Évangile présente Notre Seigneur acceptant l’infliction de cette peine, ne déniant cette prérogative ni à Pilate ni au Sanhédrin (Jn 19, 11). Si la mort rédemptrice de Jésus-Christ est le comble de l’iniquité, et l’injustice la plus grande qui se commettra jamais, ce n’est pas parce que le procédé est condamnable, mais parce que le condamné est l’Innocent.
Dans l’évangile selon saint Luc, la peine capitale est mentionnée en présence du Christ qui n’y trouve rien à redire, soit lorsque saint Pierre lui déclare : « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort » (Lc 22, 33), soit quand le bon larron formule devant lui, sans être rabroué, le principe d’une juste rétribution de ses fautes par la mort : « Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes. » (Lc 23, 41) Il n’est pas jusqu’aux paraboles qui ne présentent la peine de mort sous un jour acceptable, comme celle des mines (Lc 19, 27) ou celle des vignerons infidèles (Mt 21, 41 ; Mc 12, 9 ; Lc 20, 16).
Il revient à saint Paul d’avoir posé des jalons théoriques plus précis. Il admet doublement la légitimité de la peine capitale, en pratique d’abord, devant Festus : « Si donc je suis coupable et si j’ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir » (Ac 25, 11) ; en théorie ensuite, en posant le fondement scripturaire de la légitimité de la peine de mort : « Les princes sont ministres de Dieu pour t’inciter au bien ; mais si tu fais le mal, alors, crains, car ce n’est pas pour rien que l’autorité détient le glaive. Elle est le ministre de Dieu pour venger sa colère envers celui qui fait le mal. » (Rm 13, 4) De même, après avoir énoncé « qu’un peu de levain fait fermenter toute la pâte », il objurgue les Corinthiens : « Faites disparaître ce méchant du milieu de vous. » (1 Co 5, 13)
Saint Pierre est moins précis que lui, rappelant toutefois que les pouvoirs sont là « pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. » (1 P 2, 13–14) Certains Pères estiment que le prince des Apôtres condamna lui-même à mort Ananie et Saphire (Ac 5, 1–11), quand d’autres y voient seulement un effet de la justice immanente.
2. Les Pères
Le second lieu théologique à explorer est celui de la Tradition, telle qu’exprimée notamment par les Pères de l’Église. Sans chercher de manière exhaustive, un florilège suffira. Même chez ceux qui paraissent personnellement hostiles à l’application de la peine capitale, l’on trouve des justifications du principe. Ainsi de Tertullien, glosant saint Paul, affirmant que « les puissances sont les auxiliaires de la justice, et les ministres du jugement divin, qui s’exerce d’avance ici-bas sur les criminels ». (Scorpiaque, 14) Il n’a rien à redire contre « ces morts violentes, décernées par la justice humaine, lorsqu’elle réprime la violence » (De anima, 56). Il réfléchit sur la sanction du meurtrier chez les Anciens : « La vengeance que les hommes tirent de l’homicide est aussi grande que la nature elle-même qu’ils vengent. Qui ne préférerait la justice du siècle qui, selon la déclaration de l’Apôtre [Rm 13, 4], n’est pas armée en vain du glaive, et qui, en sévissant pour l’homme, est religieuse ? » (De anima, 33).
Un texte longtemps attribué à saint Cyprien reprend cette doctrine patristique : « Le roi doit réprimer les larcins, punir les adultères, faire disparaître de la terre les impies, ne pas permettre de vivre aux patricides [sic] et aux parjures, ni tolérer l’impiété des fils[4]. » L’évêque de Carthage rappelle les règles mosaïques de punition à mort des idolâtres, et loue la geste de Mattathias d’avoir tué celui qui s’approchait de l’autel pour sacrifier aux idoles (1M 2, 24), avec ce commentaire : « Que si ces préceptes touchant le culte de Dieu et le mépris des idoles ont été observés avant l’avènement de Jésus-Christ, combien plus le doivent-ils être maintenant qu’il est venu ! » (Exhortation au martyre, V).
Lactance s’insurge contre l’« impardonnable erreur » de ceux qui accusent « d’inclémence ou de méchanceté la justice de Dieu ou des hommes, et de traiter de méchant celui qui inflige une peine aux méchants ! S’il en est ainsi, nous avons des lois néfastes parce qu’elles vouent au supplice les criminels, ainsi que des juges néfastes, qui punissent de mort ceux qu’ils ont convaincus de crimes […] Le juge qui frappe les crimes n’en est pas moins un juge intègre et juste, car il veille au salut des bons en châtiant les pervers » (De la colère de Dieu, 17). Il conclut : « C’est nuire que d’épargner celui qui nuit. »
Saint Ambroise rapporte la justification donnée par saint Paul (Rm 13, 4) et explique que le détenteur de l’autorité est « le vengeur de Dieu à l’encontre de ceux qui agissent mal » (Ep. 25, 1[5]). La peine de mort a « l’autorité de l’Apôtre pour elle ». Il définit les missions du juge : « Il n’est pas permis de s’abstenir de pratiquer le glaive dans de nombreux procès, car il est au service des lois » (Super Ps. XXXVII, 51).
Saint Hilaire de Poitiers, dans ses commentaires sur saint Matthieu, indique qu’il y a deux sortes d’usages légitimes du glaive, « soit pour exécuter un jugement, soit dans la nécessité de résister à des brigands » (XXXII, 2)[6].
Saint Augustin semble, de tous les Pères, le plus prolixe à ce sujet. Tout au long de son ministère épiscopal, et dans des œuvres de divers genres, il justifie la peine capitale. Dans son traité Du libre arbitre, se mettant en dialogue avec Évodius, il indique qu’on n’appelle pas homicide « le soldat qui tue l’ennemi, le juge ou son ministre qui tue le malfaiteur » (I, 4, 9)[7]. Il explique encore, dans une lettre à Publicola : « Je ne suis pas d’avis qu’on puisse tuer un homme […] à moins qu’on ne soit soldat ou revêtu d’une fonction publique, de façon qu’on ne frappe pas pour soi-même, mais pour les autres, pour une cité, par exemple où l’on réside, avec une légitime autorité. » (Ep. 47, 5) La légitime autorité est entendue au sens judiciaire, après procès et condamnation, et sur ordre du juge. C’est ce que l’on peut tirer de cette autre affirmation : « Le bourreau, lorsqu’il exécute un homme condamné à mort par la sentence du juge, se rend coupable d’homicide s’il agit spontanément et sans ordre, quand même il saurait que l’homme à qui il donne la mort était irrévocablement condamné par le juge. » (Questions sur l’Exode, XXXIX, 11) En ce sens, cette autorité peut licitement résider dans les justes : « Les bons peuvent très-bien, dans une bonne intention, exercer le ministère de la vengeance ainsi un roi, ainsi un juge. » (Questions sur les Évangiles, I, 10) Ce qu’il explique autrement : « Quand tu tues un homme justement, c’est la loi qui tue, et non toi. » (Questions sur le Lévitique, LXVIII, 19)
Cette présentation de la peine se retrouve dans la Cité de Dieu : « La même autorité divine qui a dit : Tu ne tueras pas, a établi certaines exceptions à la défense de tuer l’homme. Dieu ordonne alors, soit par loi générale, soit par précepte privé et temporaire, qu’on applique la peine de mort. Or, celui-là n’est pas vraiment homicide qui doit son ministère à l’autorité, il n’est qu’un instrument, comme le glaive dont il frappe. Aussi, n’ont aucunement violé le précepte Tu ne tueras pas les hommes qui ont fait la guerre sur l’ordre de Dieu, ou qui, représentant la puissance publique, ont puni de mort les scélérats, conformément aux lois, c’est-à-dire au commandement de la très juste raison. » (I, 21)
Dans une longue lettre à Macédonius, vicaire d’Afrique, il développe amplement les arguments justifiant le glaive, « légitime pouvoir de vie et de mort » (vitae necisque legitimam potestatem, ep. 153, 8). Il rappelle d’abord que, dans l’épisode de la femme adultère, « le Seigneur n’improuva pas la loi qui ordonnait la peine de mort contre les femmes coupables de ce crime » (Ep. 153, 9). Ensuite, il détaille les raisons de l’infliger : « Sans doute ce n’est pas en vain qu’ont été institués la puissance du roi, le droit du glaive de la justice, l’office du bourreau, les armes du soldat, les règles de l’autorité, la sévérité même d’un bon père. Toutes ces choses ont leurs mesures, leurs causes, leurs raisons, leurs avantages ; elles impriment une terreur qui contient les méchants et assure le repos des bons. » (Ep. 153, 16) Pour être sûr d’être bien compris de son auguste interlocuteur, s’inquiétant de savoir s’il revenait à son « sacerdoce d’intervenir pour les coupables », l’évêque d’Hippone ajoute : « Il n’est pas inutile que la terreur des lois retienne l’audace humaine, afin que l’innocence demeure en sûreté au milieu des pervers et que, dans les méchants eux-mêmes, la contrainte imposée par la peur des supplices détermine la volonté à recourir à Dieu et à devenir meilleure. » Ce qu’il résume enfin : « Faire mourir pour venger, comme le ferait un juge, ou pour obéir à un ordre légal, comme le ferait le bourreau. » (Ep. 153, 17)
Ses sermons sont aussi pour lui l’occasion de rappeler la légitimité de cette peine, tout en relevant la nécessité d’une mise à mort judiciaire : « Considérez comme le pouvoir lui-même a ses divers degrés hiérarchiques : voici un homme condamné au dernier supplice, le glaive est suspendu au-dessus de sa tête ; cependant, il n’est permis de le frapper qu’à celui qui est spécialement chargé de cet office. C’est au bourreau qu’il est dévolu, c’est à lui de mettre à mort le coupable. » (Sermon 302, 14)[8] C’est pourquoi il ne refuse pas le nom d’homicide a celui qui se contente « de mettre à mort un condamné sans y être autorisé ». Enfin, ses controverses ne font qu’entériner la doctrine. Il entreprend la justification du talion, qui « pose des limites à la fureur » (Contre Fauste, 19, 25), ou commente la mise à mort des accusateurs de Daniel, « juste châtiment de la faute commise par les ennemis du saint Prophète » (Contre les lettres de Pétilien, II, 212)[9]. Il s’interroge alors, de façon toute rhétorique : « Que ne peuvent faire les rois pour venger la profanation des sacrements de Jésus-Christ, quand la vie d’un prophète mise en péril a mérité un châtiment aussi sévère ? ».
Saint Jérôme a, lui aussi, justifié plusieurs fois l’emploi de la peine capitale, quoique de manière plus concise. Dans son commentaire sur l’épître aux Galates, il s’intéresse à l’innocence du juge : « Le commandement fait en vertu d’un droit légitime fait connaître et condamner le péché bien plus qu’il n’en est la cause. C’est ainsi que le juge n’est pas l’auteur du crime quand il fait enchaîner les scélérats, mais il les renferme et les déclare coupables en vertu de son autorité, sauf à user ensuite d’indulgence en leur faisant grâce de la peine capitale qu’ils ont méritée. » (II, 3, 21)[10]
L’exécuteur est proprement le ministre de Dieu : « Qui frappe les méchants, à cause de leur malice, et détient les instruments de mort afin de retrancher les pires, est le ministre du Seigneur. » (Sur Ézéchiel, III, 9, 1) Il expose ailleurs que les bourreaux « ne sont pas seulement des hommes [mais] sont ministres et exécuteurs de la colère de Dieu contre ceux qui font le mal, et ce n’est pas sans motif qu’ils portent le glaive » (Sur Joël, II, 27), et assène de manière lapidaire : « Il n’est pas cruel celui qui immole des gens cruels. » (Sur Isaïe, XIII, 9) Il dit encore, en commentant le prophète Jonas : « Il ne nous appartient pas de nous réfugier dans la mort par l’effet de notre choix ; mais il nous convient de l’accepter sans amertume lorsqu’elle nous arrive par les mains d’autrui » (I, 12), en précisant plus loin de quel autre il s’agit, celui qui fait « courber la tête sous la hache ». Enfin, dans ses commentaires sur Jérémie (IV, 22, 3), il emploie des expressions très fortes exprimant son acceptation de la peine de mort, en traitant de l’office royal dont le propre est de « faire justice et rendre des jugements » : « Punir [de mort] les homicides, les sacrilèges et les adultères, ce n’est pas répandre le sang, c’est le ministère des lois[11]. »
Saint Jean Chrysostome, au sujet du parricide, se montre partisan de la peine capitale : « Un homme ainsi dégradé, c’est une peste, un fléau public, qu’il ne suffit pas de bannir de la cité, qu’il faut encore faire disparaître de la lumière. Un tel homme, en effet, est un ennemi public, un ennemi particulier, un ennemi commun de tous les hommes, de Dieu, de la nature, des lois, de la société des vivants. Voilà pourquoi nous devons tous participer à l’extermination, afin de purifier la cité[12]. » (4e discours sur la Genèse, § 3) Dans son commentaire des psaumes, il glose le passage paulinien en regard de la parabole du blé et du van (Mt 3, 12). Il livre de précieux renseignements sur le rôle de la peine en comparant l’utilité du châtiment divin au châtiment humain : « S’il est vrai que le glaive des magistrats soit bon à cela, et inspire la terreur, à plus forte raison est-ce vrai de la divinité. Et ce n’est point le fait d’une bonté commune que d’effrayer par des menaces, et d’insister en paroles sur l’énormité du châtiment ; c’est un moyen de nous en épargner l’épreuve. Si Dieu tend son arc, s’il le prépare, s’il y pose la flèche, s’il se prépare à punir, c’est afin de n’avoir pas lieu de punir[13]. » (Commentaire du psaume 7, § 11)
Enfin, les Constitutions apostoliques, texte rédigé à la fin du IVe siècle et dont l’influence sur les textes juridiques sera considérable, ne font que réitérer ce que les Pères ont dit : « Tu ne tueras pas, c’est-à-dire tu ne feras pas périr un homme ton semblable car ce serait détruire la beauté de la création. Ce n’est pas que toute mise à mort soit répréhensible, seule l’est le meurtre de l’innocent, mais la mise à mort légale est réservée aux seuls magistrats[14]. » (VII, 2, 8)
Un grand nombre de ces textes des Pères de l’Église sont bien connus des théologiens et des canonistes et ont été pour une large part intégrés au Décret de Gratien (v. 1140), dont une question est explicitement consacrée à la licéité de la peine capitale (C. 23, q. 5)[15]. Les pontifes s’inspireront, directement ou non, de leur position.
II. La pensée des papes
Autre lieu d’exposition de la Tradition, celui du magistère pontifical. Trois domaines sont à envisager ici, par ordre d’importance décroissante. Les papes ont apporté, en vertu de leur magistère, une justification doctrinale directe à la peine de mort, soit de manière générale (1), soit de manière particulière concernant le cas de l’hérétique (2). Ils ont également apporté une justification indirecte, en validant la peine de mort dans les États pontificaux en application de leur pouvoir temporel (3).
1. La justification générale
Les papes, de saint Pierre à saint Jean-Paul II, ont affirmé le caractère licite de la peine capitale comme moyen de « punir les malfaiteurs » (1 Pet. 2, 13–14). Le premier à expliciter ce sujet est Innocent Ier, répondant en 405 à saint Exupère de Toulouse, l’ayant interrogé sur le sort de ceux « qui ont prononcé des peines de mort » (Consulenti tibi, cap. III[16]). Ce texte décisif mérite d’être longuement cité. Le pape répond, avec une grande fermeté, que les anciens « étaient conscients de tenir ce pouvoir de Dieu, et que le glaive était permis pour se venger des nuisibles. C’est en tant que ministres de Dieu qu’il leur était donné d’exercer une telle vengeance. Comment donc auraient-ils condamné ce qu’ils considéraient comme l’œuvre de Dieu, dont ils étaient les intercesseurs ? C’est pourquoi en ce qui concerne ces personnes, selon la tradition jusqu’à aujourd’hui, faisons en sorte de ne pas nous éloigner de cette discipline, ni d’avoir l’audace de nous opposer à l’autorité du Seigneur. Il faut donc qu’ils continuent à rendre tous leurs jugements, de manière raisonnable. » Le pape poursuit sa justification doctrinale en précisant le rôle de l’enquête judiciaire dans la mise à mort du coupable. Il réaffirme qu’il est permis au prince, « après la régénération du baptême, de condamner quelqu’un à mort ou de verser le sang d’un accusé » une fois la cause entendue, causa cognita. De la sorte, « l’absolution ou la condamnation est prononcée en vertu de leur charge, et si l’autorité des lois a été exercée à l’encontre d’individus malhonnêtes, le dirigeant sera sans tache ».
Saint Grégoire le Grand, pape mais aussi Docteur et Père, enseigne la légitimité de la peine capitale dans plusieurs de ses lettres, reconnaissant qu’elle est méritée pour de graves forfaits. Il appuie le recours à la peine de mort sur le droit romain, en renvoyant à deux constitutions impériales (C. 1, 3, 10 et C. 1, 12, 2). En l’espèce, il s’agissait des violences exercées sur l’évêque Janvier de Malaga : « La loi punit l’auteur d’une telle injure de la peine capitale. » (XIII, 49) Dans une lettre à la reine Brunehaut (VIII, 4), il l’exhorte à « apaiser Dieu » en châtiant les adultères, les voleurs et les autres actions dépravées, passibles de mort.
Dans d’autres lettres, le pape avalise le principe de la peine, tout en faisant preuve de largesse afin qu’elle ne soit pas appliquée dans un cas précis. Ainsi de l’évêque Démétrius de Naples, qui « s’est trouvé impliqué dans de si nombreuses affaires que, s’il avait été jugé sans miséricorde selon l’importance de ses forfaits, il aurait été sans aucun doute puni d’une mort très cruelle par les lois divines et humaines[17] » (II, 1). Même intercession pour l’auteur du stupre sur la fille du diacre Félix où Grégoire sollicite l’indulgence en faveur de celui « qui est frappé par les lois d’une peine si grave[18]. » (III, 42)
Saint Nicolas Ier, dans sa Réponse aux Bulgares de 866, aborde un grand nombre de questions dogmatiques et canoniques. Si ce texte est connu, en droit pénal, pour son opposition à la torture judiciaire (cap. 86), il l’est moins pour ses prises de positions relatives à la peine de mort. Si le pape réclame parfois du roi la clémence ou la miséricorde (cap. 85), le principe de légitimité de la peine de mort est rappelé plusieurs fois[19]. D’abord quand il est interrogé sur la possibilité pour les tribunaux de rendre des jugements in festivitatibus sanctorum, et de condamner à mort ces jours-là (cap. 12). Le pape explique que, s’il convient de s’abstenir de toute œuvre mondaine, il faut à plus forte raison éviter les affaires séculières et donc s’abstenir des condamnations à mort. Il ajoute toutefois : « Quoique l’une et l’autre [affaire] puissent être exercées sans faute (sine culpa valeat exerceri), quand il s’agit des choses de Dieu, auxquelles l’homme doit plutôt être attaché, il convient qu’il se sépare tout à fait des choses de ce monde. » Le pape réitère son propos au sujet des jugements prononcés durant le carême (cap. 45).
Une autre réponse est encore plus éclairante sur la pensée du pontife : « Quant à ceux qui ont trucidé leur prochain, c’est-à-dire leur consanguin […] que les lois respectables trouvent leur application (venerandae leges proprium robur obtineant). Mais si les coupables se sont réfugiés à l’église, qu’ils soient arrachés à la mort promise par les lois. » (cap 26)
Urbain II, dans une décrétale adressée à l’évêque de Lucques, est allé plus loin en légitimant une peine de mort non encore judiciairement prononcée. Il « n’appelle pas homicides ceux qui, dans l’ardeur de leur zèle pour leur mère la sainte Église, ont mis à mort des excommuniés », mais demande tout de même qu’il leur soit infligé une pénitence convenable[20].
Innocent III a deux fois légitimé la peine de mort. En 1199, par la décrétale Vergentis (X, 5, 7, 10) établissant un parallèle entre les hérétiques et les fauteurs de lèse-majesté, il écrit : « Comme, selon les légitimes sanctions (legitimas sanctiones), les coupables de lèse-majesté sont punis de mort (punitis capite) […] combien plus les hérétiques qui offensent Jésus-Christ doivent être séparés de notre tête qui est le Christ. » En 1210, il complète la profession de foi prescrite aux Vaudois en 1208, et ajoute ce passage significatif : « Au sujet du pouvoir séculier, nous affirmons qu’il peut, sans péché mortel, exercer un jugement portant effusion de sang, pourvu que, pour exercer la vindicte, il ne procède pas par la haine mais par un jugement, ni avec imprudence mais avec modération[21]. »
Les recueils législatifs officiels reprennent le principe de la légitimation de la peine capitale. La décrétale Qui furatur (X, 5, 18, 1), paraphrasant l’Exode (21, 16), statue : « Celui qui aura volé un homme [commis un rapt], l’aura vendu et aura été convaincu de culpabilité, qu’il soit mis à mort[22]. » On y lit même une décrétale controuvée, attribuée à saint Grégoire, renvoyant faussement au Livre des Rois : « Qui non obedierit principi, morte moriatur[23]. » Une décision du concile œcuménique de Vienne de 1311–1312 (const. Quum secundum, Clem. 5, 9, 1), réprouve la coutume refusant la pénitence aux condamnés à mort, voulant qu’ils pussent recourir au sacrement avant cet « ultimo supplicio[24] ». Ici, l’abus condamné n’est pas la peine de mort, mais le refus d’apporter les remèdes spirituels au condamné. Le pape exhorte les magistrats et seigneurs temporels de faire respecter la possibilité pour le condamné de se confesser et de communier, et supplie les ordinaires d’y veiller, fut-ce au moyen de censures ecclésiastiques.
L’époque moderne n’est pas en reste. Le Catéchisme du Concile de Trente, publié par saint Pie V, reprend cet enseignement, en déclarant permis « les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent, et pour protéger les innocents » (III, 33).
Le pape Léon XIII expose que « les deux lois divines », naturelle et révélée, « défendent formellement que personne, en dehors d’une cause publique, blesse ou tue un homme » (DS 3272). Le Grand catéchisme de saint Pie X prolonge l’enseignement, listant les cas où il est « permis de tuer son prochain », notamment « quand, par ordre de l’autorité suprême, on exécute une condamnation à mort, châtiment de quelque crime » (III, 3, 2, n. 413). Pie XI rappelle l’existence de ce « jus gladii, qui ne vaut que contre les coupables » (Casti connubii, II, 2, § 64).
Le pontife qui a le plus abordé la question est Pie XII, ce qui n’est certainement pas étranger à sa formation juridique. À plusieurs reprises, il a repris et amplifié l’enseignement de l’Église sur la peine de mort. En 1944, alors que la guerre n’est pas finie, il rappelle les seules exceptions admissibles à l’intangibilité de la vie humaine : « Sauf les cas de défense privée légitime, de guerre juste menée par des moyens légitimes, de peine de mort infligée par l’autorité publique pour des délits très graves déterminés et prouvés, la vie humaine est intangible. » (Discours aux curés et prédicateurs de carême de Rome, 22 février 1944[25]) Cette même année, s’exprimant auprès de médecins, il rappelle que l’homme détient du Créateur « le droit sur son propre corps et sur sa vie » et « il s’ensuit que la société ne peut directement le priver de ce droit, aussi longtemps qu’il n’aura pas encouru une telle punition, comme sanction d’un crime grave et proportionnée à cette peine » (Allocution à l’union médico-biologique S. Luc, 12 novembre 1944[26]). C’est pourquoi il ajoute, dans le droit fil de la Tradition : « Tant qu’un homme n’est pas coupable, sa vie est intangible. » C’est le même constat qu’il formule l’année suivant devant des chirurgiens : « À moins qu’un homme soit coupable de quelque crime méritant la peine de mort, Dieu seul et nul pouvoir terrestre ne peut disposer de la vie. » (Allocution à un groupe de médecins chirurgiens, 13 février 1945[27])
Le mérite de Pie XII est d’avoir su élever le débat au niveau des principes, dans une formulation claire et concise qui distingue le droit à la vie du bien de la vie : « Quand il s’agit de l’exécution d’un condamné à mort, l’État ne dispose pas du droit de l’individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s’est déjà dépossédé de son droit à la vie. » (Allocution au Congrès d’histopathologie, 13 septembre 1952[28])
Jean-Paul II, dans une grande continuité doctrinale, a repris cet enseignement. Dans la première version du CEC, il écrivait : « L’enseignement traditionnel de l’Église a reconnu le bien-fondé du droit et du devoir de l’autorité publique légitime de sévir par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure, dans les cas d’une extrême gravité, la peine de mort » (§ 2266). Le même catéchisme enseigne que « la défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent », puisqu’il ne s’agit pas là d’homicide (§ 2263).
L’encyclique Evangelium vitæ du 25 mars 1995 marque un tournant prudentiel mais non doctrinal, puisque le pape, tout en reconnaissant la possibilité théorique pour l’État de recourir à la peine capitale, présentée comme « un moyen de “légitime défense” de la société », salue l’orientation actuelle de l’opinion publique dans un sens abolitionniste (n. 27). Il indique que dans l’hypothèse de légitime défense sociale, « l’issue mortelle doit être attribuée à l’agresseur lui-même qui s’y est exposé par son action » (n. 55), et déclare licite la suppression du coupable « en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement » (n. 56). Ce texte se retrouvera dans l’édition typique du CEC : « L’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains[29]. » (§ 2267)
2. La justification particulière
L’affirmation de la licéité du recours général à la peine de mort se double d’une légitimation dans un cas particulier, celui de l’hérétique livré de ce fait au bras séculier. Comme l’indique Gratien, il revient à l’État de s’occuper de ceux contre qui l’Église ne peut plus rien : « A principibus corrigantur quos Ecclesia corrigere non valet » (C. 11, q. 1, c. 20). C’était déjà la solution retenue lors du 3e concile de Tours, en 813, « il convient de châtier, par la discipline des puissances séculières, la si mauvaise habitude de ceux qui n’ont pas voulu se convertir par les salutaires monitions des prêtres[30]. » (can. 41) En découle alors la remise à la puissance publique, au bras séculier, en vue d’une condamnation à mort. La justification théorique du recours au bras séculier est fondée sur les Écritures au sujet du meurtrier : « Tu l’arracheras de mon autel pour qu’il meure » (Ex 21, 14), texte ouvrant le titre De l’homicide volontaire ou involontaire dans les Décrétales de Grégoire IX (X, 5, 12). Dans les faits, un tel recours fut pratiqué dès le Ve siècle.
Saint Léon le Grand, Docteur de l’Église, se félicite de la livraison d’un hérétique et de ses sectateurs dans sa décrétale Quam laudabiliter de 447, censurant les erreurs des priscillianistes : « C’est à juste titre que nos pères […] ont agi avec fermeté pour que cet égarement impie soit chassé de toute l’Église : les princes du monde également ont abominé à ce point cette folie sacrilège, qu’ils ont abattu son auteur [Priscillien] par l’épée des lois publiques, en même temps que la plupart de ses disciples. Ils voyaient en effet que le lien des mariages serait entièrement défait, et que de même la Loi divine et humaine serait subvertie, s’il était permis à de tels hommes de vivre avec une telle profession en quelque lieu que ce soit. Pendant longtemps cette sévérité a profité à la douceur ecclésiastique, laquelle, même si elle se contente du jugement des prêtres et évite les peines sanglantes, reçoit néanmoins l’aide des décrets sévères des princes chrétiens, puisqu’on voit parfois recourir au remède spirituel ceux qui craignent le supplice corporel[31]. »
Le pape Simplice, en 478, recommande à l’empereur Zénon de mettre à mort les assassins d’évêques. Ces sacrilèges sont « dignes de périr par ces supplices, en quoi l’Église et l’Empire trouveront le repos […] et s’attireront les faveurs divines ceux qui ont la charge de ne pas laisser impunis les sacrilèges[32] » (Ep. XII). La même justification est donnée par Pélage Ier, dans une lettre au duc d’Italie : « Ne pense pas que c’est un péché de punir de tels individus [des évêques réfractaires]. Il est établi par les lois divines et humaines que les perturbateurs de la paix et de l’unité de l’Église soient réprimés par le pouvoir civil, et c’est le plus grand service que vous puissiez rendre à la religion. » (Ep. I[33]) Honorius Ier reconnaît encore ce pouvoir, et demande à ce que l’auteur d’un stupre « reçoive la peine du supplice ultime, afin que la punition à son encontre ne soit pas retardée, et que la sentence du jugement divin soit connue du plus grand nombre. » (Ep. XIII[34])
Au temps de la chrétienté médiévale, les papes Lucius III, Innocent III, Grégoire IX et Boniface VIII ont adopté des décrétales, passées dans la législation universelle, prévoyant le renvoi de l’hérétique au bras séculier[35]. Ces textes prévoient la livraison du coupable « animadversione debita puniendus », pour être punis de la correction qui leur est due. Pour qu’il n’y ait aucun doute sur la sentence, la glose ajoute : « La punition due est la crémation par le feu. » Boniface VIII va jusqu’à menacer de sanctions les autorités temporelles qui ne procèderaient pas sans délai (indilate) à l’exécution des hérétiques.
En 1215, lors du IVe concile du Latran (12e œcuménique), est adopté le canon Excommunicamus qui ordonne d’abandonner les hérétiques condamnés « aux puissances séculières » (can. 3)[36]. Solution reprise par le concile de Constance (16e œcuménique) contre les wyclifites et les hussites[37]. Le pape Martin V, en 1418, rédige un questionnaire de foi demandant explicitement si l’on croit en la possibilité pour les prélats « de faire appel au bras séculier[38] » (art. 32). Léon X, en 1520, condamnant les faussetés de Luther, y trouve cette erreur réprouvée : « Que les hérétiques soient brûlés, c’est contre la volonté de l’Esprit[39]. »
Saint Pie V dégrade les clercs convaincus du péché de Sodome et les remet à l’autorité civile « pour y recevoir le supplice dont les constitutions des princes ont légitimement sanctionné ce crime chez les laïcs[40]. » Dans une autre occasion, il rappelle que les clercs perturbateurs de la paix publique « peuvent être, en tant que laïcs [i.e. dégradés] et par une cour séculière, condamnés à une peine qui va jusqu’à la vengeance du sang et au supplice ultime[41]. »
3. La justification indirecte
Dernière preuve de la légitimité de la peine de mort, la pratique des souverains pontifes. Il ne s’agit ici que d’une justification indirecte, mais il est évident que si une telle pratique était contraire à l’Évangile, elle n’aurait pas eu droit de cité dans les États pontificaux. Or c’est exactement le contraire qui s’observe. La peine de mort a été prévue et appliquée par les pontifes successifs jusqu’à la suppression des États pontificaux en 1870, et elle a même été prévue, par le Code pénal du Saint-Siège, pour les cas de tentatives d’assassinat sur la personne du pape, de 1929 à 1969[42]. Dans leurs États, les papes n’ont pas fait montre d’une clémence abolitionniste envers les coupables. De 1796 à 1865, Giovanni Battista Bugatti, le bourreau des papes surnommé le « maître de justice », a exécuté 516 condamnés à mort par la justice pontificale, parfois pour des vols à main armée.
Au-delà de ce décompte macabre, il convient de donner un aperçu rapide et varié de la liste des crimes punis de mort par la puissance temporelle des papes, limité à la période moderne. Léon X donne au gouverneur de la Ville le pouvoir d’agir contre les criminels, « de les corriger, de les châtier et de les punir jusqu’à la peine de mort inclusivement[43] ». Jules III lui donne la même faculté contre « ceux qui ont mérité le supplice ultime et la peine capitale[44] ». Ce même pontife a prévu la peine de mort pour les détenteurs des exemplaires du Talmud non expurgés de leurs blasphèmes contre le Christ[45]. Paul IV l’a prévue pour les proxénètes[46]. Saint Pie V pour les gens de justice qui violent le secret de l’instruction[47] ; pour ceux qui altèrent la monnaie par rognage[48] ; ou encore contre les banqueroutiers, pour que « ceux que la crainte de Dieu n’a pas éloignés du mal, la peine du supplice ultime les en retire[49] ». Il n’est d’ailleurs peut-être pas anodin de constater que ce pape, le seul élevé à la gloire des autels entre le XIVe et le XXe siècle, soit celui qui ait prévu le plus largement l’application de la peine capitale, et restauré les privilèges de la confrérie de Saint-Jean-le-Décollé, volant au secours spirituel des condamnés à mort.
Sixte V l’inflige aux maris séparés de corps se vautrant publiquement dans la luxure[50] ou aux incestueux[51]. Clément VIII la prévoit pour les exportateurs récidivistes, en cas de famine[52]. Urbain VIII pour les astrologues[53]. Il a aussi confirmé un motu proprio de saint Pie V accordant à l’ordre des Hospitaliers le pouvoir de punir de mort les faux-monnayeurs, fussent-ils ecclésiastiques[54]. Innocent X l’ordonne contre les faussaires de lettres apostoliques[55].
Innocent XII confirme les cardinaux dans leur privilège de pouvoir terminer, lors de leurs visites apostoliques dans la ville de Rome, toutes les causes, tant civiles que criminelles, « sans scrupule de conscience ni encourir de censure ou d’irrégularité, même en cas d’effusion de sang, de mutilation de membres ou encore de supplice ultime[56] ». Clément XII punit de mort l’usage d’explosifs[57].
Cette liste non exhaustive s’accommode mal d’une condamnation radicale de toute légitimité de la peine de mort, au nom de l’Évangile. Cet aspect pratique est d’ailleurs confirmé par l’enseignement des théologiens.
III. La pensée des Docteurs
Les Docteurs de l’Église ont, eux aussi, enseigné la licéité de la peine de mort, tels saint Anselme ou saint Albert le Grand[58].
Saint Bernard de Clairvaux, proclame au sujet des hérétiques s’exprimant publiquement : « Il serait mieux sans doute qu’ils fussent punis par l’épée de celui qui ne la porte pas en vain, que de souffrir qu’ils en entraînassent d’autres dans leurs erreurs. Car il est ministre de Dieu, et il doit juger sévèrement celui qui fait mal (Rm 13, 4). » (Sermons sur le Cantique, LXVI, 12)
Saint Bonaventure, dans un sermon sur les préceptes, s’en prend aux manichéens qui déforment la pensée chrétienne du non occides et refusent la peine capitale. Il répond : « Quand le ministre de la loi exécute, c’est la loi qui tue l’homme, et ceci en observant le droit, une juste cause et un esprit de justice », et dans ce cas, le bourreau s’exécute « non par désir de vengeance, mais par amour de la justice[59]. » (Sermo VI)
Saint Pierre Canisius, dans son Grand catéchisme, expose que se rendent coupables par connivence du péché d’autrui « les magistrats qui portent le glaive sans en faire usage, et qui ne sont ministres de Dieu que de nom, ne se mettant point en peine de réprimer ceux qui commettent le crime ou excitent des séditions[60] » (II, 1, 3, 9).
Saint Robert Bellarmin affirme également, dans ses Controverses consacrées aux laïcs : « Il est licite aux magistrats chrétiens de punir par le glaive les perturbateurs de la paix publique[61]. » Il prouve cette légitimité par les Écritures, par les Pères et par la raison.
Saint Alphonse de Liguori, patron céleste des moralistes, l’écrit aussi : « En dehors des cas de légitime défense, il n’est permis à personne [de tuer des malfaiteurs], sauf à l’autorité publique, et selon les lois[62]. »
Il y a surtout saint Thomas d’Aquin, qui a consacré un article de la Somme de théologie à justifier l’emploi de la peine capitale par l’autorité investie du bien commun (IIa IIae, q. 64, a. 2 ; cf. aussi Ia IIae, q. 100, a. 8, ad 3). Sa conclusion est nette : « Si donc quelque individu devient un péril pour la société et que son péché risque de la détruire, il est louable et salutaire de le mettre à mort pour préserver le bien commun ; car “un peu de ferment corrompt toute la pâte” ». (1 Co 5, 6) Il répond d’avance aux arguments tirés de la dignité humaine : « Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine. » Dans la Somme contre les Gentils, il résume les principales objections et réfute « l’erreur de certains hommes qui disent que les châtiments corporels ne peuvent se faire licitement » (III, 146). Il ajoute même, « haec autem frivola sunt, car s’il est dit dans la Loi : Tu ne tueras point, il est ajouté après : Tu ne laisseras point vivre les auteurs de maléfices (Ex 22, 18) ». D’autres passages de la Somme renvoient à la peine capitale, dans les mêmes termes (Ia IIae, q. 87, a. 3 ; IIa IIae, q. 25, a. 6, ad 2 ; IIa IIae, q. 65, a. 2, ad 2 ; IIa IIae, q. 66, a. 6, ad 2).
D’autres saints docteurs, tels Antonin « des bons conseils », justifient la peine capitale et repoussent « l’erreur de ceux qui disent que ce précepte [non occides] interdit la mise à mort de tout homme, même malfaiteur. De là, ils appellent homicides les juges et les officiers qui mettent à mort les coupables[63] ». Il oppose l’autorité d’Augustin et de l’Écriture, puis ajoute : « Les juges, en mettant à mort les coupables selon l’ordre juridique, tuent sur mandat de Dieu, qui a établi les lois ordonnant la mise à mort des coupables. »
Les clercs savants, tant théologiens que philosophes, ont brandi le verset de saint Paul sur le glaive porté par l’autorité, et l’ont « sans cesse allégué dès la fin du Moyen Âge en faveur du jus gladii des rois[64] ». Ils ont été suivis par l’unanimité des moralistes catholiques, parmi lesquels on peut relever les noms des Salmanticenses[65], Cajetan, Vitoria[66], Suarez[67], Laymann[68], Jean de Saint-Thomas[69], Billuart, Tanquerey[70], Labourdette, o.p.[71], etc[72].
1. Les raisons du changement
Face à une telle avalanche d’autorités, et une tel assentiment doctrinal, il convient de s’interroger sur les raisons du changement survenu dans l’enseignement ecclésiastique. Le 1er août 2018, le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié une Lettre aux évêques à propos de la nouvelle formulation du Catéchisme de l’Église catholique sur la peine de mort. Cette lettre tente de justifier cette innovation comme s’inscrivant « dans la continuité du Magistère précédent » (n. 7), faisant montre d’un « développement authentique de la doctrine, qui ne contredit pas les enseignements antérieurs du Magistère » (n. 8), et en avance les arguments.
Parmi ceux-ci, figurent d’une part une « compréhension profonde du sens des sanctions pénales de la part de l’État » (n. 2), une prise en compte de la « nouvelle compréhension des sanctions pénales appliquées par l’État moderne » (n. 7), à l’encontre d’un ancien « contexte social où les sanctions pénales étaient comprises de manière différente » (n. 8). En résulte un alignement sur la conception contemporaine, mondaine, qui considère les peines comme devant « tendre avant tout à la réhabilitation et à la réintégration sociale du criminel » (n. 7). Le texte même du nouveau § 2267 reprend cette idée, déclarant que « s’est répandue une nouvelle compréhension du sens de sanctions pénales de la part de l’État ».
D’autre part, le document vise un second argument juridique, celui d’une « nouvelle prise de conscience qui reconnaît le caractère inadmissible de la peine de mort et en demande donc l’abolition » (n. 2). Le nouveau § 2267 dit explicitement que l’Église « s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition partout dans le monde ».
La philosophie du droit pénal est donc directement intéressée, et précisément la question du sens de la peine, qui semble être une clef de lecture pertinente en ce qu’elle motive la « nouvelle compréhension » qui a déterminé ce changement de doctrine. Que penser de cette manière de voir la peine ? Outre la naïveté de croire que les Anciens, jusqu’à Jean-Paul II inclus, n’en aient pas compris le sens, il y a lieu de distinguer les finalités qui lui sont attribuées.
De manière classique, trois fonctions sont assignées à la peine : une fonction vindicative, tendant à restaurer l’ordre lésé, à faire expier le crime ; une fonction exemplaire, cherchant à dissuader la récidive, à intimider le délinquant potentiel ; une fonction médicinale, visant à l’amendement du coupable, à son redressement[73]. Une telle présentation se trouve d’ailleurs dans le CEC : « La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal : elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable[74]. » (§ 2266)
Il s’agit là d’une vision très ancienne, que l’on retrouve par exemple chez saint Grégoire le Grand. La punition adéquate se compose « de telle manière qu’une unique action comprenne à la fois un châtiment proportionné pour le délinquant, et un motif de crainte pour ceux qui partagent son ordre[75] » (XII, 11). Il cherchait « une punition telle que Dieu en soit apaisé, et que le châtiment soit un exemple qui induise les autres à la correction[76] » (VIII, 19). La peine a pour lui une finalité sociale, en évitant la contagion du mal et en promouvant la dissuasion, et une finalité individuelle, étant pensée comme un dû et un châtiment, pour que « la punition corrige la faute[77] » (IX, 86).
Or cette vision, donnant une place de choix à « la colère de Dieu » (Rm 13, 4), à l’aspect vindicatif, seul mentionné dans les Écritures, a subi les assauts d’un courant philosophique moderne, développé en deux temps. D’abord, suite au « choc positiviste italien », les doctrines pénales classiques sont contestées tout au long du XIXe siècle au gré de nombreux congrès internationaux, notamment quant au problème du libre arbitre[78]. Ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’école dite de la Défense sociale nouvelle, animée par le magistrat français Marc Ancel et l’avocat italien Felipo Gramatica, entend rejeter totalement l’aspect vindicatif au profit de l’aspect médicinal. Le premier Congrès international, organisé en 1947, adopte à l’unanimité une résolution significative : « La peine de mort doit être supprimée[79] ». Les travaux de cette école écartent les trois justifications essentielles de la peine de mort, que sont l’expiation, la rétribution et l’intimidation. En 1954, la Société internationale de défense sociale adopte un Programme minimum, dont l’idée de base est la défense de la société « par le biais de l’adaptation et de la resocialisation du délinquant[80] ».
Pie XII, conscient du danger que cette hostilité de principe à la peine de mort faisait courir à la doctrine, a mis en garde contre « beaucoup, peut-être la majorité des juristes civils [qui] repoussent la peine vindicative » et préfèrent la nouveauté à la continuité doctrinale. L’Église, affirme-t-il, « en théorie et en pratique, a maintenu la double sorte de peines (médicinales et vindicatives), et cela est plus conforme à ce que les sources de la révélation et la doctrine traditionnelle enseignent au sujet du pouvoir coercitif de l’autorité humaine légitime » (Discours aux juristes catholiques italiens, 5 février 1955[81]). Refusant l’objection d’une contextualisation indue des textes pauliniens, il affirme hautement qu’il y a lieu d’y voir un droit naturel : « Les paroles qu’on trouve dans ces sources et dans le magistère vivant ne se réfèrent pas au contenu concret de prescriptions juridiques ou de règles d’action particulières, mais au fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente. Quant à celle-ci, elle est aussi peu déterminée par les conditions de temps et de culture, que la nature de l’homme et la société humaine voulue par cette même nature. »
Déjà en 1953, il avait tenu à répondre à des pénalistes s’inquiétant de la mutation en cours. S’il laissait « à la théorie et à la pratique le soin de définir le rôle de la peine dans le sens moderne plus étroit ou dans l’autre plus large », il avertissait : « Qu’on ne renonce pas à envisager cette dernière motivation de la peine [vindicative] uniquement parce qu’elle n’apparaît pas apte à produire des résultats pratiques immédiats » (Discours au VIe Congrès international de droit pénal, 3 octobre 1953[82]) Il se livre alors à un plaidoyer « mémorable » (dixit Paul VI[83]) et proprement religieux de « la fonction expiatoire [qui] seule permet finalement de comprendre le jugement dernier du Créateur lui-même, qui “rend à chacun selon ses œuvres”, comme le répètent souvent les deux Testaments (cf. surtout Mt 16, 27 ; Rm 2, 6). Ici la fonction de protection disparaît complètement, lorsque l’on considère la vie de l’au-delà. Pour la toute-puissance et l’omniscience du Créateur, il est toujours facile de prévenir tout danger d’un nouveau délit par la conversion morale intime du délinquant. Mais le Juge suprême, dans son jugement final, applique uniquement le principe de la rétribution. Celui-ci doit donc certes posséder une valeur qui n’est pas négligeable ».
Dans sa profonde réflexion sur le rôle de la peine, Pie XII enseigne qu’elle doit « ramener à nouveau dans l’ordre du devoir le violateur du droit qui en était sorti » (Discours aux juristes italiens, 5 décembre 1954[84]). La peine accomplit son office « à sa façon, en tant qu’elle force le coupable à une souffrance, c’est-à-dire à la privation d’un bien et à l’imposition d’un mal ». De la sorte, il n’est « pas juste de repousser en principe et totalement la fonction de la peine vindicative. Tant que l’homme est sur la terre, elle peut et doit servir à son salut définitif »[85]. Il observe l’aspect psychologique de la peine, et le cas particulier de la peine de mort qui, « en intensité et en profondeur […] surpasse toute mesure de temps[86] ». Du point de vue moral, Pie XII insiste sur l’acceptation volontaire de la peine, constitutive de « progrès dans la vie intérieure »[87].
Le pasteur angélique semble répondre par avance à l’argument tiré de l’erreur judiciaire, en définissant la certitude morale nécessaire au juge, et surtout, en dépassant le seul horizon terrestre : « On ne doit pas non plus oublier qu’aucune sentence humaine ne décide en dernière instance et définitivement le sort d’un homme, cela revient uniquement au jugement de Dieu […] pour tous les cas où les juges humains viennent à faillir, le Juge suprême rétablira l’équilibre[88]. » Il pointe du doigt l’élément scriptural propre à cette doctrine, celui de l’autorité humaine comme « exécutrice de la justice divine » en ce qui touche à « l’accomplissement de la peine[89] ». Ce faisant, il poursuit ici l’enseignement du docteur angélique, présentant comme une grâce supplémentaire offerte au condamné que d’avoir en ce monde la possibilité d’une remise de la dette due pour son péché, ce que ne fait pas la mort naturelle (IIa IIae q. 25, a. 6, ad 2).
Enfin, si le programme pénal de la Défense sociale, contestant l’utilité des peines, prévoyait logiquement une dépénalisation renforcée et marquait une grande réticence à l’égard de l’emprisonnement, le nouveau texte du CEC n’a pas cette clarté, en ce qu’il récuse la peine capitale uniquement au profit de « systèmes de détention plus efficaces ». Il y a là une incohérence qu’avaient relevée des juristes médiévaux, tels Jesselin de Cassagnes, considérant la simple prison (carcer durus) comme une peine plus afflictive que la mort en raison de la trop longue souffrance qu’elle inflige[90].
Le second versant de cette « nouvelle compréhension » de la peine est sa conséquence logique, l’abolition de la peine de mort. Il s’agit ici de l’abolitionnisme, doctrine pénale moderne visant à éliminer le principe même du recours à la condamnation à mort, estimée être un mal intrinsèque. Ébauché par les hérétiques vaudois du XIIIe siècle, ce courant philosophique naît véritablement avec les Lumières, sous une forme mitigée, plus particulièrement sous la plume du criminaliste italien Cesare Beccaria, suivi par l’utilitariste Jérémy Bentham[91]. L’abolitionnisme est plus que teinté d’utilitarisme, puisqu’il s’agit de ne penser à la fonction de la peine qu’en termes de réadaptation du coupable au sein de la société, pour motif de rentabilité. « Quoi qu’il ait fait – même le crime le plus abominable – il se trouvera toujours pour lui un travail, une entreprise, une certaine utilité économique dans sa réinsertion[92]. »
Il y a eu, dès le XIIe siècle, un courant juridique opposé à l’application de la peine de mort, notamment dans le sillage de l’école provençale du temps de Rogerius, qui s’appuyait sur un texte du droit romain permettant les compositions pécuniaires (règlement privé du litige) en cas de crime capital (exceptés l’adultère et le rapt)[93]. La justification se tirait de l’utilité publique : « Il faut permettre les transactions pour éviter que les hommes ne soient tués, car il est plus utile à l’État de les conserver en vie plutôt que de les envoyer au supplice en interdisant les transactions. » Mais l’existence même d’exceptions ne fait pas de ces juristes de vrais abolitionnistes, opposés par principe à la peine capitale. Il y avait là, de manière très classique, une option prudentielle de rejet de l’application de la peine de mort, mais non du principe.
Le courant abolitionniste, à l’inverse, s’appuie sur la nouvelle conception de la peine, comme moyen d’insertion du coupable plutôt que comme punition et châtiment du criminel. Il prétend disqualifier par principe le recours à cette punition ultime, en inférant d’une position prudentielle (le droit positif, actuel ou souhaité) contre une position de principe relevant du droit naturel. Or, en ce domaine de l’application positive d’une prérogative naturelle, la question morale n’est pas celle de la légitimité, mais celle de l’opportunité, comme l’enseignait le cardinal Ratzinger, pour qui « les catholiques peuvent légitimement avoir des opinions différentes sur la guerre ou la peine de mort » (Être digne de recevoir la sainte communion. Principes généraux, juin 2004).
Le ralliement doctrinal à l’abolitionnisme est lourd de conséquences, à deux niveaux. Le premier est qu’il entend retrancher définitivement à l’État un moyen légitime de punition. La licéité du recours à cet arsenal pénal faisant partie de « l’enseignement traditionnel de l’Église », il est facile d’en conclure que ce point relève du droit naturel, de la nature de l’État et de ses prérogatives, dont l’autorité (qui lui vient de Dieu) s’étend jusqu’à la vie de ses citoyens. Saint Thomas d’Aquin l’établit sans ambages : « Le bien commun est meilleur que le bien particulier de l’individu. Donc il faut sacrifier le bien particulier pour conserver le bien commun. Or, la vie de quelques individus dangereux s’oppose à ce bien commun qu’est la concorde de la société humaine. Donc on doit soustraire par la mort ces hommes de la société humaine. » (Contra gentes, III, 146)
L’histoire du droit pénal montre la variété des crimes graves contre lesquels l’État a voulu sévir définitivement. Ce furent tour à tour les voleurs, les incendiaires, les homicides, les faussaires, les parjures, les faux-monnayeurs, les adultères, etc. C’est là un exemple de ce qu’est un droit positif, à savoir une application dans le temps et dans l’espace d’un principe directeur relevant de la nature des choses. Il est naturel de punir les coupables, mais c’est à chaque société de fixer l’échelle de gravité des crimes et des délits, et de juger avec prudence ceux qui méritent la mort, s’il en est.
Le second niveau de conséquences est peut-être plus grave encore, du point de vue du rôle et des missions du souverain pontife. Si la peine de mort appartient bien au droit naturel, et si l’Église a constamment enseigné sa légitimité, alors se pose la question, au-delà du simple aspect prudentiel de l’acceptation ou de l’opposition à la peine capitale hic et nunc, de savoir si le pape peut modifier la doctrine, s’il peut, tel une antique pythie, prononcer des oracles contradictoires. Jean-Paul II, fidèle à la Tradition, s’y opposait : « Le Pontife Romain a la « sacra potestas » d’enseigner la vérité de l’Évangile, d’administrer les sacrements et de gouverner de façon pastorale l’Église au nom et avec l’autorité du Christ, mais cette puissance n’inclut en soi aucun pouvoir sur la Loi divine naturelle ou positive. » (Discours à la Rote romaine, 21 janvier 2000) La constitution apostolique Pastor Æternus précisait : « Le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. » Au-delà de la seule question de la peine de mort, se pose celle d’une rupture envisageable dans la Tradition, ouvrant la porte à toute modification doctrinale ultérieure.
Cyrille Dounot
[1]. Ch. Journet, L’Église du Verbe incarné, t. 1, La hiérarchie apostolique, Saint-Maurice, éditions Saint-Augustin, 1998, p. 575.
[2]. Sur le contexte biblique du talion, cf. G. Cardascia, « La place du talion dans l’histoire du droit pénal à la lumière des droits du Proche-Orient ancien », Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, pp. 169–183.
[3]. Ch. Journet, op. cit., pp. 568–570, qui emprunte un passage à R. Maritain, Le prince de ce monde, Paris, 1932, p. 17.
[4]. De duodecim [vel nono] gradibus abusionum, II, 1.
[5]. PL 16, 1040.
[6]. Hilaire de Poitiers, Sur Matthieu, éd. et trad. J. Doignon, Cerf, 1979 (Sources chrétiennes n. 258), t. 2, p. 243.
[7]. Saint Augustin, Dialogues philosophiques, t. III, De l’âme à Dieu, trad. F. J. Thonnard, Desclée de Brouwer [Œuvres de saint Augustin, 1ère série, opuscules, VI], Bruges, 1941, p. 151.
[8]. Traduction du chanoine Péronne, Œuvres complètes de saint Augustin, t. 18, Vivès, 1872, p. 608.
[9]. On trouve chez Optat de Milève de semblables justifications de la mise à mort des hérétiques, cf. Traité contre les donatistes, éd. et trad. M. Labrousse, Cerf, 1996 (Sources chrétiennes n. 413), III, 5, 1–3 ; III, 6, 1–2 ; III, 7, 5–7 pp. 49, 51, 55.
[10]. Traduction, légèrement modifiée, de l’abbé Bareille, Œuvres complètes de saint Jérôme, t. 10, Vivès, 1884, p. 285.
[11]. PL 24, 811.
[12]. S. Jean Chrysostome, Œuvres complètes, trad. M. Jeannin, L. Guérin & Cie éditeur, Clermont-Bar-le-Duc-Paris, 1865, t. 5, p. 456.
[13]. Id., p. 572.
[14] Éd. et trad. M. Metzger, Cerf, 1987 (Sources chrétiennes n. 336), p. 29.
[15] Sur ces aspects, cf. J. Gaudemet, « Non occides (Ex 20, 13) », A. Melloni et alii (dir.), Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo, Bologne, 1996, pp. 89–99.
[16]. PL 20, 499 ; JK 90.
[17]. Traduction de l’abbé J.-Y. Pertin, Justice et gouvernement dans l’Église d’après les Lettres de saint Grégoire le Grand, L’Harmattan, 2015, p. 293. Les références des lettres sont celles de l’édition D. Norberg, Gregorii Magni Registrum epistularum, CCSL 140–140A, Tournai, 1982.
[18]. Comme le montre l’abbé M. Lefrançois, La peine de mort et l’Église en Occident, d’après les sources chrétiennes, de Tertullien à Hincmar de Reims (197–882), Thèse droit, Bordeaux, 2003, l’Église a tenu à la fois la légitimité du principe et la mansuétude dans l’application.
[19]. Responsa ad consulta Bulgarorum, PL 119, 978‑1016.
[20]. JL 4142, repris par Gratien, C. 23, q. 5, c. 47.
[21]. H. Denzinger, Symboles et définitions de la foi catholique, Cerf, n. 795, p. 289. Désormais DS.
[22]. Sur ces recueils et leurs commentateurs, cf. H. Gilles, « Peine de mort et droit canonique », La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe siècles), Privat [Cahiers de Fanjeaux, 33], Toulouse, 1998, pp. 393–416.
[23]. Si quis venerit (X, 1, 33, 2) : « Qui n’obéit pas au prince, qu’il soit puni de mort. » La glose ajoute que l’Église ne prononce pas ce genre de peine, mais que ce texte sert à indiquer au juge séculier ce qu’il peut faire.
[24]. Cette règlementation universelle avait été précédée par d’autres, locales, aux VIIe et IXe siècle, comme le can. 27 du concile de Mayence de 847 (C. 13, q. 2, c. 30), cf. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, Paris, 1681, t. 3, p. 99–103 (IV, 2, 27).
[25]. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, t. 6, Éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 1963, p. 38–39.
[26]. Ibid., p. 203.
[27]. Ibid., t. 7 (1964), p. 49.
[28]. Ibid., t. 14 (1955), p. 463.
[29]. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église, publié en 2004 par le Conseil pontifical Justice et Paix, reprend cet enseignement, au § 405.
[30]. C. 23, q. 5, c. 22.
[31]. Lettre XV, PL 54, 680 ; DS 283. Ce passage sera repris par le IIIe concile du Latran (11e œcuménique) juste avant l’anathème contre les Albigeois : « Comme l’a dit le bienheureux Léon [Ier], etc. » (can. 27).
[32]. Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Turin, 1867, Appendix, t. 1, p. 221 (désormais B).
[33]. PL 69, 394.
[34]. PL 80, 481 ; JE 2025 ; Mansi X, 585.
[35]. X, 5, 7, 9 ; 13 ; 15 et VI, 5, 2, 18. Voir aussi VI, 5, 9, 5, où Boniface VIII prévoit de livrer à l’État les assassins des cardinaux : « Nous n’ôtons pas aux puissances séculières la faculté d’user contre eux des lois que les princes catholiques ont édictées contre les sacrilèges », à savoir la mort.
[36]. Ce texte passera dans les Décrétales de Grégoire IX, compilation officielle du droit de l’Église (X, 5, 7, 13).
[37]. Tant dans les articles condamnés de Wyclif en 1415, ici le 41e, que dans ceux de Jean Hus, là le 14e, cf. A. Alberigo (dir.) ; Les conciles œcuméniques, t. 2–1, Les décrets, Cerf, 1994, pp. 877 et 887.
[38]. DS 1272, p. 370.
[39]. DS 1483, p. 408.
[40]. Horrendum illud, 1568, Bullarium [désormais : B], t. 7, p. 703.
[41]. Exposito alias, 1567, B, t. 7, p. 620. Faculté renouvelée par Grégoire XIII, Exponi nobis, 1572, B, t. 8, p. 20.
[42]. Cardinal A. Dulles, « Catholicism an Capital Punishment », First Things, n. 112, 2001, p. 31, cité par E. Feser, J. Bessette, By Man Shall His Blood be Shed. A Catholic Defense of Capital Punishment, Ignatius, San Francisco, 2017, p. 127.
[43]. Etsi pro, 1514, B, t. 5, p. 615.
[44]. Ad fidei, 1550, B, t. 6, p. 410.
[45]. Cum sicut, 1554, B, t. 6, p. 482.
[46]. Volens sceleribus, 1558, B, t. 6, p. 538.
[47]. Licet contra, 1568, B, t. 7, p. 696.
[48]. Cum nil, 1570, B, t. 7, p. 861.
[49]. Postquam eousque, 1570, B, t. 7, p. 862.
[50]. Ad compescendam, 1586, B, t. 8, p. 791, « afin que la crainte du châtiment arrache de la débauche et des forfaits ».
[51]. Volentes quantum, 1587, B, t. 8, pp. 831–832.
[52]. Frumenti penuriam, 1597, B, t. 10, p. 374.
[53]. Inscrutabilis judiciorum, 1631, B, t. 14, p. 212.
[54]. Alias nos, 1642, B, t. 15, p. 202.
[55]. In supremo, 1653, B, t. 15, p. 710.
[56]. Quoniam in prosequendo, 1693, B, t. 20, p. 502.
[57]. In supremo justitiae, 1735, B, t. 24, p. 32.
[58]. Cités par E. Feser, J. Bessette, op. cit., p. 119.
[59]. S. Bonaventura, Opera omnia, Vivès, 1868, t. 12, p. 250.
[60]. Le grand catéchisme de Canisius, trad. A. C. Peltier, Vivès, 1857, t. 4, p. 70.
[61]. De controversiis christianae fidei, adversus hujus temporis haereticos, II, 3, 13, éd. Ingolstadt, 1591, t. 2, col. 653.
[62]. Theologia moralis, III, 3, 1, 2, 2 (n° 376 à 379), éd. Venise, 1773, t. 1, p. 157.
[63]. Summa moralis I, 14, 5, 3, dans Opera omnia, éd. Florence, t. 1, 1741, t. 1, pars. 1, col. 1147.
[64]. J.-M. Carbasse, art. cit., p. 167.
[65]. Cursus theologiae moralis, tract. XXV, 1, 2 (n° 11 s.), éd. Madrid, 1733, t. 6, p. 45.
[66]. Relectiones theologiae, De homicidio X, 16–18, éd. Lyon, 1557, t. 1er, p. 129.
[67]. Opus de triplici virtute theologica fide, spe & charitate, XXIII, 1, 2, éd. Lyon, 1621, p. 374, qui va jusqu’à dire : « Il n’est rien moins que catholique d’affirmer que l’Église peut justement punir de mort les hérétiques »,et plus loin : « cette peine [de mort] n’est pas seulement juste, en tant que vindicative, elle est aussi nécessaire, et peut être dite médicinale en regard du corps de l’Église » (XXIII, 1, 6, p. 375).
[68]. Theologia moralis, III, 3, 3, 2, éd. Padoue, 1733, t. 1, p. 320.
[69]. Cursus theologicus in secundam secundae D. Thomae, disp. XVII, 1, éd. Lyon, 1663, pp. 250 ss.
[70]. Ad. Tanquerey, Synopsis theologiae moralis et pastoralis, t. 3, De virtute justitiae et de variis statutuum obligationibus, Desclée & Cie, Rome-Tournai-Paris, 1922, § 317, p. 136.
[71]. M. Labourdette o.p., La justice, ‘Grand cours’ de théologie morale, t. 12, Parole et Silence, Paris, 2018, pp. 155 ss.
[72]. La liste complète serait trop longue. L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège : Syllabus, Index, Saint-Office, Galilée, 2e éd., Beauchesne, 1913, pp. 512 ss., donne aussi les opinions concordantes, sur le droit de glaive, de Pirhing, Dicastillo, Ferraris, Billot, de Luca, Mazella, Tarquini, Duballet, Petra, etc.
[73]. V° Poena, P. Palazzini, Dictionarium morale et canonicum, Officium Libri Catholici, Rome, 1962, t. 3, p. 673–675, cité par M. Hendrickx, « Le magistère et la peine de mort. Réflexions sur le Catéchisme et “Evangelium vitæ” », Nouvelle Revue Théologique, t. 118/1, 1996, p. 12.
[74]. La contradiction avec le n. 7 de la Lettre est patente : le caractère médicinal qui ici vient « en plus », vient là un « avant tout »…
[75]. Cité par J.-Y. Pertin, op. cit., p. 309.
[76]. Ibid., p. 286.
[77]. Ibid., p. 291.
[78]. J. Pradel, Histoire des doctrines pénales, PUF, 1991, p. 87.
[79]. J. Imbert, La peine de mort, Armand Colin, 1989, p. 94–95.
[80]. J. Pradel, op. cit., p. 94.
[81]. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, op. cit., t. 17 (1957), p. 32.
[82]. Ibid., t. 15 (1955), pp. 479–480.
[83]. « Discours au Xe congrès international de droit pénal », La Documentation Catholique, n. 1550, 1969, p. 952.
[84]. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, t. 14 (1956), p. 524.
[85]. Id., p. 529.
[86]. Id., p. 530.
[87]. Il ajoute : « Suivant sa propre nature, c’est une réparation et un rétablissement — par la personne et en la personne du coupable, lequel accepte ladite peine — de l’ordre social coupablement violé. L’essence du retour au bien consiste, à proprement parler, non dans l’acceptation volontaire de la souffrance, mais dans l’éloignement de la faute. La souffrance elle-même peut réaliser cette fin, tandis que le repentir de la faute peut à son tour lui conférer une plus haute valeur morale, ainsi que faciliter et augmenter son efficacité morale. De la sorte, la souffrance peut s’élever jusqu’à un héroïsme moral, jusqu’à une patience et une expiation héroïques », p. 532.
[88]. Id., p. 527.
[89]. Id., p. 533.
[90]. H. Gilles, « Peine de mort… », loc. cit., p. 402.
[91]. Sur ces questions, cf. X. Martin, Beccaria, Voltaire et Napoléon ou l’étrange humanisme pénal des Lumières, DMM, Poitiers, 2018.
[92]. G. Guyon, Plaidoyer pour une peine capitale, DMM, Poitiers, 2014, p. 16.
[93]. J.-M. Carbasse, « Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », in S. Dauchy, J. Monballyu et A. Wijffels (dir.), Auctoritates. Xenia R.C. van Caenegem oblata, Peeters, Leuwen, 2000, pp. 179–180.







