Église en sortie, sortie de l’Église ? (n. 156)
[En raison d’une erreur d’impression, nous publions ici cet article du numéro 156 de la revue au format intégral]
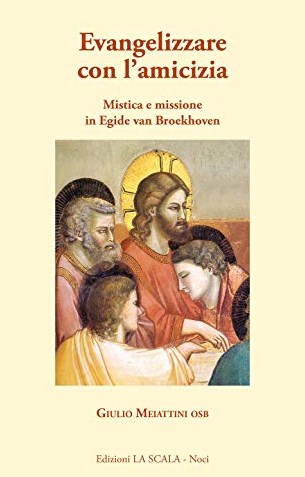
Dom Giulio Meiattini, osb, est moine de l’abbaye Madonna della Scala, située à Noci, près de Bari. Il est également professeur de théologie fondamentale à l’Athénée pontifical Saint-Anselme (Rome) ainsi qu’à la Faculté théologique des Pouilles (Molfetta). Il s’est notamment intéressé à l’apport spirituel d’un jésuite et prêtre-ouvrier belge néerlandophone, auquel il a consacré un petit ouvrage intitulé Evangelizzare con l’amicizia. Mistica e missione in Egied van Broeckhoven. Il était donc bien placé pour répondre aux questions que nous lui avons posées, concernant la dérive constatée toujours plus dans l’Église touchant sa mission fondamentale de faire connaître et aimer le Christ Jésus, qui tend aujourd’hui à se réduire à la recherche de « l’amitié » avec le monde hostile contemporain, en mettant sous le boisseau « l’évangélisation ».
Catholica – Dans une étude sur la relation entre modernité et sécularisation à l’époque victorienne, un universitaire angevin, Jean-Michel Yvard, reprend la thèse de Marcel Gauchet dans Le désenchantement du monde[1], celle d’une « religion de la sortie de la religion », concrètement, d’une récupération laïque du christianisme, spécialement dans les œuvres de charité.
Dom Giulio Meiattini – La thèse de Marcel Gauchet sur le christianisme comme « religion de la sortie de la religion » n’est pas entièrement nouvelle. Le philosophe marxiste Ernst Bloch, comme le suggère explicitement le titre d’un de ses livres – Atheismus im Christentum, 1968[2] –, avait déjà considéré la révélation biblique, et en particulier l’Incarnation, comme le début d’un mouvement visant à vider le Ciel au profit de la terre des hommes. L’identification johannique de Jésus au Père – « le Père et moi, nous sommes un » – représenterait, selon lui, un tournant dans la vision religieuse du monde : Dieu se faisant homme, l’homme devient Dieu. Ainsi, les attributs divins sont déplacés au sein de l’anthropologie, et au lieu d’une religion du Père, c’est une religion du Fils (comme Freud l’avait déjà suggéré) qui commence, centrée sur l’être humain, sur le « fils de l’homme » amené à sa plénitude. Tel serait, pour Bloch, le germe athée inhérent à la révélation chrétienne, ainsi qu’à une certaine mystique de l’essence (par exemple la mystique de Maître Eckhart) qui tend à faire coïncider le fond de l’âme avec l’essence divine, et vice versa. Il pouvait ainsi prétendre que la transformation de la théologie en anthropologie par Feuerbach n’était rien d’autre que la vérité de la religion de l’Incarnation. Le marxisme athée de Bloch se voulait ainsi, après tout, non pas comme un simple rejet de la foi chrétienne, mais comme une récupération herméneutique radicale de celle-ci afin de la dépasser de l’intérieur.
Nous trouvons une lecture très similaire chez un autre penseur français, plus récent, Jean-Luc Nancy. Dans son ouvrage Déconstruction du christianisme (Galilée, 2005), il soutient que le monde moderne – avec ses conséquences non seulement athées, mais aussi nihilistes – n’est pas une déviation du christianisme, mais le christianisme poussé dans ses ultimes conséquences. Pour ce philosophe (décédé en 2021), le christianisme est le mouvement même de sa dissolution en tant que religion, car son principe le plus profond est précisément le geste d’une pure et simple « déclosion » en tant que telle – l’Incarnation comme extraversion de Dieu –, une ouverture indéfinie et absolue. Le rapport du christianisme à lui-même serait donc celui d’une sortie indéfinie de soi. Nancy cite explicitement Gauchet, se déclarant en plein accord avec la thèse de base du désenchantement du monde.
Je voudrais rappeler ici une autre œuvre, cette fois d’un célèbre penseur italien. Il s’agit du livre Credere di credere (Garzanti, Milan, 1996), de Gianni Vattimo, le représentant le plus connu de la « pensée faible ». De la même manière que les auteurs déjà mentionnés, il part de la centralité de la caritas dans l’identité chrétienne et de sa manifestation à travers l’acte kénotique du don de soi divin, l’évidement de soi de Dieu par amour. Le Deus-caritas accomplit le suprême des renoncements, le renoncement à soi au nom de soi. Ce n’est pas l’homme qui proclame et détermine la « mort de Dieu », mais c’est Dieu lui-même qui, comme amour, meurt pour transformer l’homme de serviteur en ami, en égal de lui-même. Une fois encore, nous avons une herméneutique du christianisme comme une sortie de soi. La religion de l’amour kénotique se réalise paradoxalement dans son affaiblissement maximal, jusqu’à l’extinction du renoncement à toutes les vérités et identités dogmatiques et institutionnelles propres. Le christianisme s’évapore.
À partir de ces quelques rapprochements, on peut constater que la thèse du sociologue français est la variante d’une même idée de base que la pensée contemporaine a cultivée sous diverses formes. De tout cela, on peut saisir un fait, élémentaire mais fondamental : le lien profond entre la crise de la culture occidentale et la crise du christianisme.
Le monde protestant a sans doute été le premier à connaître cette évolution, mais le monde catholique ne connaît-il pas le même phénomène, et toujours plus ?
Cela semble se produire dans presque toutes les dénominations chrétiennes et également dans le monde catholique, l’orthodoxie semblant moins exposée à ce phénomène. D’autre part, la théologie elle-même avait énoncé ces idées depuis longtemps. La « théologie de la sécularisation », dans ses différents courants, a tenté de montrer la dérivation chrétienne de l’émancipation du monde moderne d’avec Dieu. Rappelez-vous les célèbres réflexions du dernier Bonhoeffer dans ses lettres de prison. Il esquissait l’idée d’un Dieu qui, dans sa mort sur la croix, accepte d’être évincé du monde humain, afin que l’homme puisse atteindre son « âge adulte », sa maturité. D’où son appel à un christianisme « non religieux », simple variante de la séparation entre la foi et la religion promue par la théologie dialectique. Un théologien catholique comme J. B. Metz a pensé, bien que de manière plus modérée, à faire remonter les présupposés de la sécularisation à la révélation biblique elle-même, qui serait à l’origine d’une conception du monde comme domaine confié à l’homme et à sa liberté, un « monde mondanisé » et « hominisé » par la disposition de Dieu, et non un monde sacré, fixé par des lois immuables. Bien que Metz introduise le correctif de la distinction entre « sécularité » (bonne) et le « sécularisme » (mauvais), ces idées montrent une certaine parenté avec celles des auteurs mentionnés précédemment.
Sans nier la validité de certaines des intuitions présentes dans ces points de vue, il faut se demander si une telle approche n’a pas l’air d’une justification ou d’une excuse tardive de la part de la théologie face au reproche que la culture moderne oppose au christianisme, à savoir d’être allé trop loin dans l’accentuation d’une prédication axée sur l’autre monde, négligeant la dimension terrestre de l’homme et sa libération des aliénations d’ici-bas. Il semble bien que les chrétiens, catholiques inclus, soient affligés d’un complexe d’infériorité vis-à-vis de la modernité, d’une sorte de sentiment de culpabilité. C’est comme si l’on voulait démontrer à la société d’aujourd’hui que c’est nous qui avons posé les prémisses de l’émancipation actuelle du monde d’avec le sacré, que c’est la foi chrétienne qui défend les valeurs de ce monde et qui s’emploie à libérer l’homme de l’ancien « Dieu sacral ».
On comprend ici pourquoi la présentation du christianisme centrée sur l’exercice des œuvres de charité finit par glisser vers une simple éthique sécularisée et compréhensible par tous. Actuellement, l’Église semble considérer que c’est la carte à jouer, le moyen le plus facile pour être accepté et admis à peu près par tout le monde. Mais c’est comme cela que nous assistons en fait à la réduction du christianisme à une éthique universelle, et non à l’évangélisation du monde.
Les médias, les discours officiels, tiennent dans leur très grande majorité des propos purement laïcisés. Mais il semble toujours plus que la voix publique de l’Église leur emboîte le pas, en mettant au premier rang les mêmes « grandes causes » qu’eux – la « sauvegarde de la Planète », « l’accueil des migrants », la paix entre les religions, la juste distribution des richesses, et ainsi de suite –, tandis que la proclamation au monde de la Bonne Nouvelle se fait plutôt discrète. Il en ressort un déséquilibre ressenti entre, d’un côté, une attitude « humaniste », de l’autre, un discours institutionnel sans force de conviction. N’est-ce pas le cas ?
Le fait que le monde catholique, comme le monde chrétien en général, s’aligne à ce point sur ce que vous appelez les « grandes causes » (solidarité, tolérance, écologie, égalitarisme, etc.) et en fasse sa bannière est l’exemple le plus clair du « christianisme sorti de lui-même », du christianisme sécularisé. À mon avis, cela dépend, au moins dans une certaine mesure, précisément du sentiment de culpabilité que j’ai mentionné précédemment et que les catholiques ont intériorisé. Après avoir reproché à l’Église du passé de nombreuses erreurs, les catholiques vivent aujourd’hui dans l’angoisse de se racheter, en faisant preuve de dévotion envers les lieux communs de la mentalité libérale politiquement correcte. Ils sont passés de « ne pas condamner », afin que le monde puisse se sentir accueilli et entendu, à « demander pardon ». Beau saltus mortalis !
Dans les milieux d’Église, une certaine religiosité du passé a souvent été critiquée pour avoir trop favorisé la culpabilité ou le sens du péché, pour avoir donné une image dure et sévère de Dieu. On ne peut nier qu’il y ait une part de vérité dans cette affirmation, mais l’aspect paradoxal est que le sentiment de culpabilité envers Dieu a été remplacé aujourd’hui par le sentiment (le plus souvent inconscient) de culpabilité envers la culture hégémonique. Il y a, pour ainsi dire, une crainte que le reproche fait aux catholiques d’être anachroniques et déracinés du monde, ou opposés aux droits et aux libertés, ne surgisse encore et toujours de la part de la société. D’où, je pense, l’effort pour se montrer complaisants envers les lieux communs de l’éthique libérale aujourd’hui en cours. Le résultat est un christianisme light, qui ne doit offenser personne, au nom d’un amour qui n’a plus de contours clairs.
Il peut arriver ainsi que le respect de l’autre, en lui-même sacro-saint, conduise à justifier tout comportement, même immoral, et que le souci de la santé de la planète fasse oublier l’écologie de l’âme et le respect de la nature humaine comme image indélébile de Dieu. En d’autres termes, on oublie le faire l’un sans omettre l’autre catholique et la juste hiérarchie que cela implique entre des aspects qui doivent être tenus ensemble.
On se demande comment une telle transmutation de la charité, qui est amour de Dieu et amour du prochain intimement liés, peut avoir lieu, en tout temps mais surtout aujourd’hui. En ce qui concerne les missions, on a parlé un temps d’un « apostolat de simple présence », maintenant on semble aller beaucoup plus loin, en constatant que souvent la charité, dans les discours et les actes de nombreux catholiques de tous rangs, se réduit à l’assistance corporelle, à l’accueil, au dialogue, etc. sans lien explicite avec l’expression de son motif ou de son explicitation. Parfois, certains catholiques se sentent même offensés s’ils sont soupçonnés d’évangéliser. Comment expliquer cela soixante ans après le concile Vatican II ?
Je pense que les raisons de cette « timidité » dans la façon dont les chrétiens et l’Église se présentent dans le contexte actuel sont multiples, et il est difficile de formuler un diagnostic adéquat. C’est une attitude de renoncement, d’insécurité. On pourrait appeler cela une forme de mimétisme, car en agissant de la sorte, on fait les mêmes choses et on prononce les mêmes mots comme presque tout le monde pourrait les faire et les dire aujourd’hui. Tout cela est cependant tout à fait cohérent avec ce qui a été dit précédemment sur la « religion de la sortie de la religion ».
Il y a quelques années, un théologien bien connu, lors d’une conférence donnée dans une université pontificale de Rome, avait déclaré à un moment donné : « Autrefois, nous pensions davantage à l’homme en fonction de Dieu, aujourd’hui nous pensons davantage à Dieu en fonction de l’homme. Que cela soit légitime ou non, qui le sait ? Je n’ose pas décider laquelle des deux perspectives est la meilleure. » Ce sont des mots qui font remonter à la surface une manière très répandue de sentir et de vivre la foi : la théologie et l’anthropologie peuvent inverser leur relation, en subordonnant Dieu au bien-être et à l’épanouissement de l’homme, et le théologien n’a rien à dire à ce sujet. Comment s’étonner alors que des croyants de bonne volonté et des structures ecclésiales généreuses se mettent au service de la pauvreté sociétale et humaine d’aujourd’hui et gardent le silence sur Dieu et Jésus-Christ ? Si l’important est de servir l’homme, la proclamation de l’Évangile devient inessentielle.
Le sujet devient toutefois plus délicat, et nécessiterait une étude beaucoup plus approfondie, lorsque nous pensons à quelques exemples éminents de sainteté contemporaine qui, au contact de contextes non chrétiens, ont adopté une manière d’annoncer l’Évangile faite davantage de témoignage que de proclamation directe et explicite. Charles de Foucauld, par exemple, ne s’est pas engagé directement dans une tentative de conversion des musulmans auxquels il avait affaire, même si, au fond de lui, il voulait apporter le Christ à tous. Les longues années de son séjour parmi les peuples islamiques n’ont débouché sur aucune conversion. Il est souvent cité comme un exemple de cet apostolat de la simple présence que vous venez de mentionner. Mère Teresa de Calcutta, elle aussi, en appelant ses sœurs les Missionnaires de la Charité, a indiqué un style particulier de mission, consistant à rendre présent le visage de la charité du Christ auprès des plus pauvres et des plus abandonnés[3], sans recourir à une annonce verbale explicite. Elle est allée jusqu’à dire : « J’ai toujours dit que nous aiderions un hindou à devenir un meilleur hindou, un musulman à devenir un meilleur musulman, un catholique à devenir un meilleur catholique. »
Personnellement, je n’aurais pas envie d’accepter complètement ces derniers mots. Cependant, deux choses sont à noter. Tout d’abord, ces deux exemples modernes de sainteté ont toujours manifesté la centralité de Jésus-Christ dans leur vie et leur mission, sans aucune incertitude. Ils étaient religieux, leur vie était constamment orientée vers Dieu, la foi évangélique émanait de chacun de leurs gestes et de leur souffle, même sans avoir besoin de mots. Il était clair que leur vie ne pouvait être expliquée que par Jésus-Christ. Deuxièmement, je pense qu’ils ont mis en évidence un style possible, mais pas le seul, de témoignage de l’Évangile. Au sein de l’Église, on peut et on doit proclamer l’Évangile de diverses manières. Et la voie de l’annonce explicite ne peut jamais faire défaut, dans toute la vie de l’Église, si nous ne voulons pas contrevenir à l’exemple et au commandement de Jésus lui-même : en paroles et en actes, il a annoncé le Royaume de Dieu et, en paroles et en actes, il a ordonné aux disciples de l’annoncer à leur tour.
L’« américanisme » jadis dénoncé par le pape Léon XIII, voulant faire primer l’action organisée sur la contemplation, a marqué certains moments du xxe siècle, en particulier comme tentation pour l’Action catholique. Il semble depuis quelque temps regagner du terrain sous une forme somme toute assez proche, avec la récupération de méthodes d’apostolat dont une partie du clergé attend un renouveau, méthodes empruntées notamment aux évangéliques américains. N’y a‑t-il pas quelque lien entre cette option, disons techniciste, de l’apostolat, et la « religion de la sortie de la religion » ?
Je ne sais pas si l’américanisme de la fin du XIXe siècle présente une analogie possible avec les phénomènes plus actuels que vous avez mentionnés. Mon impression, bien que je sois un moine vivant loin de l’action pastorale proprement dite, est qu’à ce stade de l’histoire de l’Église nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. Aujourd’hui, le fond du problème est constitué par une formule qui porte l’imprimatur. Je parle du « tournant pastoral ». Cette formule nous accompagne depuis plusieurs décennies et est devenue la clé de voûte d’une réinterprétation générale de la vie et de la mission de l’Église. Tout est passé au crible de la perspective pastorale, comprise unilatéralement comme une « adaptation » aux conditions de l’homme contemporain.
Il me semble cependant que la pastorale, dans ce sens particulier, ne peut avoir ce rôle de pierre angulaire dans l’architecture générale de la vie ecclésiale. Je me demande, par exemple, ce qu’est devenu le rappel constant, par Sacrosanctum concilium, de l’unité ordonnée entre la glorification de Dieu et le salut de l’homme, quand je constate que l’aspect doxologique de la transcendance de Dieu a pratiquement disparu de la sensibilité spirituelle de la majorité des prêtres et des fidèles. Je me demande aussi ce qu’est devenue la primauté de l’écoute de la Parole de Dieu dans le sillage de la Tradition (Dei Verbum), quand je vois qu’elle est remplacée dans la pratique par l’écoute des « signes des temps », c’est-à-dire, en fait, des pratiques sociales, qui deviennent dans certains cas le premier lieu théologique, justifiant des écarts criants (comme dans le cas du synode allemand) par rapport à l’enseignement traditionnel de l’Église.
Cette façon de pratiquer et de comprendre le « tournant pastoral », qui culmine dans le slogan de « l’Église en sortie », me semble rejoindre à bien des égards la thèse de Gauchet sur la « religion de la sortie de la religion ». L’Église en sortie, en fait, se révèle toujours plus comme une sortie de l’Église. Ou, si l’on veut paraphraser Gauchet, comme « l’Église de la sortie de l’Église ».
Propos recueillis par Bernard Dumont
[1] Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Gallimard, 2005. Cf. http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/domaine-britannique/le-christianisme-commereligion-de-la-sortie-de-la-religion-modernite-et-secularisation-a-l-epoque-victorienne
[2] Traduction française : L’athéisme dans le christianisme. La religion de l’Exode et du Royaume, Gallimard, 1978.
[3] Dans la version imprimée du présent texte, à la suite d’une erreur technique, le passage situé à la jointure entre les pages 57 et 58, allant de « n’ont débouché » jusqu’à « plus pauvres », a été omis. Nous prions les lecteurs de bien vouloir accepter nos excuses pour cette erreur dont la cause reste non identifiée.







