Autour des « formes liturgiques ». Quelques réflexions du cardinal Newman
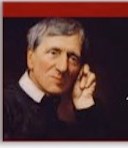
La vie de l’Église, au cours des dernières décennies, a été traversée par un débat très intense sur le renouvellement des « formes » : dans le langage théologique, dans la liturgie, dans la proclamation de l’Évangile, dans la manière de s’adresser au monde contemporain. C’était d’ailleurs l’objectif principal que le pape Jean XXIII avait assigné au Concile Vatican II, comme le pontife l’avait exprimé dans le discours d’ouverture de l’assemblée conciliaire : « Ce qui intéresse le plus le Concile, c’est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et enseigné sous une forme plus efficace. Car une chose est le dépôt de la foi, c’est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et une autre est la manière dont elles sont proclamées, mais toujours dans le même sens et la même signification. […] Il faudra donc adopter la forme d’exposition qui correspond le mieux au Magistère, dont la nature est principalement pastorale[1]. »
C’est sur la base de cette distinction légitime entre le dépôt ou le contenu de la foi, d’une part, et ses formes historiques et changeantes, d’autre part – également corroborée par le grand développement des études historiques entre le XIXe et le XXe siècle –, que l’on a donc tenté de donner un nouvel élan à la vie et à la mission de l’Église. Au fur et à mesure que l’on avançait dans ce travail, qui est loin d’être simple, on se rendit compte qu’il n’était pas toujours facile de distinguer entre ce qui relève de la simple forme ou d’une option éphémère et ce qui, au contraire, touche dans une certaine mesure au cœur même du catholicisme, même si cela n’est pas directement lié à la révélation divine elle-même.
C’est précisément autour de cette question difficile que de fortes tensions sont apparues au sein de l’Église. Ce débat, même s’il a connu des phases alternées, ne s’est jamais complètement apaisé, jusqu’à aujourd’hui. Comme on le sait, il concerne surtout le domaine de la liturgie et toutes les formes de prière et de ritualité qui expriment la dévotion ou la foi des fidèles.
La vie de l’Église n’est pas entièrement nouvelle face à de tels problèmes, même s’ils se présentent aujourd’hui avec une intensité particulière. En témoigne le texte d’un sermon du cardinal John Henry Newman (1801–1890), intitulé Ceremonies of the Church[2] et prononcé à l’occasion de la fête liturgique de la Circoncision de Jésus. Il s’agit d’un des sermons de Newman avant sa conversion au catholicisme, alors qu’il appartenait encore à l’Église anglicane. Dans ces écrits « anglicans » du futur cardinal, proclamé saint il y a quelques années par le pape François (2019), nous sommes déjà confrontés à une pensée qui ne révèle aucun conflit avec la foi catholique, à l’exception peut-être de quelques nuances qui mériteraient d’être précisées.
Dans ce texte, que nous voulons examiner et relire attentivement, nous trouvons des indications précieuses et très pertinentes concernant les « formes religieuses » en général, surtout liturgiques, et les critères à adopter pour leur conservation ou leur changement. Il s’agissait d’un sujet très sensible dans les milieux anglicans de la première moitié du XIXe siècle, déjà très exposés à l’époque aux tendances sécularisantes et libéralisantes, contre lesquelles le jeune Newman cherchait à mettre en garde l’Église d’Angleterre.
Le point de départ choisi par Newman pour aborder le thème des « cérémonies religieuses », et donc de la permanence ou de la nature éphémère des formes rituelles de la religion chrétienne, est l’Écriture Sainte, en particulier le témoignage du Nouveau Testament concernant les prescriptions de la Loi juive par rapport à la nouveauté de Jésus-Christ et à la vie de l’Église apostolique. S’inspirant de la fête de la circoncision de Jésus, Newman montre comment le Sauveur, dès sa naissance puis tout au long de son ministère public, a voulu se soumettre aux institutions et aux rites associés au Temple et sanctionnés par la loi mosaïque. Après avoir donné plusieurs exemples de l’obéissance de Jésus aux coutumes juives, même pendant son ministère public, Newman conclut par les précisions suivantes :
« Telle fut l’observance consciencieuse par notre Sauveur du système religieux sous lequel il était né, et ce non seulement dans la mesure où il était directement divin, mais aussi là où il avait été décrété par des hommes non inspirés bien que pieux, c’est-à-dire là où il était fondé sur (ce que nous appellerions) la seule autorité ecclésiastique » (70).
En d’autres termes, il ne faut pas seulement saisir les moments de discontinuité de Jésus par rapport à la Loi (par exemple sa contestation de l’observance trop rigide et formelle du sabbat, qu’en soi il n’a jamais déclarée obsolète), mais aussi les nombreux cas où il a respecté et appliqué les coutumes, même simplement humaines, de la religion juive. Jésus a appelé à plusieurs reprises non seulement à l’observance de la Loi, mais aussi à l’obéissance aux scribes et aux pharisiens (cf. Mt 23, 2–3), qu’il reconnaissait comme les autorités légitimes du judaïsme de son temps.
Newman note que même après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, qui ont sanctionné l’accomplissement et le dépassement de la loi mosaïque, les apôtres et la communauté chrétienne primitive ont suivi l’exemple du Seigneur :
« Ils n’ont pas abandonné les rites juifs et n’ont obligé personne d’autre qui en avait l’habitude à le faire. La coutume était une raison parfaitement suffisante pour les conserver ; chaque chrétien devait rester dans l’état auquel il était appelé ; et dans le cas des juifs, la pratique de ces rites n’interférait pas nécessairement avec une foi véritable et entière dans la Rédemption que le Christ avait offerte pour le péché » (71).
Saint Paul lui-même, qui s’est vigoureusement opposé à ceux qui voulaient obliger les chrétiens venus du monde païen à observer la circoncision et les prescriptions de l’Ancienne Loi, « n’a jamais ordonné aux juifs d’y renoncer ; au contraire, il a voulu qu’ils les conservent, laissant à une nouvelle génération, qui n’était pas née sous leur empire, le soin de les omettre, afin que leur usage disparaisse graduellement » (71). Ceci est attesté, par exemple, par le fait qu’il a fait circoncire Timothée (cf. Ac 16 1,3), par respect pour la sensibilité des chrétiens issus du judaïsme, et qu’il a suivi la coutume de l’Ancien Testament de laisser pousser ses cheveux (le naziréat) comme une forme de vœu fait à Dieu (cf. Ac 18,18). La conclusion que Newman tire de ce bref examen des données bibliques est la suivante :
« De cette obéissance à la Loi juive, prescrite et mise en évidence par notre bienheureux Seigneur et ses Apôtres, nous apprenons la grande importance de préserver les formes religieuses auxquelles nous sommes habitués, même si elles sont en elles-mêmes indifférentes ou d’origine non divine » (71–72).
Sur ce dernier point, Newman s’attarde longuement. En effet, dans la plupart des cas, les formes cérémonielles concernent des pratiques et des usages qui ne sont pas proprement d’institution divine, c’est-à-dire contenus dans la Révélation et remontant directement à Dieu. C’est pourquoi des objections sont souvent soulevées à l’encontre de nombreuses formes ecclésiastiques, puisque la Bible ne dit rien à leur sujet : l’agenouillement devant le sacrement de la Cène du Seigneur, la célébration dans des lieux consacrés, l’utilisation de formulaires de prières fixes, comme dans la liturgie, la sépulture chrétienne, etc. Si l’Écriture ne contient pas d’indications sur ces choses, qui paraissent donc secondaires ou indifférentes, pourquoi s’y attacher autant ?
À cet égard, Newman observe que, sur bien d’autres points, on ne trouve aucune indication dans l’Écriture (par exemple, l’interdiction du suicide, du duel, du jeu de hasard) et pourtant, note-t-il, personne ne doute qu’il s’agisse là de péchés graves, contraires à la vie chrétienne. Par conséquent, sur de nombreux aspects de la vie chrétienne et ecclésiale, la conscience et l’intelligence, inspirées par l’Esprit et éclairées par l’Écriture, peuvent parvenir à une compréhension de certaines vérités qui, bien que n’étant pas matériellement présentes dans la Bible, ne sont pas moins importantes que les choses explicitement révélées par Dieu. Si la révélation divine concerne essentiellement les questions de foi, affirme Newman, « les questions de forme nous sont révélées par la tradition et leur long usage, qui nous obligent à les observer, même si elles ne nous sont pas imposées par l’Écriture » (73).
Plus précisément, « l’Écriture nous dit ce que nous devons croire et ce à quoi nous devons aspirer et affirmer, mais elle ne nous dit pas comment le faire, et et comme nous ne pouvons pas le faire du tout à moins de le faire de telle ou telle manière, nous devons en fait ajouter quelque chose à ce que l’Écriture nous dit » (73). Ces formes particulières et concrètes sont nécessaires et l’Église doit intervenir pour les établir et les réglementer. « La religion doit se réaliser dans des actes particuliers pour continuer à être vivante. [Il n’y a pas de religion abstraite. Lorsque quelqu’un essaie d’adorer Dieu de manière (dite) plus spirituelle, il finit, en fait, par ne pas adorer du tout » (74).
Sous une forme quelque peu simplifiée et schématique, mais substantiellement correcte, Newman conclut ainsi : « Pour notre culte, l’Écriture donne l’esprit et l’Église le corps » (74). Cela signifie que les deux aspects, bien que d’origine différente, sont coessentiels, comme l’âme et le corps le sont pour l’homme : « par exemple, l’Écriture nous dit de nous réunir pour la prière, […] mais comme elle ne nous en dit pas les temps et les lieux, l’Église doit compléter ce que l’Écriture a enjoint de manière générale » (73). Il en va de même pour la Cène, le mariage, la sépulture des morts, etc. Sur les sacrements, nous trouvons, certes, des indications dans les paroles du Seigneur Jésus et dans le Nouveau Testament, mais pas la détermination de leurs formes. Cela ne signifie pas pour autant que les formes et les rituels peuvent être modifiés à volonté ou qu’ils n’ont que peu de dignité :
« Même si les formes ne viennent pas directement de Dieu, leur long usage les a rendues divines à nos yeux, car l’esprit de la religion les a tellement imprégnées et vivifiées que les détruire revient, pour la multitude des hommes, à perturber et à déloger le principe religieux lui-même. Dans la plupart des esprits, l’usage les a tellement identifiées à la notion de religion que l’une ne peut être supprimée sans l’autre. Leur foi ne tolère pas d’être transplantée » (75).
Les formes dont l’Église s’est dotée au fil du temps ne sont pas comme des vêtements que l’on peut changer ou jeter trop facilement. Si les vérités de la foi et les formes liturgiques sont respectivement comme l’âme et le corps d’un organisme vivant, pour Newman il faut faire preuve d’une grande prudence quand on intervient sur ces formes, même si elles sont en elles-mêmes faibles ou immuables, parce qu’elles sont devenues, à force d’usage, comme l’habitat vital dans lequel la foi de la communauté a grandi. De même que le Seigneur Jésus et les Apôtres ont considéré avec respect les formes religieuses du judaïsme même si elles étaient destinées à disparaître, sans obliger personne à les répudier ou à les abandonner, de même, dans l’Église, la même discrétion doit être observée à l’égard des rites et des pratiques cultuelles qui, par une longue tradition, se sont imprégnés de l’Évangile et l’ont transmis à tant de générations.
« Les rites juifs étaient destinés à disparaître, et pourtant personne n’a reçu l’ordre énergique de se séparer de ce à quoi il était habitué depuis longtemps, de peur qu’ils ne perdent aussi le sens de la religion. À plus forte raison en sera-t-il ainsi pour des formes comme le sont les nôtres, qui, loin d’être abrogées par les Apôtres, ont été introduites par eux ou par leurs successeurs immédiats » (76).
Aujourd’hui, ces réflexions de Newman pourraient être considérées comme une manière d’attention à la dimension anthropologique qui intervient toujours dans la constitution et la formation des formes rituelles et qui, bien qu’elles ne dérivent pas directement d’une institution divine, ne doivent pas pour autant être sous-estimées ou considérées comme simplement interchangeables avec d’autres.
Au terme de ses considérations, brièvement résumées ici, Newman invite à la prudence face à des changements trop faciles ou trop brusques des formes consacrées par l’usage ecclésiastique :
« Rappelez-vous donc que les choses indifférentes en elles-mêmes deviennent importantes pour nous lorsque nous y sommes accoutumés. Les services et les cérémonies de l’Église sont la forme extérieure sous laquelle la religion a été représentée dans le monde pendant des siècles, et nous l’ont toujours fait connaître. […] Les rites que l’Église a établis, à juste titre – car l’autorité de l’Église vient du Christ – ayant été utilisés dans le temps long ne peuvent être désaffectés sans dommage pour nos âmes. […] Il en est de même pour toutes les autres formes, même celles qui sont moins contraignantes en elles-mêmes ; il arrive continuellement qu’un perfectionnement de caractère spéculatif soit une folie dans la pratique, et que les savants soient pris au piège de leur propre habileté » (77–78).
Cette dernière observation, non sans une certaine sévérité, renferme une profonde sagesse et doit être bien comprise. Ce que notre auteur veut dire, c’est que parfois un changement de forme « en vue d’un mieux », même dans le culte, suggéré par des raisons « théoriquement « valables » (« de caractère spéculatif »), puisse s’avérer, en termes pratiques – disons en termes de « pastorale » –, contre-productif s’il devient une cause de désorientation. Le risque est de compromettre l’intégralité de l’expérience de foi, si l’on ne fait pas preuve de prudence et de discrétion dans la manière de traiter et éventuellement de corriger les formes au nom d’un contenu abstrait. La théologie des experts, en d’autres termes, ne peut pas fonctionner si elle se détourne de l’attention à la situation réelle et à la sensibilité concrète des fidèles. Celle-ci doit être formée selon des principes théologiquement corrects, mais progressivement et en tenant compte du fait que le mieux peut parfois être l’ennemi du bien.
« Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, qui est très important. Spécialement par les temps qui courent, nous devons nous méfier de ceux qui espèrent, en nous incitant à renoncer à nos formes, nous faire renoncer finalement à notre espérance chrétienne. C’est pourquoi l’Église elle-même est attaquée, parce qu’elle est la forme vivante, le corps visible de la religion ; et les hommes astucieux savent que lorsqu’elle disparaîtra, la religion disparaîtra aussi. C’est pourquoi ils s’en prennent à tant d’usages qu’ils considèrent comme superstitieux, ou qu’ils proposent des modifications et des changements, mesure spécialement calculée pour ébranler la foi de la multitude » (78).
Les réflexions de saint John Henry Newman doivent être considérées avec attention. Elles contiennent quelques critères théologiques qui peuvent inspirer la pratique du discernement. Elles pourraient aussi aider, rétrospectivement, à relire la manière dont la dernière réforme liturgique a été menée. La question qui se pose à la lumière de ses propos est la suivante : aurait-il été possible de procéder à des changements plus graduels ? Aurait-il été pastoralement plus approprié de laisser ceux qui se sentaient à l’aise dans le vetus ordo de continuer à le pratiquer, sans imposer son abandon brutal ?
Ne pourrait-on pas, en outre, suggérer la prudence, au moins maintenant, dans la manière d’intervenir à l’égard de tout ce qui fait encore l’objet de débats et de malaises dans la liturgie ? Ce que le saint cardinal et grand théologien anglais suggère, c’est la modération dans le traitement des formes vénérables que la tradition nous a transmises, et de procéder avec modération à leur éventuelle correction. Sommes-nous sûrs qu’il ne vaut pas mieux laisser une marge de liberté et de respect envers ceux qui sont encore attachés à des formes plus anciennes, comme Jésus et les Apôtres l’ont fait à l’égard des anciens rites qui étaient sur le point de disparaître ?
Lorsque Benoît XVI a publié le document Summorum Pontificum, ma première réaction a été négative. Aujourd’hui, à distance, j’en vois la plausibilité. Ce que le pape Ratzinger a écrit dans sa lettre du 7 juillet 2007, expliquant plus en détail les raisons du motu proprio, me semble tout à fait conforme aux réflexions réfléchies de Newman : « Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste sacré et grand pour nous aussi, et ne peut pas être soudainement complètement interdit ou même jugé nuisible. Cela nous fait du bien de préserver les richesses qui ont grandi dans la foi et la prière de l’Église, et de leur donner la place qui leur revient ». S’il s’agit de branches mortes, elles tomberont d’elles-mêmes. Si, en revanche, ce sont des pousses vivantes, pourquoi s’obstiner à les déraciner ?
[1]. Jean XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, n. 6.
[2]. Texte disponible sur https://www.newmanreader.org/works/parochial/volume2/sermon7.html Les passages cités dans le présent texte renvoient à la pagination indiquée dans cette édition.







