Du pouvoir des entreprises à la re-politisation de la cité
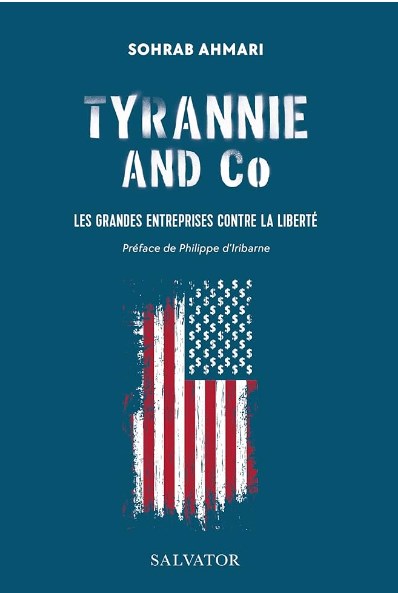 On a dit bien des choses sur les trois pouvoirs de Montesquieu. La plus importante est peut-être qu’ils sont aujourd’hui à reléguer au second rang. Ce sont les entreprises qui façonnent et structurent nos sociétés. Dans ce contexte, Sohrab Ahmari signe un essai bienvenu, Tyrannie and Co. Les grandes entreprises contre la liberté[1]. Américain né en Iran, l’auteur « appartient à un milieu de penseurs catholiques, critiques des orientations libérales du mouvement conservateur, qui appellent à une application actualisée des principes de la doctrine sociale catholique » (4e de couverture). Son ouvrage vise un double objectif (p. 29) : montrer « comment nous avons perdu notre capacité à discerner la tyrannie privée » et proposer une « grande visite de notre système, en marquant des arrêts dans les espaces de travail, devant les contrats de travail, au tribunal, dans les fonds d’investissement, dans le système des retraites, les salles de rédaction et les processus de faillite ». Il met en lumière « l’incapacité à soumettre le marché à des contrôles politiques et à des concessions démocratiques » et que cela « a mis en péril la vie de millions d’Américains ordinaires tout en nuisant à notre économie et au bien commun ».
On a dit bien des choses sur les trois pouvoirs de Montesquieu. La plus importante est peut-être qu’ils sont aujourd’hui à reléguer au second rang. Ce sont les entreprises qui façonnent et structurent nos sociétés. Dans ce contexte, Sohrab Ahmari signe un essai bienvenu, Tyrannie and Co. Les grandes entreprises contre la liberté[1]. Américain né en Iran, l’auteur « appartient à un milieu de penseurs catholiques, critiques des orientations libérales du mouvement conservateur, qui appellent à une application actualisée des principes de la doctrine sociale catholique » (4e de couverture). Son ouvrage vise un double objectif (p. 29) : montrer « comment nous avons perdu notre capacité à discerner la tyrannie privée » et proposer une « grande visite de notre système, en marquant des arrêts dans les espaces de travail, devant les contrats de travail, au tribunal, dans les fonds d’investissement, dans le système des retraites, les salles de rédaction et les processus de faillite ». Il met en lumière « l’incapacité à soumettre le marché à des contrôles politiques et à des concessions démocratiques » et que cela « a mis en péril la vie de millions d’Américains ordinaires tout en nuisant à notre économie et au bien commun ».
En journaliste de métier, Sohrab Ahmari collectionne des faits que l’on situerait en Russie, en Chine ou en Iran, alors qu’ils se sont déroulés aux États-Unis (pp. 15–30). En analyste, il met en lumière ce à quoi contraignent les contrats de travail, et combien l’employé est démuni devant son employeur. Certaines bizarreries du droit des faillites américain sont également passées en revue. Elles ont permis à Johnson & Johnson de dégager sa responsabilité dans une affaire de talc cancérigène (pp. 191–194), et à Purdue Pharma de s’enrichir avec la vente d’opioïdes qui ont fait plus de cent mille victimes en 2021 (pp. 201 ss). Nous laissons le lecteur plonger dans le catalogue des affaires exposées par l’auteur. Si nous n’avons pas eu les moyens de les vérifier, elles semblent décrites avec sérieux et honnêteté. Elles sont nombreuses, diverses et accablantes. Isolément, chacune pourrait passer pour une anecdote montée en épingle. Par touches successives, leur accumulation brosse une vision inattendue de ces États-Unis que nous voyons finalement fort mal depuis l’Europe, et surtout le tableau d’un dramatique problème structurel.
Tel est le cœur du propos, à savoir un implacable procès de ce que l’auteur appelle le « néolibéralisme », c’est-à-dire la foi en un marché non régulé, en la libre concurrence et en une main invisible. Les conclusions s’imposent d’autant plus aisément qu’elles semblent découler de la nature des choses, et que l’on peut constater des situations similaires sur le vieux continent. « Les systèmes prônés par les défenseurs du laisser-faire sont en réalité imprégnés de restrictions coercitives, le plus important étant le pouvoir de ceux qui contrôlent la majeure partie des biens d’une société pour obliger la majorité à leur obéir » (p. 42, en s’appuyant sur une analyse de Robert L. Hale, 1923). « La dynamique de pouvoir générée par la structure économique elle-même se révèle presque impossible à surmonter pour les employés » (p. 240). C’est le renard libre dans le poulailler libre.
En passant, Ahmari fournit de nombreux éléments pour comprendre comment les États-Unis en sont arrivés là. Il mentionne ainsi la notion de « travail libre ». Mise en place par Lincoln, cette référence demeurerait structurante. Il faut lui associer la figure du pionnier-paysan, qui commence comme employé, puis qui accumule de quoi devenir propriétaire jusqu’à embaucher de nouveaux aspirants au même parcours (pp. 59–61). Loin de se présenter comme enraciné dans sa terre depuis des générations, le paysan d’Outre-Atlantique prend lui-même la figure du rêve américain, de l’enrichissement individuel, de la libre entreprise, de la croissance collective. C’est un « personnage composite entre capital et travail – ni complètement employeur ni complètement employé, mais qui emprunte aux caractéristiques des deux » (pp. 60–61). L’énorme différence est évidement que les choses ne se jouent plus aujourd’hui à taille humaine, entre un petit propriétaire et ses quelques employés appelés à devenir propriétaires à leur tour. Elles se jouent entre des individus plus isolés que jamais et des entreprises de plusieurs centaines de milliers de salariés interchangeables. Ahmari développe également une excellente vision sur les débats d’idées dans l’immédiat après-guerre (sous-chapitre, « La dépolitisation coercitive », pp. 265–281). Les néo-libéraux comme Hayek, Friedman, von Mises ou Popper ont pu, non sans abus mais non sans quelque raison, se présenter comme l’alternative au totalitarisme nazi puis marxiste.
L’auteur fournit aussi des perspectives et mentionne à raison « un mal néolibéral plus profond : la “dépolitisation” » (p. 271). Il renvoie même à un peu de science-fiction, avec Super-Cannes, roman britannique de James G. Ballard, qui nous vaut aussi une réflexion sur ce rêve français qu’est Sophia-Antipolis, Antipolis étant l’anti-cité par excellence (pp. 255 ss).
Au-delà, Ahmari a le courage et le mérite de proposer « une autre voie », qui occupe toute sa deuxième partie (chapitres 9 à 12). On peut l’avouer : elle est malheureusement décevante. L’auteur en appelle à Roosevelt, aux Trente Glorieuses (p. 286), et à la social-démocratie européenne et nommément suédoise. Le but serait de pouvoir « utiliser les ressources de l’État pour éliminer les pathologies sociales liées aux formes de production capitalistes et au fonctionnement illimité de l’économie de marché : pour construire non pas des utopies économiques, mais de bonnes sociétés » (p. 238, citant Tony Judt). Aux États-Unis, la version plus faible serait un « capitalisme socialement géré » ou encore un « capitalisme d’échange politique ». Cela nous semble bien naïf, tant le néolibéralisme américain décrit par l’auteur nous semble cousin de la social-démocratie européenne, avec sans doute une pulsation un peu différente et un léger déphasage. D’ailleurs, les grandes entreprises s’accommodent très bien des actuels États et de leurs administrations tentaculaires et flasques, dont elles savent tirer profit et à qui elles vendent même des prestations de conseil. Ahmari en appelle également aux contre-pouvoirs et à la syndicalisation (notamment chapitre 10, « Il y avait une alternative »), en étant conscient qu’il va déplaire aux néolibéraux comme aux « socialistes les plus à gauche » (p. 290). Il ne prend toutefois pas en compte que les syndicats eux-mêmes, depuis au moins 1945, se trouvent dans le sillage d’évolutions qu’ils subissent, et n’ont pas su proposer de vision alternative.
Sans prétendre proposer une « autre voie » immédiatement prête à servir de programme politique, nous pensons toutefois pouvoir prolonger un peu Tyrannie and Co, et pouvoir en tirer des éléments qui pourraient y contribuer.
Redisons d’abord l’utilité de l’ouvrage, qui contribue à marquer la fin d’une ère, celle où, par opposition au communisme ou à mai 68, des auteurs pourtant clairvoyants se sont faits trop rapidement les hérauts du libéralisme et du consumérisme. Nous pensons par exemple à Raymond Ruyer et à son Éloge de la société de consommation (1969) ou au P. Bruckberger et à son Le capitalisme, mais c’est la vie ! (1984). Le face-à-face du marxisme et du libéralisme n’a que trop longtemps masqué leur profond accord sur l’essentiel, à savoir un progressisme matérialiste. Le temps de leur opposition binaire semble enfin révolu. L’on ne peut que s’en réjouir, même s’il faut surtout se mettre à fonder un renouveau.
Ahmari insiste beaucoup sur la dimension juridico-financière des coercitions en face desquelles il dresse l’étendard de la liberté : droit du travail, droit des faillites, systèmes de facturation, possession du capital, etc. Il a évidemment raison, mais il faudrait souligner le rôle de la coercition idéologique. En l’occurrence, les travaux d’Althusser sur l’appareil idéologique d’État constitueraient une base de qualité, même si leur auteur demeure impardonnable de ne pas avoir appliqué sa perspicacité au système communiste dont il s’était fait le chantre. Il faudrait évidemment élargir : on ne sait plus s’il faut parler d’appareil idéologique d’État ayant pénétré dans l’entreprise, ou d’appareil idéologique d’entreprises relayé par l’État.
Terminons enfin sur le politique et la nécessaire re-politisation de nos civilisations. On a trop dit que la fin de la société politique, c’était la paix extérieure, la concorde intérieure et la prospérité – et Ahmari ne peut pas être totalement exempté de ce reproche. Mais la fin de la société politique est plus haute. Elle est d’offrir aux citoyens et aux familles le cadre stable et la totalité des moyens nécessaires pour une vie droite et ouverte vers ce que chacun peut atteindre de plus haut. Cela exige de reconnaître à tout le moins la nécessité de corps intermédiaires, l’existence d’une morale naturelle et la possibilité d’une transcendance. Dès lors que la prospérité – l’extraordinaire prospérité matérielle dont nous jouissons – masque ces réalités plus hautes, dès lors qu’elle les ridiculise pour les nier plus efficacement et pour mieux en détourner, elle ne mérite plus d’être associée au bien commun. Et l’on pourrait en dire autant même de la paix extérieure et de la concorde intérieure. Peut-on imaginer aujourd’hui un parti inscrivant en tête de son programme que le bien commun qu’il poursuivra, ce sera celui esquissé plus haut ? Sans doute. Mais on doit surtout imaginer la réaction unanime de l’appareil idéologique en place, qui criera au retour de la théocratie et à la dictature de la vertu. C’est bien là que se trouve le problème de toute « autre voie ».
———
[1]. Sohrab Ahmari, Tyrannie and Co, Les grandes entreprises contre la liberté, préface de Philippe d’Iribarne, traduit de l’anglais par Delphine Delamare et Clément Hayot, Salvator, 2024, 320 p., 21 €.







