[note : ce texte est paru dans le numéro 126 de catholica (hiver 2015]
Le pape Bergoglio affectionne les entretiens peu protocolaires accordés à la presse. Dernièrement (7 décembre 2014) il s’est confié à la journaliste argentine Elisabetta Piqué, le texte étant publié le lendemain dans le quotidien La Nación, de Buenos Aires. Parmi les sujets abordés, celui des « divorcés remariés ». « Ils ne sont pas excommuniés, c’est vrai. Mais ils ne peuvent pas être parrains de baptême, ils ne peuvent pas faire la lecture à la messe, ils ne peuvent pas donner la communion, ils ne peuvent pas faire le catéchisme, ils ne peuvent… il y a comme ça sept choses, j’ai la liste ici, mais assez ! Si je compte tout, ils sembleraient bien excommuniés de facto ! Alors il faut ouvrir un peu plus les portes. Pourquoi ne peuvent-ils pas être parrains ? « Non, mais rends-toi compte, quel témoignage ils vont donner au filleul !» Prenons le cas d’un homme ou d’une femme qui lui disent : « Ecoute, mon chéri, je me suis trompé, j’ai dérapé sur ce point, mais je crois que le Seigneur m’aime, je veux servir Dieu, le péché ne m’a pas vaincu, je vais de l’avant ». Est-ce qu’il y a un témoignage plus chrétien que celui-là ? Ou si arrive un de ces escrocs de politiciens que nous avons, des corrompus, pour être parrain, et qui est bien marié à l’église, vous l’acceptez ? Et quel témoignage donnera-t-il au petit filleul ? Un témoignage de corruption ? Alors, nous devons changer un peu les choses dans la manière de juger. »
La compréhension la plus large transpire du propos, se fondant sur une intuition privilégiant une forme de bon sens placé au-dessus de la loi, fût-elle celle du Christ. Ainsi se définit l’image compassionnelle que les grands médias se plaisent à saluer et répandre, non sans fondement objectif.
Pour des raisons obscures, au moins à première vue, la compassion s’applique toutefois inégalement. Le cas des Frères franciscains de l’Immaculée (FFI) en donne certainement la plus choquante illustration. Malgré le silence qui leur est imposé et qu’ils acceptent de respecter, et peut-être même à cause de cela, leur situation est désormais connue de par le monde et crée une gêne.
La nouvelle la plus récente à leur sujet a été annoncée par le journaliste Marco Tosatti, dans le quotidien turinois La Stampa du 20 novembre 2014 ((. Reproduit sur http://www.lastampa.it/2014/11/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/ffi-la-cei-scriveai-vescovi-0epwWCOl8ttfO0K9XjaktK/pagina.html. )) . Elle a agité le milieu ecclésiastique italien, surtout romain, avant d’être répercutée sur divers sites. Le père Volpi, ofm cap., commissaire apostolique en charge de la rectification des FFI, présent à l’assemblée plénière de la Conférence épiscopale italienne (CEI) mi-novembre, a averti les évêques qui seraient « tentés » d’accueillir dans leur diocèse des prêtres de la congrégation désireux de quitter leur ordre. Le nouveau secrétaire général de la CEI, Mgr Galantino, a appuyé cette démarche d’une lettre à ses confrères leur « rappelant » l’obligation canonique de devoir contacter le commissaire préalablement à l’examen de la demande d’incardination venant de prêtres FFI. Il semble que grande soit la crainte de voir se multiplier de tels départs et plus encore l’acceptation de divers évêques de couvrir des religieux dont il apparaît clairement qu’ils sont injustement traités, sans qu’aucun grief n’ait jamais été formulé clairement, ni canoniquement, à leur encontre.
Un site ouvert depuis juin 2014 ((. Cf. http://veritacommissariamentoffi.wordpress.com/2014/11/17/senza-istituzione-non-ce-carisma/. )) , dont le ou les responsables ne sont pas identifiés, a encore accentué le message, peu après la tenue de l’assemblée de la CEI, dans des termes qui retiennent l’attention.
« Un groupe (25+25) prêtres et anciens étudiants » des FFI a pris contact avec certains évêques diocésains pour qu’ils les accueillent. « Cette demande a suscité réserves et perplexité de la part des pasteurs des Eglises locales parce qu’elle s’est avérée non conforme au désir naturel de transformer une vocation [religieuse] individuelle en celle de prêtre diocésain, étant un stratagème pour se soustraire à l’autorité de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et à celle du Commissaire apostolique en pleine phase de vérification canonique, doctrinale, disciplinaire et financière. Le but final des demandes d’incardination diocésaine apparaît clair : c’est la constitution d’une plate-forme de lancement, si possible off-shore, comme celle de l’archidiocèse de Lipa aux Philippines, ou dans un diocèse de minorité catholique, comme en Angleterre, en vue de regrouper des clercs ordonnés in sacris et d’ex-séminaristes FFI dans l’attente d’un changement de cap dans l’actuel gouvernement de l’Eglise universelle qui n’existe que dans les mirages mentaux auxquels n’échappent pas des polémistes tels qu’Antonio Socci », etc. Le ton polémique et menaçant n’hésite pas à incriminer ceux des ecclésiastiques qui pourraient avoir la « faiblesse » de venir en aide aux religieux concernés, d’imiter, par exemple, la « complicité du fortement discuté cardinal Franc Rodé » qui avait accepté de porter une requête au pape François pour que les religieux désireux de célébrer selon l’ancien Ordo puissent relever de la Commission Ecclesia Dei.
Il est remarquable que ce site anonyme soit à la fois étonnamment bien informé et d’une violence de langage non dissimulée, dirigée principalement contre tous ceux qui sont amenés à manifester ne serait-ce que leur étonnement devant les procédés dont sont victimes des religieux dont l’image principale est la stricte observance de la vocation franciscaine. Pourquoi cette hargne, alors même que le nombre des religieux en cause est restreint, et les espérances qui leur sont prêtées purement imaginaires ? On peut émettre l’hypothèse qu’elle puisse traduire un certain dépit devant la multiplication des réactions de réprobation face à la somme d’irrégularités commises, et un traitement en forme de deux poids, deux mesures. Comparativement, en effet, l’action répressive à l’encontre des FFI – dont les fautes supposées n’ont jamais été précisées autrement que par voie d’insinuations vagues –, d’une part, et de l’autre, l’assainissement de la situation des Légionnaires du Christ, pour prendre un cas pour le moins fortement différent, ne se ressemblent nullement. Cette dernière société, fondée par un imposteur scandaleux, est traitée avec beaucoup de lenteur, selon des procédures canoniques régulières et avec de grandes précautions afin d’éviter de porter atteinte à d’authentiques vocations.
Il est probable qu’avec le temps, la rage destructrice exercée contre des religieux à qui l’on reproche avant tout leur état d’esprit « trop » traditionnel (devenu pour les besoins de la cause « crypto-lefebvriste » sinon ultracatholique!) n’ayant pas réussi à atteindre l’objectif recherché puisse bien produire un effet inverse de celui que poursuivent ceux qu’elle anime.
Rubrique(s) : Revue en ligne, Textes
 “Nous sommes en présence de deux phénomènes parallèles, l’un qui est la réaction de défense sanitaire au sein de chaque État , justifiant un « état d’exception » temporaire, proportionné à la gravité réelle d’une menace à l’encontre d’une population, et délimité par la nature médicale de celle-ci, l’autre qui consiste en l’implantation, à la faveur de l’événement, des bases d’un régime politique apparemment nouveau, ayant une allure tyrannique.
“Nous sommes en présence de deux phénomènes parallèles, l’un qui est la réaction de défense sanitaire au sein de chaque État , justifiant un « état d’exception » temporaire, proportionné à la gravité réelle d’une menace à l’encontre d’une population, et délimité par la nature médicale de celle-ci, l’autre qui consiste en l’implantation, à la faveur de l’événement, des bases d’un régime politique apparemment nouveau, ayant une allure tyrannique.


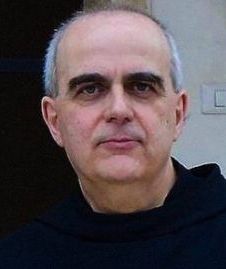 Le texte qui suit est la traduction d’un chapitre du livre collectif Mors tua vita mea, publié sous la direction de Massimo Viglione (Maniero del Mirto, Albano Laziale, 2021, 332 p.), repris ici dans notre traduction avec l’autorisation de l’éditeur et de l’auteur. Le long sous-titre de l’ouvrage en indique l’objet précis : « La fin ne justifie pas les moyens. Sur l’illicéité morale des vaccins qui utilisent les lignes cellulaires de fœtus victimes d’avortements volontaires ».
Le texte qui suit est la traduction d’un chapitre du livre collectif Mors tua vita mea, publié sous la direction de Massimo Viglione (Maniero del Mirto, Albano Laziale, 2021, 332 p.), repris ici dans notre traduction avec l’autorisation de l’éditeur et de l’auteur. Le long sous-titre de l’ouvrage en indique l’objet précis : « La fin ne justifie pas les moyens. Sur l’illicéité morale des vaccins qui utilisent les lignes cellulaires de fœtus victimes d’avortements volontaires ». Parution de cet ouvrage collectif réalisé sous la direction de Bernard Dumont, Miguel Ayuso, Danilo Castellano. Au registre des idées reçues, l’affirmation selon laquelle la dignité humaine est une découverte des Lumières tient une place de choix. Mais on n’a pas attendu Kant pour considérer que l’être humain tient une place éminente dans la Création, et le christianisme voit dans la personne du Verbe incarné l’Exemplaire même de toute dignité. Par contraste, la philosophie moderne a voulu placer la racine de la dignité dans l’autonomie, c’est-à-dire dans l’affranchissement de toute loi extérieure à la volonté humaine, et non plus dans l’honneur d’accomplir librement ce qui est bien.
Parution de cet ouvrage collectif réalisé sous la direction de Bernard Dumont, Miguel Ayuso, Danilo Castellano. Au registre des idées reçues, l’affirmation selon laquelle la dignité humaine est une découverte des Lumières tient une place de choix. Mais on n’a pas attendu Kant pour considérer que l’être humain tient une place éminente dans la Création, et le christianisme voit dans la personne du Verbe incarné l’Exemplaire même de toute dignité. Par contraste, la philosophie moderne a voulu placer la racine de la dignité dans l’autonomie, c’est-à-dire dans l’affranchissement de toute loi extérieure à la volonté humaine, et non plus dans l’honneur d’accomplir librement ce qui est bien. En réponse à Phillipe de Labriolle et Luis Maria de Ruschi, à propos des écrits récents de Claude Jeantin. Claude Jeantin, avocat ecclésiastique (Lyon), a publié dans l’Année Canonique 2016 (Letouzey et Ané Ed., Tome LVII, pp. 39–71), un important article sur le thème « Immaturité Postmoderne et Contrefaçons du Mariage » ; en septembre dernier, une monographie développée sur le même sujet (« L’immaturité devant le Droit Matrimonial de l’Église », même éditeur, 428 p.). Dans
En réponse à Phillipe de Labriolle et Luis Maria de Ruschi, à propos des écrits récents de Claude Jeantin. Claude Jeantin, avocat ecclésiastique (Lyon), a publié dans l’Année Canonique 2016 (Letouzey et Ané Ed., Tome LVII, pp. 39–71), un important article sur le thème « Immaturité Postmoderne et Contrefaçons du Mariage » ; en septembre dernier, une monographie développée sur le même sujet (« L’immaturité devant le Droit Matrimonial de l’Église », même éditeur, 428 p.). Dans 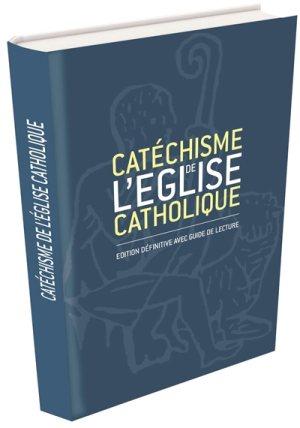 « Si l’Évangile interdit aux États d’appliquer jamais la peine de mort, saint Paul lui-même alors a trahi l’Évangile » Cardinal Journet
« Si l’Évangile interdit aux États d’appliquer jamais la peine de mort, saint Paul lui-même alors a trahi l’Évangile » Cardinal Journet L’entretien suivant avec l’islamologue Marie-Thérèse Urvoy, extrait de notre numéro 139 (printemps 2018), répond indirectement à cette question.
L’entretien suivant avec l’islamologue Marie-Thérèse Urvoy, extrait de notre numéro 139 (printemps 2018), répond indirectement à cette question. Il y a 5 ans, Benoît XVI annonçait, dans l’incrédulité générale, sa renonciation au trône pontifical. Depuis cinq ans, les milieux conservateurs ne cessent de s’interroger sur les raisons profondes de ce geste, dans la mesure où les motifs allégués par l’intéressé dans son discours du 11 février 2013, comme dans les Dernières conversations avec Peter Seewald en 2016, sont apparus comme trop faibles ou décevants au regard de la stature et de l’élévation que ses admirateurs attribuaient et attribuent encore au pape Benoît. Les raisons de la démission étaient, en somme, en contradiction non seulement avec l’éthos théologique – la lutte à mort contre le relativisme –, mais encore avec l’éthos martyrologique que Benoît XVI avait lui-même construit dans ses différents discours de 2005 : l’éthos de celui qui ne fuirait pas devant les loups.
Il y a 5 ans, Benoît XVI annonçait, dans l’incrédulité générale, sa renonciation au trône pontifical. Depuis cinq ans, les milieux conservateurs ne cessent de s’interroger sur les raisons profondes de ce geste, dans la mesure où les motifs allégués par l’intéressé dans son discours du 11 février 2013, comme dans les Dernières conversations avec Peter Seewald en 2016, sont apparus comme trop faibles ou décevants au regard de la stature et de l’élévation que ses admirateurs attribuaient et attribuent encore au pape Benoît. Les raisons de la démission étaient, en somme, en contradiction non seulement avec l’éthos théologique – la lutte à mort contre le relativisme –, mais encore avec l’éthos martyrologique que Benoît XVI avait lui-même construit dans ses différents discours de 2005 : l’éthos de celui qui ne fuirait pas devant les loups.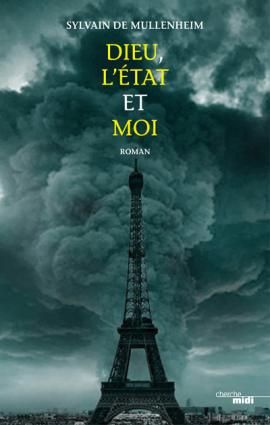 Ce roman est sorti un mois avant le premier tour de l’élection présidentielle. Sans vouloir peiner l’auteur, la plus grande partie de ses 440 pages n’a qu’une valeur mineure, imaginant de manière aussi fantaisiste que conventionnelle les premiers mois d’un nouvel élu à la présidence, immédiatement plongé dans toutes sortes de soucis. L’objet principal n’apparaît que progressivement : ce président, qui est catholique, a d’étranges rêves lumineux, qu’il soumet à examen médical, puis théologique en s’adressant à l’archevêque de Paris et au Pape… Cela lui suggère de faire le lien entre le désordre qu’il constate dans le domaine politique et la nécessité de trouver un fondement stable sur lequel reconstruire un ordre cohérent. « Les Droits de l’homme sont un texte juridique. Aucune loi n’est supportable sans un fondement : il faut un projet qui la sous-tende. Je ne veux plus que les droits de l’homme procèdent de l’individu, mais d’une clé de voûte unique, qui ne soit pas assujettie aux modes. » Il faut « un outil commun, mais indépendant de chacun. Une norme supérieure. Une valeur qui soit indépendante des hommes. Extérieure à eux. Transcendante. » Lorsqu’il officialise les visions dont il bénéficie et les conséquences qu’il en tire, le Sénat le menace de destitution pour atteinte à la sacro-sainte laïcité, tandis que les évêques émettent des déclarations alambiquées.
Ce roman est sorti un mois avant le premier tour de l’élection présidentielle. Sans vouloir peiner l’auteur, la plus grande partie de ses 440 pages n’a qu’une valeur mineure, imaginant de manière aussi fantaisiste que conventionnelle les premiers mois d’un nouvel élu à la présidence, immédiatement plongé dans toutes sortes de soucis. L’objet principal n’apparaît que progressivement : ce président, qui est catholique, a d’étranges rêves lumineux, qu’il soumet à examen médical, puis théologique en s’adressant à l’archevêque de Paris et au Pape… Cela lui suggère de faire le lien entre le désordre qu’il constate dans le domaine politique et la nécessité de trouver un fondement stable sur lequel reconstruire un ordre cohérent. « Les Droits de l’homme sont un texte juridique. Aucune loi n’est supportable sans un fondement : il faut un projet qui la sous-tende. Je ne veux plus que les droits de l’homme procèdent de l’individu, mais d’une clé de voûte unique, qui ne soit pas assujettie aux modes. » Il faut « un outil commun, mais indépendant de chacun. Une norme supérieure. Une valeur qui soit indépendante des hommes. Extérieure à eux. Transcendante. » Lorsqu’il officialise les visions dont il bénéficie et les conséquences qu’il en tire, le Sénat le menace de destitution pour atteinte à la sacro-sainte laïcité, tandis que les évêques émettent des déclarations alambiquées. 
 Dans le n. 131 (printemps 2016) de Catholica, Pierre Charles a présenté un livre paru en Italie, intitulé Ancilla hominis, de Pasquale Danilo Quinto. Il rappelait en commençant qui était cet auteur, renvoyant notamment à son autobiographie parue en 2012, Da servo di Pannella a figlio libero di Dio. Ce titre exprimait clairement une conversion, le passage de la condition d’esclave à la liberté des enfants de Dieu. Esclave de qui ? de Marco Pannella, l’un des plus typiques représentants de tout ce qu’a pu concentrer de haine de l’ordre social l’athéisme activiste post-soixante-huitard. Pannella est mort au mois de mai dernier, mais son parti « radical » demeure actif, tout comme son ancienne compagne de combat Emma Bonino, grande zélatrice de l’avortement, du gender et autres grandes causes du moment.
Dans le n. 131 (printemps 2016) de Catholica, Pierre Charles a présenté un livre paru en Italie, intitulé Ancilla hominis, de Pasquale Danilo Quinto. Il rappelait en commençant qui était cet auteur, renvoyant notamment à son autobiographie parue en 2012, Da servo di Pannella a figlio libero di Dio. Ce titre exprimait clairement une conversion, le passage de la condition d’esclave à la liberté des enfants de Dieu. Esclave de qui ? de Marco Pannella, l’un des plus typiques représentants de tout ce qu’a pu concentrer de haine de l’ordre social l’athéisme activiste post-soixante-huitard. Pannella est mort au mois de mai dernier, mais son parti « radical » demeure actif, tout comme son ancienne compagne de combat Emma Bonino, grande zélatrice de l’avortement, du gender et autres grandes causes du moment.  Le 28 juin dernier, le « pape émérite » a fait un bref retour médiatique, pour participer à une cérémonie organisée au Vatican à l’occasion des 65 ans de son ordination sacerdotale, et présidée par son successeur.
Le 28 juin dernier, le « pape émérite » a fait un bref retour médiatique, pour participer à une cérémonie organisée au Vatican à l’occasion des 65 ans de son ordination sacerdotale, et présidée par son successeur. L’exhortation Amoris laetitia [AL] a donné lieu à de nombreux commentaires. L’un des plus achevés est celui d’Anna M. Silvas, professeur de langues anciennes et de patristique à l’université de la Nouvelle Angleterre (Armidale, NSW, Australie), dont on trouvera le texte complet
L’exhortation Amoris laetitia [AL] a donné lieu à de nombreux commentaires. L’un des plus achevés est celui d’Anna M. Silvas, professeur de langues anciennes et de patristique à l’université de la Nouvelle Angleterre (Armidale, NSW, Australie), dont on trouvera le texte complet  En complément de l’
En complément de l’