Testis, ou Blondel en politique par Bernard Dumont
[note : cet article a été publié dans catholica, n. 73, pp. 87–93]
Deux questions fondamentales ont affecté la participation des catholiques à la vie politique depuis la consolidation du régime républicain en France, l’une concernant la définition de l’ordre politique, l’autre touchant à leur discipline collective en tant que citoyens.
Tout l’enseignement pontifical du XIXe siècle, et une bonne partie de celui du XXe affirment nettement l’existence de principes stables, tirés de la raison naturelle et s’imposant à tous, quoique avec un degré inégal de réalisation dans l’espace et le temps. Il existe des invariants en matière politique et aucune prétendue loi du progrès de l’Histoire ne peut y changer quelque chose, puisque ces invariants découlent de la nature humaine et de ses exigences. Dans l’ordre des réalisations pratiques diverses configurations sont abstraitement ou historiquement pensables, mais aucune de celles-ci n’a de validité si elle n’est ordonnée in fine à la réalisation d’une société juste, conçue comme un cadre permettant à chacun des membres du corps social non seulement d’accomplir le meilleur de son humanité, mais surtout de trouver aide et garantie pour accueillir la vie divine, l’unique nécessaire.
Si cette conception peut déboucher dans l’abstrait sur une pluralité de voies, elle ne permet pas en revanche le choix sur ses propres bases pas plus qu’elle ne fonde, concrètement, le droit de changer l’ordre légitime en vigueur, sinon par mode de proposition. Toute la doctrine théorique d’un Léon XIII s’articule sur ces deux affirmations on ne peut plus opposées à l’idée démocratique moderne (puisque l’essence du contrat social est la capacité de définir l’ordre des choses) et à la principale innovation sur laquelle repose sa pratique, les partis politiques. Elle n’a jamais été révoquée, sinon de manière floue tant à Vatican II que depuis ((. Gaudium et spes, n. 74–3 : « La détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissés à la libre volonté des citoyens ». Ce passage, d’expression inusitée, semble énoncer une obligation de démocratisme. Il est cité dans le Catéchisme de l’Eglise catholique (n. 1901), qui le commente cependant dans un sens des plus classiques : « La diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu’ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte ». Ailleurs dans le même Catéchisme (n. 1904), c’est Jean-Paul II qui est cité (Centesimus Annus, n. 44) : « Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d’autres pouvoirs et par d’autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C’est là le principe de “l’Etat de droit” dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires ». On notera que cette adhésion aux principes de Montesquieu est exprimée sur le mode d’une préférence, sans que l’on puisse savoir si celle-ci signifie l’affirmation d’un plus grand bien dans l’absolu ou ne relève que d’une opinion circonstancielle.)) .
Cette première question de principe s’est doublée d’une autre, liée aux circonstances postrévolutionnaires et à l’exclusion progressive des catholiques hors du champ politique. C’est celle de la naissance du Bloc catholique, de la politique cléricale, épiscopale, pontificale, concevant, jusqu’à très récemment dans un pays comme l’Italie, l’action politique des catholiques comme obligatoirement régie par un principe unitaire absolu, ce principe ne découlant pas de la nature politique des choses, mais de l’utilité, de la puissance opposable à une société toujours plus hostile au christianisme, du nombre des « divisions » destinées à impressionner l’adversaire. De là les grandes discussions autour de l’idée du « parti catholique », dans la période même du Ralliement, de là aussi la tentative ultérieure d’enrégimentement des laïcs dans les rangs de l’Action catholique, organisme auxiliaire du clergé et par conséquent étroitement contrôlé par la hiérarchie ecclésiastique.
A la jointure des XIXe et XXe siècles, une partie des catholiques « sociaux », les abbés démocrates, les sillonnistes disciples de Marc Sangnier se sont opposés sur le terrain théorique à ce qui pouvait condamner d’avance le principe même de leur entreprise, c’est-à-dire à toute idée d’un ordre politique valable universellement, conservatrice et officiellement catholique, autrement dit à ce que depuis on a appelé l’intégralisme catholique. Ils préféraient très spontanément une conception plus relative, plus évolutive, plus historicisée, qui leur permettrait de justifier leur acceptation des nouvelles règles du jeu politique, considérées comme un donné neutre, un héritage de l’évolution naturelle et du progrès social, et encore comme un terrain à occuper « en chrétien » et non « en tant que chrétien », selon l’astucieuse distinction plus tard lancée par Jacques Maritain. Pour les mêmes raisons, ils ne pouvaient que se montrer hostiles à toute idée de bloc catholique sous direction cléricale unitaire, excluant leur liberté de manœuvre et d’allure trop guerrière. Sans lien univoque avec la querelle théologique du modernisme, le partage des eaux devait cependant déboucher sur des alliances ou des pactes de non-agression pratiquement inévitables : ralliés et modernistes d’un côté, fidèles à l’orthodoxie romaine et intégralistes de l’autre.
Cette répartition s’est compliquée quand les catholiques intégraux ont fait massivement allégeance à Charles Maurras. Conservant une vision de chrétienté, ils se sont, de facto, soustraits à la tutelle cléricale pour se placer sous celle d’un non-chrétien, disciple d’Auguste Comte et aussi inaccessible que lui au raisonnement métaphysique, considérant la politique comme une science sociale empirique analogue à la physique. Salué comme homme providentiel en raison de l’admiration qu’il vouait à l’Eglise de l’Ordre et à la cohérence logique de la doctrine catholique, et parce qu’il rejetait le régime antichrétien issu de la Révolution, Maurras a forcément fait figure de concurrent pour le parti clérical. Mais dans le même temps, il constituait aussi un obstacle pour les ralliés qui ne manquèrent pas de l’attaquer et surtout de s’en prendre aux catholiques qui se mettaient à sa suite. Ils leur reprochaient leur esprit de transaction envers l’incroyant Charles Maurras. Le reproche était sans doute fondé, mais assez impudent puisque eux aussi transigeaient dans la pratique, mais avec les républicains cette fois. De ce fait, le parti clérical et le parti rallié se retrouvèrent, pour assez longtemps, dans le même camp.
C’est sur ce fond circonstanciel qu’il faut lire un texte perdu de vue, rédigé par Maurice Blondel en défense des Semaines sociales, initiative lancée au début du XXe siècle comme une sorte d’université populaire, et rapidement devenue un milieu de support du Ralliement ; une défense qui prit d’ailleurs exclusivement la forme d’une attaque dirigée contre ceux qui le refusaient. Le titre original, publié sous le pseudonyme de Testis, en était plus neutre (Catholicisme social et monophorisme), mais l’éditeur actuel lui a préféré une sorte de message didactique : Une alliance contre nature : catholicisme et intégrisme. La Semaine sociale de Bordeaux 1910 (Lessius, Bruxelles, 2000). Le préfacier, Mgr Peter Henrici, évêque-auxiliaire de Coire, en Suisse, coordonnateur international de Communio et ancien professeur d’histoire de la philosophie à la Grégorienne, reconnaît le caractère assez insolite de la réédition de ces textes de circonstance et dont le style polémique, qui date souvent fortement, ne peut qu’agacer un lecteur s’attendant à autre chose de la part d’un philosophe honoré pour la largeur de ses vues. Voulant rassurer ce lecteur, il recourt à un double argument d’autorité : les considérations de Blondel en matière politique « sont devenues aujourd’hui le patrimoine commun de la théologie catholique », et « cet acquis a été confirmé, de manière positive et avec la plus haute autorité, par la constitution pastorale Gaudium et spes de Vatican II » (p. XV).


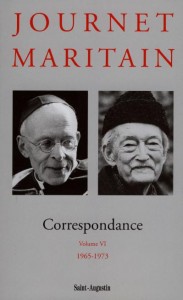 précisions à certains sujets abordés dans la correspondance comme le catéchisme hollandais, la régulation des naissances, la traduction française du Canon, le nouveau Missel (à noter, pp. 1044–1048, le jugement du Cardinal Journet sur la nouvelle Messe).
précisions à certains sujets abordés dans la correspondance comme le catéchisme hollandais, la régulation des naissances, la traduction française du Canon, le nouveau Missel (à noter, pp. 1044–1048, le jugement du Cardinal Journet sur la nouvelle Messe).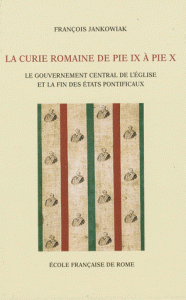 pontificaux, à l’encontre du fonctionnement de l’administration pontificale, notamment locale, rejailliront sur son gouvernement central spirituel. Ce n’est qu’à partir de la disparition des Etats pontificaux que la Curie se transformera véritablement, en reportant sur le pouvoir spirituel ses fonctions antérieurement exercées au temporel. F. Jankowiak note à cet égard (pp. 342–357) que le concept de société parfaite, c’est-à-dire ayant en elle-même les moyens suffisants de sa propre existence, appliqué à l’Eglise, est consacré très exactement au moment où l’Etat pontifical est amputé d’une partie de ses territoires (Constitution apostolique Cum Catholica Ecclesia), cette nouvelle précision consistant en une remise à l’honneur, par une « représentation fixiste » de l’histoire, d’une « image exaltée » de la chrétienté médiévale. Ainsi présentée, cette opposition à la modernité, et singulièrement à une modernité politique qui dépossède l’Eglise de toute charge temporelle, sera accentuée par le Syllabus et Quanta Cura, sans que cette condamnation soit dépourvue d’ambiguïtés. Evoquant la (longue) genèse du Code de droit canon, F. Jankowiak montre bien à cet égard que l’influence de la codification napoléonienne et de la rationalisation positiviste qui lui est sousjacente n’est pas étrangère à la rédaction du code, même si, bien entendu, l’esprit et l’objectif en sont radicalement différents.
pontificaux, à l’encontre du fonctionnement de l’administration pontificale, notamment locale, rejailliront sur son gouvernement central spirituel. Ce n’est qu’à partir de la disparition des Etats pontificaux que la Curie se transformera véritablement, en reportant sur le pouvoir spirituel ses fonctions antérieurement exercées au temporel. F. Jankowiak note à cet égard (pp. 342–357) que le concept de société parfaite, c’est-à-dire ayant en elle-même les moyens suffisants de sa propre existence, appliqué à l’Eglise, est consacré très exactement au moment où l’Etat pontifical est amputé d’une partie de ses territoires (Constitution apostolique Cum Catholica Ecclesia), cette nouvelle précision consistant en une remise à l’honneur, par une « représentation fixiste » de l’histoire, d’une « image exaltée » de la chrétienté médiévale. Ainsi présentée, cette opposition à la modernité, et singulièrement à une modernité politique qui dépossède l’Eglise de toute charge temporelle, sera accentuée par le Syllabus et Quanta Cura, sans que cette condamnation soit dépourvue d’ambiguïtés. Evoquant la (longue) genèse du Code de droit canon, F. Jankowiak montre bien à cet égard que l’influence de la codification napoléonienne et de la rationalisation positiviste qui lui est sousjacente n’est pas étrangère à la rédaction du code, même si, bien entendu, l’esprit et l’objectif en sont radicalement différents.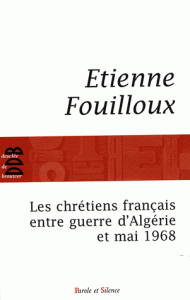 donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».
donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».