Depuis quelques années sont recensés dans cette revue les différents travaux, tant historico-sociologiques que de science politique, sur les espaces de chrétienté parmi les plus marqués et leurs évolutions contemporaines (( Cf. notamment le dossier « Québec, Vendée, Catalogne », Catholica, n. 83, printemps 2004.)) . Malgré la diversité des histoires et des caractéristiques propres à chaque situation, ces études présentent des similitudes, notamment un tropisme de l’analyse sociologique, et la reprise de l’idée que, dans le cadre de son conflit avec la modernité, l’Eglise n’a su adapter ni son discours, ni le fonctionnement de ses institutions, devenus autant de causes de son déclin. Dépassé, le schéma politique et social promu par l’Eglise serait devenu inaudible aux populations captées par la nouveauté et le renouvellement permanent du message immanentiste moderne, l’avènement d’une société ouverte, urbaine, technicienne et opulente.
Michael Gauvreau, professeur d’histoire à l’Université McMaster de Hamilton dans l’Ontario, renverse radicalement cette perspective dans son ouvrage sur Les Origines catholiques de la Révolution tranquille au Québec, qui est un apport très riche dans l’historiographie religieuse (( Michael Gauvreau, Les Origines catholiques de la Révolution tranquille, Fides, Montréal, 2008, 36 € ; prix Sir John A. MacDonald pour la première édition en 2007 chez McGilI-Queen’s Press décerné par la Société historique du Canada. Ce travail se fonde notamment sur les documents produits dans les années trente et quarante par les organismes laïques de l’Action catholique regroupés en partie dans le fonds Action catholique canadienne mais également sur des journaux et périodiques comme Le Devoir, La Revue dominicaine, Maintenant et Relations. L’auteur souligne que ces textes sont des œuvres de laïcs, mais également « de puissants ordres religieux comme les Dominicains et les Jésuites, impliqués durant toute cette période dans un certain nombre d’initiatives sociales ».)) .
L’auteur réfute en effet l’idée reçue selon laquelle la « Révolution tranquille » serait « ce courant essentiellement politique qui a fait irruption dans la société québécoise au début des années soixante et qui a détruit les vieilles structures dominées par une Eglise pétrie de conservatisme obscurantiste ». Dès le début de sa réflexion sur les origines de l’événement, l’auteur rappelle tout d’abord qu’ont longtemps régné presque exclusivement deux écoles d’interprétation. La première analyse le processus de la Révolution tranquille par un facteur externe : le face-à-face d’un milieu conservateur, clergé et petite bourgeoisie, soutien de régimes fixistes à peine réformistes, et d’une élite intellectuelle et activiste organisant, au cours des années soixante, la montée en puissance et la diffusion des idées libérales, puis libertaires et « nationalistes ». L’action de cette avant-garde aboutit « logiquement » à la substitution du système sclérosé et de sa hiérarchie sociale à seul fondement de maintien des acquis, par celui, laïcisé, de promotion d’une « libération » tous azimuts.
Cette école valorise donc l’« événement », une action politique d’un petit groupe « éclairé » au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui trouve un commencement de réalisation dans les années soixante. La deuxième école intègre le déclin du magistère politique et social de l’Eglise dans un courant plus général englobant l’ensemble des paramètres constitutifs de la société québécoise depuis le XIXe siècle : « Depuis 1970, s’est développée une deuxième interprétation historique, que l’on qualifiera pour aller vite de “révisionniste”, occupée celle-là à l’étude des structures et des processus économiques, et dont la visée est de situer la société québécoise à l’intérieur du cadre capitaliste libéral et moderne. Insistant sur le caractère pluraliste “normal” de cette société, elle trouve les vraies racines du Québec moderne au XIXe siècle plutôt que dans la découverte soudaine, par les intellectuels, des réalités sociales de l’après-guerre ».
Cette deuxième école relativise donc et le particularisme, jusque-là systématiquement mis en avant, d’un conservatisme québécois original par rapport à l’ensemble du Canada, et l’idée d’une résistance à la modernité qu’aurait incarnée un pouvoir bicéphale clérico-conservateur. En réalité, le conservatisme des hommes politiques et du clergé n’assume aucune rupture avec l’idéologie libérale dominante du temps mais se revêt de l’apparence d’un maintien à vocation d’immuabilité de l’ordre social, de la morale et des acquis.
Michael Gauvreau rompt la monotonie de ces analyses quasi dialectiques des sociologues et des politistes, lesquels considèrent le catholicisme comme « figurant plus ou moins passif, jamais comme un acteur de premier plan de l’histoire du Québec moderne », pour expliquer en quoi la révolution culturelle des années soixante trouve en réalité son origine dès l’entre-deux-guerres, dans l’action de multiples initiatives au cœur même de l’Eglise du Québec, pourtant censée incarner le refuge des pesanteurs sociales réalisant l’« équation automatique entre la naissance d’une société urbaine et industrielle et le déclin de la religion ». La raison de cette différence d’analyse et de l’originalité de cette étude réside dans le fait que l’auteur ne néglige pas l’importance du rôle de force sociale assumé par l’Eglise, comme le font habituellement les analystes incapables d’assimiler l’imprégnation en profondeur d’une société christianisée.
Or, de nombreux groupes, essentiellement des mouvements de jeunesse catholique comme l’Action catholique elle- même, vont agir dans le cours de la transformation de la société en créant de nouvelles brèches, en pesant de tout leur poids sur la nature révolutionnaire du processus de « diversité idéologique, marquée par de nombreuses et puissantes initiatives laïques dans les domaines social et culturel ».
Sans qu’il s’agisse vraiment d’un cléricalisme qui aurait exclusivement concerné l’action des ecclésiastiques, c’est la traditionnelle influence de l’Eglise sur la société québécoise qui va servir de levier, dès les années trente, aux mouvements de jeunesse pour opérer un renversement radical de la perspective catholique dans la vie sociale, jusqu’à induire in fine une opposition avec la doctrine sociale traditionnelle et un retrait discret de l’Eglise du champ politique. Michael Gauvreau explique donc très bien en quoi c’est justement plutôt l’implication de l’Eglise et des catholiques dans la société québécoise qui entraîne cette réorientation vers la modernité d’un processus de formation de l’identité nationale, qu’il soit religieux, culturel et social, en répondant dans le corps de son travail aux questions posées dans l’introduction : « La version Action catholique du catholicisme constituait-elle le noyau dur de la tradition, ou ne fut-elle pas plutôt un facteur déterminant dans l’insertion de valeurs culturelles modernes dans la société québécoise ?
Comme le suggèrent les visions révisionniste et orthodoxe libérale, le catholicisme est-il resté en marge de l’édification de la société urbaine moderne au Québec, ou n’aurait-il pas ouvert grand l’éventail d’identités sociales plus dynamiques et plus démocratiques ? Et si la “modernité”, en tant que phénomène culturel, doit être comprise comme une recherche d’expériences intenses et enrichissantes pour la personne, et comme un profond sentiment de rupture avec le passé, les historiens ne devraient- ils pas, vu la forte imprégnation de la vie publique et des valeurs sociales québécoises par le catholicisme avant 1960, se pencher sur la religion, et en particulier sur les transformations internes au catholicisme, pour bien voir les changements qui ont contribué à définir tout un ensemble de valeurs “modernes” au sein des idéologies publiques et des diverses quêtes d’identité personnelles incarnées dans et par la jeunesse, la masculinité, la féminité et la famille ? »
La séquence historique clairement décrite par l’auteur se décompose essentiellement en deux périodes. La première commence dans les années trente au Québec avec l’Action catholique de formation fortement personnaliste, développant le projet modérantiste ((Cf. sur le sujet Bernard et Gilles Dumont, Christophe Réveillard (dir.), La Culture du refus de l’ennemi. Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle, Presses universitaires de Limoges (PULIM), coll. « Bibliothèque européenne des idées », Limoges, 2007.)) classique de l’adaptation au monde, pour établir une « jonction avec la modernité […]. En dépit d’évidents et puissants courants conservateurs au sein du catholicisme, l’Eglise a vu naître et s’imposer une importante diversité idéologique, marquée par de nombreuses et puissantes initiatives laïques dans les domaines social et culturel. Leurs principaux promoteurs appartenaient à l’Action catholique, un regroupement d’organismes jusque-là tenus pour marginaux dans l’interaction église-société, comme les jeunes, les ouvriers et les femmes », comme le développent très précisément les chapitres III, « Mariage, sexualité, nucléarité : la reconstruction de la famille canadienne-française, de 1931 à 1955 », IV, « 1955–1970 : la désagrégation et la privatisation de la famille canadienne française », et V, « Sexualité, régulation des naissances et féminisme personnaliste, de 1931 à 1971 ».
Selon nous, poursuit Michael Gauvreau, « ces divers mouvements ont, depuis l’origine, articulé une puissante critique de la hiérarchie catholique — débouchant même à l’occasion sur l’anticléricalisme. En insistant pour que les structures ecclésiales s’ajustent aux besoins des laïcs, ces mouvements d’Action catholique ont mis en lumière la dimension plus démocratique de la religion. Leur seule existence prouve […] le besoin de revoir de fond en comble la façon qu’avait le catholicisme québécois d’intervenir dans la formation des valeurs culturelles d’une société moderne et libérale au milieu du XXe siècle ».
Cette phase va crescendo jusqu’au début des années cinquante avec les revendications de démocratisation, d’égalitarisme et de rejet des formes anciennes de la pratique religieuse. En fait, ce premier processus s’achève sur la consommation d’une rupture générationnelle complète, c’est-à-dire assumant le renouvellement de la pratique, de la liturgie, des fondements doctrinaux et de la place de l’Eglise au sein de la société, comme un « rejet — celui de toute une génération — d’une continuité temporelle avec le passé », la coupure fondamentale entre passé et présent, l’abîme entre les deux exigeant que les « identités personnelles, familiales et sociales soient abordées dans un cadre entièrement renouvelé ». Mais jusqu’à ce moment, les militants de l’Action catholique et des mouvements de jeunesse sont pénétrés de l’illusion que leur mission ancre « plus solidement encore le catholicisme dans la culture publique québécoise ». Il s’agit encore de modérés, de type silloniste et démocrate-chrétien, persuadés de servir l’Eglise par cette action de normalisation et d’assimilation de la modernité. L’amplification de l’impact de cette première période de la Révolution tranquille est due à l’exceptionnelle présence de l’Eglise comme acteur de premier plan accompagnant, et par là, légitimant tous les bouleversements culturels et des mœurs, touchant notamment aux conceptions pédagogiques dans l’enseignement, au rôle de la femme et à l’évolution des structures familiales. Mais, bien évidemment, cet aggiornamento conduit naturellement à une nouvelle étape avec des acteurs de premier plan différents.
La deuxième période court des années cinquante aux années soixante- dix et elle correspond à la substitution des dirigeants de l’Action catholique par des intellectuels catholiques dont le projet est essentiellement d’ordre politico-social.
Michael Gauvreau décrit très précisément une caractéristique très originale de cette culture intellectualiste et élitiste incarnée par Fernand Dumont, la revue Maintenant et le clergé progressiste. Au nom de l’équation entre catholicité et modernité, ce groupe d’intellectuels réoriente le discours de l’Action catholique vers un élitisme spirituel agressif, « très centré sur le mâle, et affichant le plus profond mépris pour la pratique religieuse des masses laborieuses », jugée trop vide et conformiste, « trop soumise à sa direction cléricale, essentiellement un rituel, qui plus est trop adapté à la piété féminine pour intéresser en quoi que ce soit un leadership masculin formé dans les universités et conscient, lui, des grands enjeux sociaux ». Ces intellectuels craignaient une déchristianisation en raison de cette sclérose culturelle et sociale du catholicisme québécois, telle une menace qu’aurait fait planer ce type de catholicisme populaire sur la culture de la classe moyenne, « faite de rationalité, de professionnalisme et d’éducation supérieure ». Mais cette position critique en matière religieuse opère un glissement vers une posture politique : « Leur équation vide religieux / domination cléricale prend bientôt l’allure d’une charge à fond de train contre le gouvernement de Maurice Duplessis [incarnant] l’alliance corrompue d’une piété populaire à l’ancienne et d’une structure ecclésiastique écrasante ».
S’inscrivant dans le contexte général des pays industrialisés connaissant une vague de déchristianisation sans précédent, ces nouveaux acteurs développent le projet d’utiliser l’Eglise dans la défense du cadre identitaire québécois essentiellement face au rouleau compresseur a- culturel anglo-saxon. Ce projet nécessite, selon eux, une alliance entre le souverainisme québécois et la social-démocratie, alliance dans laquelle l’Eglise jouerait le rôle de ciment social, mais dont l’expression de la foi ne serait, elle, ni sociale ou collective, mais relevant de la sphère individuelle et privée. Ce basculement est donc distinct de l’objectif de la première génération de l’Action catholique et se focalise, on l’a vu, essentiellement sur un projet d’indépendance nationale et de souveraineté politique encadrant une société de type social-démocrate dans laquelle l’Etat serait l’acteur hégémonique ((Cette dissociation entre un catholicisme culturel, ingrédient d’une idéologie politique nationale (ou nationaliste), et un catholicisme cultuel confiné à la sphère privée suggère la comparaison avec l’Irlande et le Pays basque.)) . L’appel à l’engagement des catholiques se fait donc à cette condition supplémentaire que vont progressivement intégrer des structures et des hommes, clercs comme laïcs, déjà largement préparés à ce renoncement par les conséquences de la période précédente. C’est pourquoi il est tout à fait symptomatique que la création en 1968 du Parti québécois ait eu lieu au monastère des Dominicains de Montréal, abritant de plus la revue Maintenant, organe essentiel de la diffusion de ces conceptions. C’est pourquoi également, il n’est absolument pas indifférent que l’acteur principal de ce saut qualitatif de la « sécularisation » de la mission de l’Eglise, Fernand Dumont, auquel Michel Gauvreau consacre tout un chapitre, ait été choisi en 1968 par la hiérarchie catholique pour présider la Commission d’étude sur les laïcs et l’Eglise. C’est lui qui exprimera la vision de ces intellectuels de la deuxième période, celle qui solde les acquis de l’influence traditionnelle de l’Eglise mais également les apports de l’Action catholique des années 1930 à 1950, au profit d’un nationalisme libéral de facture contractualiste. Les termes choisis par l’auteur pour expliquer la condition d’accession de la société québécoise au souverainisme libéral sont intéressants à plus d’un titre : « La Commission Dumont marque la fin de la Révolution tranquille au sens fort du terme. En rejetant les formes d’engagement institutionnel et la spiritualité des années antérieures aux années 1960, elle a annihilé toutes les chances de compromis avec la vieille garde catholique, et elle a ainsi contribué à implanter une définition personnaliste de la religion au sein même de l’Eglise. Ses
appels à l’engagement public de l’Eglise aux côtés de la nouvelle pensée nationaliste ont ouvert la porte à un messianisme religieux qui, dans les faits, allait réduire en miettes le legs culturel des années 1760 à 1960, en proposant au Québec une synergie originale de catholicisme et d’inspiration nationaliste démocratique. Sans révolution violente, les Québécois allaient accéder à l’indépendance nationale, juste en développant la logique des solidarités communautaires implicites au catholicisme mais occultées par un clergé réactionnaire et une petite-bourgeoisie collabo- rationniste. Dumont et les autres membres de la Commission ont tracé une voie dans laquelle leurs compatriotes iraient plus loin encore que les réalisations de l’ère personnaliste (en gros de 1931 à 1964), qui, en tant que rupture spirituelle et culturelle entre valeurs traditionnelles et valeurs de la modernité, a inauguré la Révolution tranquille ». Ainsi la Révolution tranquille, assimilée au triomphe, dans les années 19601980, du « néo-libéralisme et du néo-nationalisme » (( Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert, François Ricard, Histoire du Québec contemporain : le Québec depuis 1930, Boréal, Montréal, 1989.)) et également associée aux campagnes interventionnistes de l’Etat dans les domaines de l’éducation, de l’économie, de la santé et des services sociaux, entraîne de plus cette conséquence au niveau religieux.
Richard Bastien (( « Notes de lecture », Egards [Montréal], n. 21, automne 2008, pp. 84–91.)) achève une recension sur l’ouvrage de Michael Gauvreau en écrivant qu’il « aurait été justifié d’intituler son livre Histoire d’une trahison », laissant paraître son regret de cette rupture intergéné- rationnelle, de la déchristianisation radicale, de la rapide déconfession- nalisation au profit du nationalisme laïque dont le « fondement et l’unité ne relevaient plus d’une croyance religieuse commune, mais de l’économie, de la langue et du pouvoir de l’Etat », lequel avait marginalisé en très peu d’années le rôle social et culturel du catholicisme au sein de la société québécoise. Le regret affleure également dans cette recen- sion que le projet ait également accouché de l’échec politique puisque le nivellement culturel et social québécois, au niveau de celui de l’Amérique du Nord dans son ensemble, semble être un fait acquis exception faite de la langue.
Mais avec Les Origines catholiques de la Révolution tranquille, Michael Gauvreau n’indique-t-il pas que c’est parce que la rencontre avec la modernité a déjà eu lieu de façon non visible mais bien réelle, dans le cadre des mouvements de jeunesse, au sein de débats internes dans les séminaires, dans les congrégations, dans les organes de presse religieux, etc., que la révélation de la recherche de l’autonomie par l’Action catholique, d’abord, puis par les « théologiens laïcs » ensuite ne doit pas étonner ? La pluralité des courants idéologiques au sein même de l’Eglise est telle que son influence dans la société, que ce soit par la maîtrise de la piété populaire ou comme fonds culturel de l’élite intellectuelle et universitaire, ne peut que mécaniquement amplifier ces débats hors de son cadre ecclésial au moment de sa médiatisation. En sorte que pour un certain clergé progressiste, la révolution des cadres conceptuels traditionnels par la Révolution tranquille est une expression de la force de l’influence et de l’assise de l’Eglise dans la société, lors même qu’elles sont tout près de s’effondrer d’un coup. Nous retrouvons cette pratique révolutionnaire, une mécanique qu’aura étudiée Michael Gauvreau pour apprécier en profondeur les origines et le terreau du phénomène, devant conserver jusqu’à l’ultime moment l’apparence de l’ordre, principalement moral et social, pour se donner les moyens de détruire le plus à la racine les fondements de la société traditionnelle. Ici, l’auteur décrit remarquablement l’alliance objective et involontaire d’un cléricalisme favorisant l’anti-intellectualisme d’une piété populaire ritualisée et contrôlée par les cadres ecclésiaux, et de l’élitisme intellectualiste, d’une avant-garde théologienne pleine de suffisance, agissant dans le cadre d’un projet politique prétendument souverainiste alors qu’il se trouve détaché de l’origine de toute souveraineté, de tout pouvoir.
Rubrique(s) : Dossiers thématiques
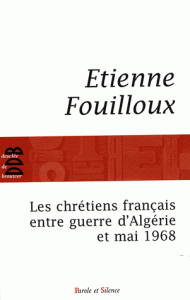 donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».
donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».


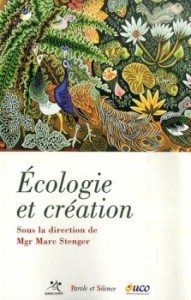 donner l’impression au lecteur que l’Eglise cherche à rattraper son retard et se lance maladroitement dans la surenchère écologique. A la pointe de l’épiscopat français sur les questions écologiques (notamment en tant que président de Pax Christi France), Mgr Stenger inaugure ce colloque en apportant une double réfutation : le christianisme ne reconnaît pas la tyrannie de l’homme sur la création et le Saint-Siège n’est pas coupable d’avoir gardé le silence sur la crise écologique contemporaine. Portée en 1967 par le professeur américain d’histoire médiévale Lynn Townsend White, la première accusation repose sur une interprétation malhonnête de la Genèse : en enseignant que Dieu a demandé à l’homme de « dominer » la Terre, le judéo-christianisme aurait justifié l’exploitation immodérée de la nature. Cette thèse a depuis été largement remise en cause ((. Voir par exemple Françoise Champion, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des Sciences sociales des religions, n. 90, avril-juin 1995, pp. 39–56. )) et l’on peut s’étonner que Mgr Stenger y consacre la moitié de son intervention. L’autre réfutation apportée par l’évêque de Troyes porte sur le prétendu silence du Saint-Siège en matière d’environnement. Pour disculper le Vatican, Mgr Stenger démontre que depuis le message adressé par Paul VI à la conférence de Stockholm en 1972, les papes n’ont jamais cessé de dénoncer la destruction de la nature et le gaspillage de ses ressources.
donner l’impression au lecteur que l’Eglise cherche à rattraper son retard et se lance maladroitement dans la surenchère écologique. A la pointe de l’épiscopat français sur les questions écologiques (notamment en tant que président de Pax Christi France), Mgr Stenger inaugure ce colloque en apportant une double réfutation : le christianisme ne reconnaît pas la tyrannie de l’homme sur la création et le Saint-Siège n’est pas coupable d’avoir gardé le silence sur la crise écologique contemporaine. Portée en 1967 par le professeur américain d’histoire médiévale Lynn Townsend White, la première accusation repose sur une interprétation malhonnête de la Genèse : en enseignant que Dieu a demandé à l’homme de « dominer » la Terre, le judéo-christianisme aurait justifié l’exploitation immodérée de la nature. Cette thèse a depuis été largement remise en cause ((. Voir par exemple Françoise Champion, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des Sciences sociales des religions, n. 90, avril-juin 1995, pp. 39–56. )) et l’on peut s’étonner que Mgr Stenger y consacre la moitié de son intervention. L’autre réfutation apportée par l’évêque de Troyes porte sur le prétendu silence du Saint-Siège en matière d’environnement. Pour disculper le Vatican, Mgr Stenger démontre que depuis le message adressé par Paul VI à la conférence de Stockholm en 1972, les papes n’ont jamais cessé de dénoncer la destruction de la nature et le gaspillage de ses ressources.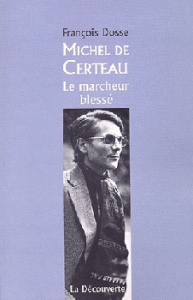 ts de lancement qui caractérisent désormais les rentrées littéraires. Pour la plupart d’entre elles, ces publications signent l’achèvement de cycles universitaires (séminaires, travaux de recherches) et présentent un intérêt particulier pour comprendre une partie étonnante de la configuration des sciences sociales des trente dernières années. Comment concevoir, en effet, le fait de voir se côtoyer des penseurs laïcs souvent de gauche et de nombreux ecclésiastiques (ou ex-), jésuites, dominicains… comment expliquer la proximité frappante des approches théoriques d’un personnage comme Paul Ricœur et celle d’une certaine exégèse critique d’après le Concile Vatican II ? C’est cette sorte de fusion — collusion ? — que François Dosse, dans Le Marcheur blessé ((. François Dosse, Michel de Certeau. Le marcheur blessé, La Découverte, septembre 2002, 39 €.)) , permet d’approcher à travers le parcours de Michel de Certeau, sans que cela soit d’ailleurs tout à fait son objectif premier. Le ton fortement enthousiaste y engage en effet à suivre celui qui fut séminariste dans un Issy-les-Moulineaux d’après-guerre, dans ce contexte préconciliaire qui lui permettra de soutenir un certain nombre de thèses situées déjà nettement en retrait de la doctrine traditionnelle de l’Eglise. Il n’en reste pas moins — et ce flou des frontières de l’Eglise de ces années mériterait sans doute la peine d’être interrogé davantage que F. Dosse ne le fait — que ses positions ne l’amèneront jamais véritablement à formaliser son départ de la Compagnie de Jésus qu’il avait intégrée au début des années 1950. L’ouvrage permet notamment de mettre en relief sa forte participation à la revue Christus, un long passage ponctué par son ordination en 1957, mais surtout par ses rédactions d’articles fortement critiques sur la hiérarchie et l’autorité doctrinale, avec par exemple l’introduction subtile de la critique de la foi comme élément vivifiant de celle-ci. On peut ainsi mieux entrevoir le rôle actif de cette revue dans la prise en charge d’une importation dans l’Eglise de toute une série d’éléments pour le moins hétérodoxes, en particulier de la psychanalyse et de ses échanges tumultueux avec la mystique. Certeau œuvrait alors à une thèse sur le P. Jean-Joseph Surin, interrompue par sa mort. Autre exemple que donne l’ouvrage d’une convergence « réussie » entre sciences humaines et études religieuses, celui de la rencontre avec le père Moingt et la Bibliothèque des sciences religieuses, qui donnera lieu à une exégèse de type nouveau assez insidieuse.
ts de lancement qui caractérisent désormais les rentrées littéraires. Pour la plupart d’entre elles, ces publications signent l’achèvement de cycles universitaires (séminaires, travaux de recherches) et présentent un intérêt particulier pour comprendre une partie étonnante de la configuration des sciences sociales des trente dernières années. Comment concevoir, en effet, le fait de voir se côtoyer des penseurs laïcs souvent de gauche et de nombreux ecclésiastiques (ou ex-), jésuites, dominicains… comment expliquer la proximité frappante des approches théoriques d’un personnage comme Paul Ricœur et celle d’une certaine exégèse critique d’après le Concile Vatican II ? C’est cette sorte de fusion — collusion ? — que François Dosse, dans Le Marcheur blessé ((. François Dosse, Michel de Certeau. Le marcheur blessé, La Découverte, septembre 2002, 39 €.)) , permet d’approcher à travers le parcours de Michel de Certeau, sans que cela soit d’ailleurs tout à fait son objectif premier. Le ton fortement enthousiaste y engage en effet à suivre celui qui fut séminariste dans un Issy-les-Moulineaux d’après-guerre, dans ce contexte préconciliaire qui lui permettra de soutenir un certain nombre de thèses situées déjà nettement en retrait de la doctrine traditionnelle de l’Eglise. Il n’en reste pas moins — et ce flou des frontières de l’Eglise de ces années mériterait sans doute la peine d’être interrogé davantage que F. Dosse ne le fait — que ses positions ne l’amèneront jamais véritablement à formaliser son départ de la Compagnie de Jésus qu’il avait intégrée au début des années 1950. L’ouvrage permet notamment de mettre en relief sa forte participation à la revue Christus, un long passage ponctué par son ordination en 1957, mais surtout par ses rédactions d’articles fortement critiques sur la hiérarchie et l’autorité doctrinale, avec par exemple l’introduction subtile de la critique de la foi comme élément vivifiant de celle-ci. On peut ainsi mieux entrevoir le rôle actif de cette revue dans la prise en charge d’une importation dans l’Eglise de toute une série d’éléments pour le moins hétérodoxes, en particulier de la psychanalyse et de ses échanges tumultueux avec la mystique. Certeau œuvrait alors à une thèse sur le P. Jean-Joseph Surin, interrompue par sa mort. Autre exemple que donne l’ouvrage d’une convergence « réussie » entre sciences humaines et études religieuses, celui de la rencontre avec le père Moingt et la Bibliothèque des sciences religieuses, qui donnera lieu à une exégèse de type nouveau assez insidieuse. nielle Hervieu-Léger, future figure de proue de la sociologie religieuse. Le vrai mérite de l’ouvrage semble bien résider dans cette mise en lumière du fait que théologie et histoire de l’Eglise depuis 1945 sont impensables sans la perspective de leur irradiation par les sciences humaines les plus idéologisées.
nielle Hervieu-Léger, future figure de proue de la sociologie religieuse. Le vrai mérite de l’ouvrage semble bien résider dans cette mise en lumière du fait que théologie et histoire de l’Eglise depuis 1945 sont impensables sans la perspective de leur irradiation par les sciences humaines les plus idéologisées.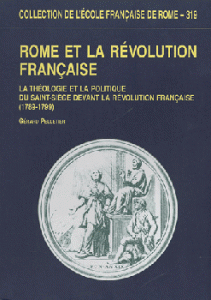 aliquantum et Caritas et de la perte d’Avignon. Après une longue analyse plus théologique, une quatrième partie décrit les suites de cette rupture, entre l’été 91 et l’été 93, en particulier les rapports à l’épiscopat légitime, à l’Eglise constitutionnelle, aux serments, au danger d’occupation française et au régicide du 21 janvier. La dernière, de 93 à 99, achève la chronologie avec la diplomatie pontificale face aux Puissances, les relations avec le Clergé, les tribulations de Pie VI jusqu’à la mort à Valence. Un aperçu des premières relectures théologiques, dès 99, toutes centrées sur une providentielle exaltation de la primauté contre les conceptions gallicanes (moralement corroborée par le « martyre » du Pape) vient clore le tout, avant que la conclusion générale n’insiste sur la période comme tournant décisif de la théologie romaine. Car G. Pelletier ne cherche pas seulement à ressusciter l’intéressante figure de Pie VI, dans la ligne des commémorations de 1999, ni à faire mieux connaître de grands fonds d’archives trop ignorés (synthèse des sources, pp. 7–28), il veut encore montrer la complexité des problèmes théologiques posés au Pape et à son entourage par le cours des événements, en vue de renouveler la compréhension « des étapes qui conduisirent la théologie catholique aux définitions de Vatican I en 1870 » (p. 1).
aliquantum et Caritas et de la perte d’Avignon. Après une longue analyse plus théologique, une quatrième partie décrit les suites de cette rupture, entre l’été 91 et l’été 93, en particulier les rapports à l’épiscopat légitime, à l’Eglise constitutionnelle, aux serments, au danger d’occupation française et au régicide du 21 janvier. La dernière, de 93 à 99, achève la chronologie avec la diplomatie pontificale face aux Puissances, les relations avec le Clergé, les tribulations de Pie VI jusqu’à la mort à Valence. Un aperçu des premières relectures théologiques, dès 99, toutes centrées sur une providentielle exaltation de la primauté contre les conceptions gallicanes (moralement corroborée par le « martyre » du Pape) vient clore le tout, avant que la conclusion générale n’insiste sur la période comme tournant décisif de la théologie romaine. Car G. Pelletier ne cherche pas seulement à ressusciter l’intéressante figure de Pie VI, dans la ligne des commémorations de 1999, ni à faire mieux connaître de grands fonds d’archives trop ignorés (synthèse des sources, pp. 7–28), il veut encore montrer la complexité des problèmes théologiques posés au Pape et à son entourage par le cours des événements, en vue de renouveler la compréhension « des étapes qui conduisirent la théologie catholique aux définitions de Vatican I en 1870 » (p. 1).