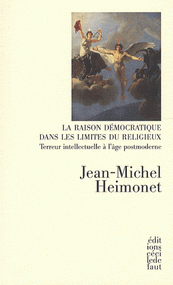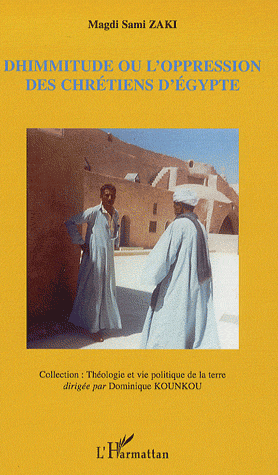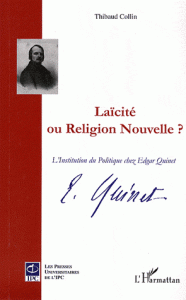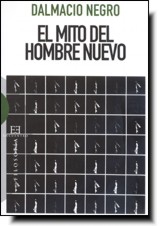[inédit, novembre 2009]
Un mythe, disait Sacha Guitry, pour rire, dans un de ses innombrables festivals d’esprit, « c’est une chose qui n’est pas vraie » Et d’attribuer, dans la foulée, aux femmes, son objet d’étude privilégié, une congénitale mythomanie, qui leur assurait, disait-il, une si grande supériorité sur l’homme dans l’art de la comédie, et le goût des « choses fausses », sauf des bijoux toutefois ! Sacré Sacha ! Mais le « mythe » est quelque chose de bien plus sérieux, que les mythographes ont répertoriés, et que les mythologues prétendent expliquer ou interpréter. Les mythes sont alors des récits, imagés, symboliques, par lesquels les hommes ont tenté d’expliquer l’univers, son origine, et son histoire. Ils sont aussi des condensés d’expériences, qui, sous une forme plus ou moins voilée, sont censés conserver l’expérience vécue, dès les temps les plus anciens, pour les faire servir, à présent, à la lutte pour la vie, à la solution des problèmes que l’humanité se pose de siècle en siècle. Les mythes pullulent dans la littérature religieuse, dans les récits des grandes épopées littéraires. Ils perdurent au cœur même de la modernité, sous des formes nouvelles. Les gadgets de la technique la plus avancée y ont remplacé les artifices magiques de l’antiquité. Mais les hélicoptères ont remplacé Pégase, Frodon pourrait bien évoquer Ulysse, et James Bond Héraklès. La structure du mythe est toujours présente, toujours prégnante, et l’on sait l’usage qu’ont fait, avec des fortunes diverses, de l’analyse des mythes, et pour nous en tenir à la psychologie, un Freud, un C‑G.Jung, pour rendre compte des profondeurs du psychisme humain. Dans Le regard vide((. Jean-François Mattei, Le regard vide. Essai sur l’épuisement de la culture européenne, Flammarion, 2007.)), le philosophe Jean-François Mattéi a recours au mythe pour tenter de percer le secret de l’Europe, pour tenter de saisir l’essence de cette civilisation, et la nature de la maladie qui, présentement l’affecte et la dévore.
A l’origine
Il y a trois mille ans, il n’y a pas encore de civilisation européenne. Elle va surgir et se former peu à peu. J‑F Mattéi a recours au mythe pour en décrire la genèse. Plus précisément au mythe d’Europé, la merveilleuse fille du roi Agénor, de Tyr, que Zeus trouva si belle, que pour la séduire il se transforma en un magnifique taureau blanc, que la jeune fille ravie chevaucha pour s’amuser, mais qui aussitôt s’éloigna du rivage, l’emportant jusqu’en Crète, mais pas au-delà. Dès l’antiquité grecque, l’épopée d’Europé fut analysée, sous divers angles. Europé vient d’Asie comme on dénommait alors le moyen orient. Elle fut à l’origine de la dénomination d’un continent que pourtant elle n’abordera pas. Ses frères, (son sang) partis à sa recherche ne la rejoindront pas, mais fonderont des villes.
D’emblée, s’affirment les thèmes de l’insatisfaction, et de l’édification. Etymologiquement, Europé renvoie à la forme verbale grecque « opopa » : le fait de voir. Pour les Grecs le mot « ops » désigne le regard, c’est-à-dire ce qui tient à distance l’objet que l’on observe, pour le considérer d’un œil critique, avec objectivité. Regard de savant, de théoricien de l’objectivité, qui sous-tend la pensée européenne tout au long de son histoire. Mattéi résume en voyant dans l’Europe une civilisation qui n’a pas sa source en elle-même, mais dont le regard est orienté vers l’extérieur ; une culture qui a connu un destin d’arrachement au sol où elle est née ; une culture de fondation de « villes ». Déplacement, mouvement, fondation. Déjà, bien avant Montesquieu, le Grec Hippocrate, le patron de la médecine, avait noté autre chose : l’influence des climats sur les peuples. Or la diversité, le changement permanent des climats en Europe, oblige celle-ci, pour survivre, au changement, à l’adaptation.
Pas de repos pour les Européens. Avec cette conséquence, évoquée par Aristote dans sa Politique : « les barbares sont plus enclins à la servitude que les Grecs, et les Asiatiques que les Européens ». A la silhouette qui se profile, viennent s’ajouter d’autres lignes. Celles qu’apporte le récit biblique. Denis de Rougemont note des similitudes entre le païen Agénor, et Chnas, ou Canaan, dans la Bible. Les voyages des fils d’Agénor, auraient pour équivalents l’exode des fils de Cham, fuyant l’esclavage auquel ils auraient été promis. Le christianisme enfin ajoute sa note particulière et capitale à la formation de l’identité européenne. On sait que les Grecs distinguaient le monde des Hellènes, et celui des barbares, que les Romains faisaient de même, le « limes » (la frontière) étant la ligne de démarcation entre la civilisation et le reste.
Après la conversion de l’empire romain au christianisme cette frontière cesse d’être géographique. Le couple significatif est désormais celui du chrétien et du païen. Le « limes » (la ligne de partage) devient intérieur, spirituel, et passe à l’intérieur de chacun. Métamorphose capitale, puisque avec l’avènement (progressif) de la chrétienté, « l’européanité », si j’ose dire, cesse d’être biologique, raciale, géographique, etc, pour devenir spirituelle, puisqu’on peut être un descendant de Romulus, et pourtant être un pauvre païen, un esclave, et cependant un bon chrétien. Mieux, comme le souligne, alors, St-Augustin, le paganisme (nouvelle dénomination de la barbarie) passe désormais en nous. Et le travail de civilisation passe par une activité constante d’arrachement aux forces qui nous éloignent de la perfection. L’Europe, qui naît alors et se développera tout au long du moyen âge, ajoute à son désir d’être, le souci du perfectionnement indéfini, par l’analyse de soi, la connaissance, non plus seulement du monde extérieur, mais de soi-même, de la vie intérieure, orientée vers l’idéal. Et elle conserve, dans son être le plus profond cette insatisfaction, à l’égard d’elle-même et du monde, que lui lègue ses origines. Pour résumer l’analyse disons que :
Le mythe phénicien avait conduit la princesse Europé vers les terres lointaines où portait le regard.
Les Grecs, puis les Romains ont creusé la distance, non plus seulement géographique, mais culturelle avec les « barbares ».
Cette différence est devenue plus profonde avec le christianisme dont la fin devient encore plus lointaine : la parousie, ou attente du retour du Christ en gloire.
L’attente du Christ creuse en l’âme une inquiétude qui ne peut être comblée que par l’infini. Ainsi se constitue la culture européenne, alors en bonne santé. La culture, c’est-à-dire la formation du regard et du « bien choisir », ou comme dira Nietzsche : « éduquer un peuple à la culture, c’est essentiellement l’accoutumer à de bons modèles, et lui inculquer de nobles besoins ». Poursuivant son analyse Jean-François Mattéi distingue, dans le regard européen, trois direction principales : Le regard sur le monde, le regard sur la cité, et celui sur l’âme.
Un regard sur le monde
Regard, et davantage, souci, pour suivre correctement la pensée de notre philosophe. Il y a dans le souci, plus que dans le regard. Par le souci, regarder devient une tâche inquiète, et passionnée, par delà la matérialité plate du monde, s’en arracher par un effort héroïque, pour en extraire le sens, s’en extraire pour échapper à la quiétude de la vision immédiate des choses pour se porter vers un au-delà des frontières de l’âme et du monde, vers l’instance ultime de l’Idée. A travers un long voyage dans les méandres de la culture européenne, Mattéi s’appuie sur la pensée de nombreux philosophes, d’où se détachent, par la fréquence des références à leur pensée, les noms de Platon, de Plotin, de Heidegger, de Patocka, Pessoa, et peut-être surtout Emmanuel Kant. Le regard européen, nous dit-il, après avoir scruté ces œuvres canoniques, est un regard transcendantal, qui de ce fait unifie l’ensemble de nos représentations en une seule conscience dont la signification est universelle. C’est une observation importante. Contrairement à d’autres cultures, fermées sur elles-mêmes, qui n’ont pas l’idée que leurs principes et croyances puissent être mises en doute, cultures dirais-je « provinciales », la culture européenne, à tort ou à raison, pense, et se pense, en termes d’universalité. Mattéi est, là-dessus sans équivoque : « La thèse que je soutiens dans cet ouvrage sur la culture de l’Europe est bien d’origine kantienne ; mais il n’est pas difficile de lui reconnaître une ascendance grecque, plus précisément platonicienne, en raison de ce vocabulaire de l’idéalité que partagent tous les penseurs européens, les matérialistes aussi bien que les idéalistes. En clair, c’est la constitution de l’homme telle que l’a pensée notre culture dans ses plus hautes réalisations, ce que Kant nomme le « sujet transcendantal » et que j’appelle plus simplement le « regard », qui a déployé cette conception d’une âme susceptible de découvrir les formes auxquelles se plient toutes les expériences possibles. Et cette constitution est l’œuvre de la culture européenne qui l’a universalisée au profit de l’humanité entière. En élaborant le concept de transcendantal, Kant n’a fait que tirer les conséquences métaphysiques de ce que la réflexion des penseurs occidentaux avaient développé depuis les Grecs ». (pages 93–94). Il ne s’agit pas, pourtant, selon notre auteur d’un « eurocentrisme » facile et de mauvais aloi. Montaigne est aussi parmi ses références, pourtant peu suspect d’étroitesse d’esprit et de provincialisme culturel. Précisément, Montaigne est celui, qui partant de l’observation concrète de lui-même, et de son environnement, chez lui et dans ses voyages, de la lecture des plus grands penseurs, avec lesquels il s’entretient dans le silence de sa bibliothèque, a le souci de peindre et découvrir par delà les idiosyncrasies personnelles, « la forme entière de l’humaine condition ». Et puis l’auteur n’a aucune peine à démontrer que la critique de l’eurocentrisme est d’abord une critique qui vient de l’Europe elle-même. Les lumières par exemple, deux siècles après Montaigne, remettent en question la vision de l’Europe par elle-même par comparaison aux autres cultures. C’est l’époque de la diffusion du mythe du « bon sauvage », auquel sont liés les noms (héritage encore de Montaigne) de Rousseau, de Montesquieu de Bougainville, de Diderot. Dans sa fiction critique des « Lettres persanes », Montesquieu fait visiter la France par deux Persans qui jettent un regard aigu sur la personne invitante. Ce n’est plus le civilisé qui étudie le primitif, mais le primitif a qui le civilisé a donné la parole, qui décrit le civilisé. Regard typiquement européen. Dans cet ouvrage le regard de l’autre sur soi permet d’établir une distance critique.
Mais qui a éclairé le regard de l’autre ? « [O]n aurait pu, écrit J‑F Mattéi, laisser les cultures archaïques à l’écart du mouvement que l’Europe a insufflé à l’histoire en les protégeant par l’insularité des utopies ou les réserves de l’ethnologie. C’est oublier que la prise en compte des autres sociétés est marquée justement par un tel écart critique et que l’esprit européen vit de la distance exotique qui le sépare de l’objet visé. La réciproque n’est pas vraie. Aucune autre culture n’a jeté de regard éloigné, ou abstrait, sur la culture européenne, et aucune n’a eu le goût de l’exotisme, car le monde primitif, plein de forces et de dieux, était refermé sur lui-même. La liberté du regard européen est un luxe de civilisé qui se détache de son monde, au moins depuis le christianisme, parce qu’il lui semble vide. C’est là que gît la séparation entre les cultures et entre les regards ». La pensée européenne, en son essence (pas en ses caricatures, ou ses errances, quand elle s’est, trop souvent, éloignée d’elle-même, pour retomber dans les ornières de la barbarie ; errances que, seules, retiennent ses ennemis, principalement des Européens d’ailleurs), n’est pas le refus de considérer toute forme d’architecture, ou de sculpture, de musique, de poésie, différentes des formes de ces arts dans l’Athènes antique, comme des modes de barbarie. Ce qu’elle cherche, par delà les différences, ou les singularités, ce sont les universaux, les archétypes universels. Ce qui intéresse le philosophe grec par exemple, c’est l’Homme. Non l’homme individuel, qui s’appelle Callias (ou Charles, ou Juliette ou Farid), avec ses particularités strictement individuelles, mais ce par quoi il peut être dit un Homme, son essence, ou sa nature d’Homme, qui seule, si elle existe, est le fondement d’une juridicité universelle, le fondement des « droits de l’homme ».
Dans son style de philosophe, difficile, technique mais rigoureux, Mattéi l’exprime fort bien : « La figure de l’Europe ne s’enracine pas ainsi dans l’univers matériel et ne s’incarne pas dans une détermination raciale ou sociale ; elle s’inscrit dans une « entéléchie » qui domine de part en part le devenir de l’Europe dans la diversité de ses figures », ou, plus simplement dit, dans un « telos spirituel », une fin idéale visée en direction d’un « pôle éternel » qui n’est autre qu’une « idée infinie, sur laquelle, de manière cachée, l’ensemble du devenir de l’esprit » de l’humanité européenne veut déboucher ». Ainsi la culture européenne ne se confond pas, comme d’autres cultures (la Chinoise traditionnelle, par exemple, même si M.Mattéi ne cite pas cet exemple) avec une expression géographique, avec une race, ni même avec aucune des formes que son art, ou sa technique ont pu prendre au cours des siècles. L’Europe, se caractérise par son « telos » (fin, but, visée, et je dirai : ce qui est le nerf de la pensée et de l’action), c’est-à-dire, au delà de la légitimité, dans certaines limites, du chatoiement des usages et des œuvres, par son goût et sa passion de la vérité, universelle, de ce que peut découvrir, dans un esprit de vérité universelle, le Chinois, le Français, le Congolais, ou l’amérindien, quand il cherche l’Homme, comme disait avec humour, dans un autre contexte, le célèbre Diogène. Et c’est la perte de ce « telos », dans l’Europe moderne, qui inspire des inquiétudes aux esprits lucides, comme l’auteur le souligne, et comme j’y reviendrai un peu plus loin.
Un regard sur la cité
La philosophie naît de l’étonnement disait Socrate. Pour lui, rien ne va de soi, et comme disait Schopenhauer « plus un homme est inférieur par l’intelligence, et moins l’existence pose pour lui de problèmes ». A ce compte l’Europe est (ou du moins a été) des plus intelligente. S’étonner, c’est d’abord prendre conscience que rien ne va de soi : par exemple l’ordre du monde, ou encore l’ordre dans la cité. A cet égard l’Europe, dans son développement spirituel est une perpétuelle remise en question de l’ordre des choses. Cette remise en question a engendré une véritable culture de l’indignation, et en premier lieu contre l’injustice.
L’idéal de Justice
Cette remise en question de l’injustice suppose une réflexion rationnelle et méthodique sur la Justice, une recherche philosophique de l’Idée vraie du Juste. Toujours le regard, la mise en perspective du tout fait, en fonction de l’idéal, qui, dans la mesure où elle progresse permettra la prise de conscience d’un « ordre » social quelconque comme désordre. Oui, la pensée européenne est transcendantale, pour reprendre la terminologie évoquée ci-dessus. Cela ne signifie pas que la civilisation européenne a toujours œuvré justement. L’histoire est là pour nous rappeler ses errements, ses fautes, ses crimes. Mais ceux-ci découlent-ils de son essence, ou de son éloignement de cette essence ? L’Europe est à la recherche de la Cité idéale. Sans doute, encore, ce thème de l’utopie n’est pas sans inconvénient. Dans leur recherche, les penseurs d’Europe ont sans doute été à l’origine de maints errements, pour parler par euphémisme. Qui donc peut, sérieusement, affirmer que penser véritablement est chose facile ! L’essentiel est ici de considérer que l’essence de l’Europe, que nous recherchons, est dans ce mouvement vers la Justice. Que ce mouvement n’a de sens que par l’orientation du regard vers l’Idée du Juste, l’Idée du Bien. Et cette recherche de la justice n’est possible que par la mise en action des principes de la raison « universelle », découvertes et énoncées par l’Europe. « Elle en est l’âme, écrit encore Montaigne, et partie ou effect d’icelle : car la vraye raison est essentielle, de qui nous desrobons le nom à fauce enseignes, elle loge dans le sein de Dieu ; c’est là son giste et sa retraite, c’est de là où elle part quand il plaist à Dieu nous en faire valoir quelques rayons ».
L’idéal de liberté
Un autre des piliers de la culture européenne est l’idéal de liberté, la prise de conscience de l’abîme qu’il y a entre l’être et le devoir être. Ici encore la réflexion nous renvoie à la transcendance de l’Idée qui est la force étrangère qui nous appelle à nous arracher aux adhérences, grâce à « une puissance désobjectivante, une puissance de distanciation à l’égard de tout objet possible ». Et ici, c’est Hegel qui écrit : « Tout comme dans le domaine théorique, l’esprit européen cherche à atteindre aussi dans le domaine pratique l’unité à produire entre lui et le monde extérieur. Il soumet le monde extérieur à ses buts avec une énergie qui lui a assuré la domination du monde. L’individu part, ici, dans ses actions particulières, de principes universels fixes ; et l’Etat représente en Europe, plus ou moins, le déploiement et la réalisation effective – arrachés à l’arbitraire d’un despote – la liberté au moyen d’institutions rationnelles ».
Rubrique(s) : Lectures critiques, Revue en ligne
 A l’aide d’archives inédites et passionnantes, l’auteur retrace de manière complète les rebondissements spectaculaires de ce feuilleton diplomatique dont les peuples épuisés furent l’enjeu, ne l’oublions pas. Pour leur malheur, les efforts du pape se soldèrent finalement par un échec à court terme. Ils permirent quand même un rapprochement de la papauté avec toutes les puissances en guerre, excepté l’Italie, et de replacer durablement le Saint-Siège sur la scène internationale, dans un rôle de médiateur qui ne lui est plus guère contesté aujourd’hui. C’est donc toute la genèse du parcours du combattant de cette « colombe des tranchées » qui nous est donnée, avec un état quasi complet de ses entrelacs diplomatiques. A ce titre, Nathalie Renoton-Beine a le mérite de souligner l’obstination du Saint-Siège à se soucier de la paix pour ses ouailles, et les mauvaises volontés évidentes qu’il a rencontrées chez ceux qui voulaient pousser l’affrontement idéologique jusqu’au suicide de l’Europe. Déjà, dans son encyclique Mater et Magistra du 1er novembre 1914, le pape dessinait un appel à la paix comme garantie d’un monde moral et fraternel contre la guerre « se nourrissant du sang et des larmes et transformant l’Europe en champ de mort et fermenté par le matérialisme ». En 1915, le pape lance prophétiquement aux gouvernants : « Vous qui portez devant Dieu et devant les hommes la responsabilité de la paix et de la guerre, écoutez notre prière, écoutez la voix du Père, du Vicaire éternel et le souverain Juge, auquel vous devez rendre compte des entreprises publiques aussi bien que privées ». Et il ajoute, prophétique : « Que l’on ne dise pas que ce cruel conflit ne puisse être apaisé que dans la violence des armes ! Que l’on dépose de part et d’autre le dessein de s’entredétruire. Que l’on réfléchisse bien, les nations ne meurent pas humiliées et oppressées, elles portent frémissantes le joug qui leur a été imposé, préparant la revanche, se transmettant de générations en générations un triste héritage de haine et de vengeance » ((. François Jankowiak, in Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Fayard, 2003.)) . Mais la tentative la plus connue de Benoît XV est son offre de paix du 1er août 1917 aux belligérants. C’est aussi celle qui suscita le plus de remous chez les gouvernants et dans les opinions publiques, opinions catholiques bien sûr comprises. Benoît XV plaidait pour une paix juste et durable qui ne déshonorait aucun des Etats, il préconisait l’instauration d’une procédure internationale qui viendrait en substitution des forces armées, rétablirait la force supérieure du droit. Le respect de celle-ci permettrait par contrecoup d’assurer une vraie liberté des mers, dont l’absence était considérée comme source de conflits. Sur la question des dommages de guerre et des réparations, il demandait une condamnation entière et réciproque, à l’exception de la Belgique à laquelle devait être garantie l’indépendance. L’Allemagne devait évacuer les territoires français et se voir restituer en contrepartie ses anciennes possessions coloniales. Le règlement des autres questions territoriales, en particulier l’Alsace-Lorraine, devait trouver sa solution en tenant compte des aspirations des peuples.
A l’aide d’archives inédites et passionnantes, l’auteur retrace de manière complète les rebondissements spectaculaires de ce feuilleton diplomatique dont les peuples épuisés furent l’enjeu, ne l’oublions pas. Pour leur malheur, les efforts du pape se soldèrent finalement par un échec à court terme. Ils permirent quand même un rapprochement de la papauté avec toutes les puissances en guerre, excepté l’Italie, et de replacer durablement le Saint-Siège sur la scène internationale, dans un rôle de médiateur qui ne lui est plus guère contesté aujourd’hui. C’est donc toute la genèse du parcours du combattant de cette « colombe des tranchées » qui nous est donnée, avec un état quasi complet de ses entrelacs diplomatiques. A ce titre, Nathalie Renoton-Beine a le mérite de souligner l’obstination du Saint-Siège à se soucier de la paix pour ses ouailles, et les mauvaises volontés évidentes qu’il a rencontrées chez ceux qui voulaient pousser l’affrontement idéologique jusqu’au suicide de l’Europe. Déjà, dans son encyclique Mater et Magistra du 1er novembre 1914, le pape dessinait un appel à la paix comme garantie d’un monde moral et fraternel contre la guerre « se nourrissant du sang et des larmes et transformant l’Europe en champ de mort et fermenté par le matérialisme ». En 1915, le pape lance prophétiquement aux gouvernants : « Vous qui portez devant Dieu et devant les hommes la responsabilité de la paix et de la guerre, écoutez notre prière, écoutez la voix du Père, du Vicaire éternel et le souverain Juge, auquel vous devez rendre compte des entreprises publiques aussi bien que privées ». Et il ajoute, prophétique : « Que l’on ne dise pas que ce cruel conflit ne puisse être apaisé que dans la violence des armes ! Que l’on dépose de part et d’autre le dessein de s’entredétruire. Que l’on réfléchisse bien, les nations ne meurent pas humiliées et oppressées, elles portent frémissantes le joug qui leur a été imposé, préparant la revanche, se transmettant de générations en générations un triste héritage de haine et de vengeance » ((. François Jankowiak, in Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Fayard, 2003.)) . Mais la tentative la plus connue de Benoît XV est son offre de paix du 1er août 1917 aux belligérants. C’est aussi celle qui suscita le plus de remous chez les gouvernants et dans les opinions publiques, opinions catholiques bien sûr comprises. Benoît XV plaidait pour une paix juste et durable qui ne déshonorait aucun des Etats, il préconisait l’instauration d’une procédure internationale qui viendrait en substitution des forces armées, rétablirait la force supérieure du droit. Le respect de celle-ci permettrait par contrecoup d’assurer une vraie liberté des mers, dont l’absence était considérée comme source de conflits. Sur la question des dommages de guerre et des réparations, il demandait une condamnation entière et réciproque, à l’exception de la Belgique à laquelle devait être garantie l’indépendance. L’Allemagne devait évacuer les territoires français et se voir restituer en contrepartie ses anciennes possessions coloniales. Le règlement des autres questions territoriales, en particulier l’Alsace-Lorraine, devait trouver sa solution en tenant compte des aspirations des peuples.